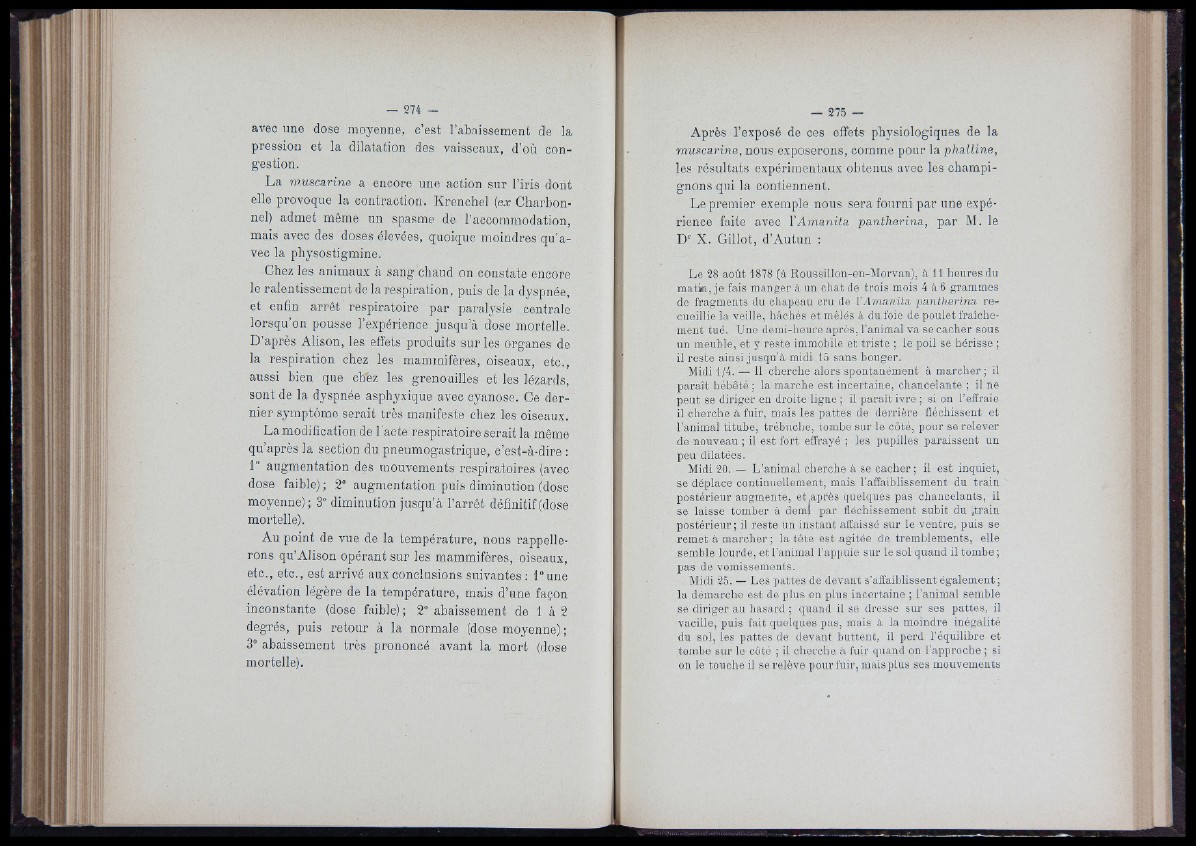
! i»'-
avec une dose moyeune, c’est l’abaissement de la
pression et la dilatation des vaisseaux, d’où congestion.
La wMscarine a encore une action sur l’iris dont
elle provoque la contraction. Krenchel (ex Charbonnel)
admet même un spasme de l’accommodation,
mais avec des doses élevées, quoique moindres qu’a vec
la physostigmine.
Chez les animaux à sang chaud on constate encore
le ralentissement de la respiration, puis de la dyspnée,
et enhn a rrêt respiratoire par paralysie centrale
lorsqu’on pousse l’expérience jusqu’à dose mortelle.
D’après Alison, les effets produits sur les organes de
la respiration chez les mammifères, oiseaux, etc.,
aussi bien que chez les grenouilles et les lézards,
sont de la dyspnée asphyxique avec cyanose. Ce dernier
symptôme serait très manifeste chez les oiseaux.
La modification de l'acte respiratoire serait la même
qu’après la section du pneumogastrique, c’est-à-dire :
1 ° augmentation des mouvements respiratoires (avec
dose faible); 2” augmentation puis diminution (dose
moyenne) ; 3“ diminution jusqu’à l’arrêt définitif (dose
mortelle).
Au point de vue de la température, nous rappellerons
qu’Alison opérant sur les mammifères, oiseaux,
etc., etc., est arrivé aux conclusions suivantes ; Dune
élévation légère de la température, mais d’une façon
inconstante (dose faible) ; 2° abaissement de 1 à 2
degrés, puis retour à la normale (dose moyenne) ;
3° abaissement très prononcé avant la mort (dose
mortelle).
Après l’exposé de ces effets physiologiques de la
muscarine, nous exposerons, comme pour la phalline,
les résultats expérimentaux obtenus avec les champignons
qui la contiennent.
Le premier exemple nous sera fourni par une expérience
faite avec l'Amanita pantherina, par M. le
D“ X. Gillot, d’Autun :
L e 28 ao û t 1878 (à Roussillon-en-Morvan), à 11 heu res du
m atin , je fais manger à un c h a t de tro is mois 4 à 6 grammes
de fragments du chapeau cru de l’A m a n ita p a n th e r in a r e cueillie
la veille, ha ch é s et mêlés à du foie de poulet fraîchem
en t tué, Une d emi-heure après, l’animal va se cach er sous
un meuble, et y re ste immobile e t tris te ; le poil se h é risse ;
il re s te ainsi ju sq u ’à midi 15 sans bouger.
Midi 1/4. — Il cherche alors sp o n tan ém en t à m a rch e r ; il
p a ra ît héb été ; la m arch e e st in c e rta in e , ch an c elan te ; il ne
p e u t se d irig e r en droite ligne ; il p a ra ît ivre ; si on l’effraie
il ch erche à fuir, mais les p a tte s de d e rriè re fléchissent et
l’animal titu b e , tréb u ch e, tombe su r le côté, pour se re lev er
de nouveau ; il e st fo rt effrayé ; les pupilles p a ra iss en t un
peu dilatées.
Midi 20. — L ’animal ch erche à se cach er ; il e s t inquiet,
se déplace con tin u e llem en t, mais l’affaiblissement du tra in
p o sté rieu r augmente, e t,ap rè s quelques pas ch an c elan ts, il
se laisse tomber à demi p a r fléchissement su b it du ,train
p o s té rie u r; il re s te un in s ta n t affaisse su r le v en tre , puis se
rem e t à m a rch e r ; la tê te e st ag itée de trem b lem en ts, elle
semble lourde, et l ’animal l’appuie sur le sol quand il tombe ;
pa s de vomissements.
Midi 25. — Les p a tte s de d ev an t s’affaiblissent égalem en t ;
la démarche e st de plus en plus in c e rta in e ; l’animal semble
se d irig e r au h a sa rd ; quand il se d resse su r ses p a tte s, il
vacille, puis l’a it quelques pas, mais à la moindre in ég a lité
du sol, les p a tte s de devant b u tten t, il p e rd l ’équilibre et
tombe su r le côté ; il cb erche à fuir quand on l’approche ; si
on le touche il se re lèv e pour fuir, mais plus ses mouvements