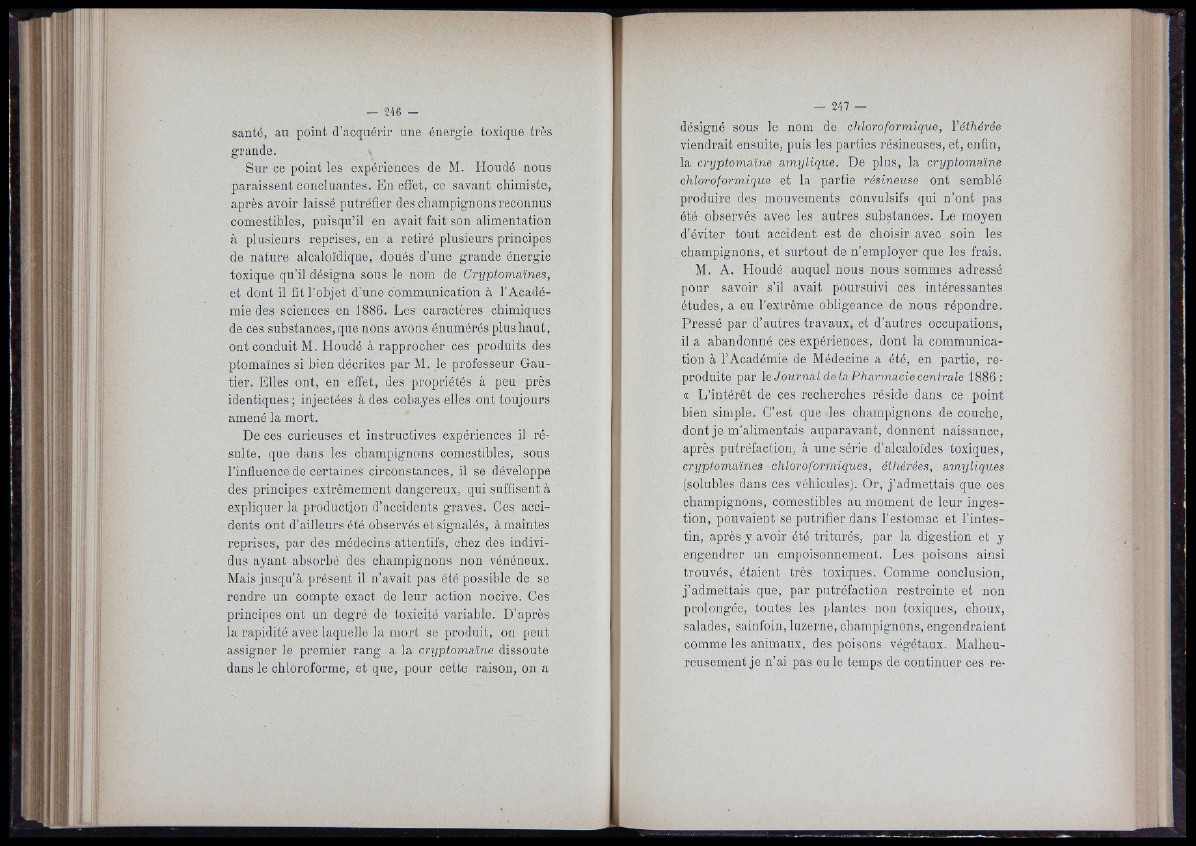
santé, au point d’acquérir une énergie toxique très
grande.
Sur ce point les expériences de M. Houdé nous
paraissent concluantes. En effet, ce savant chimiste,
après avoir laissé putréfier des champignons reconnus
comestibles, puisqu’il en avait fait son alimentation
à plusieurs reprises, eu a retiré plusieurs principes
de nature alcaloïdique, doués d’une grande énergie
toxique qu’il désigna sous le nom de Cryptomaïnes,
et dont il fit l’objet d’une communication à l’Académie
des sciences en 1886. Les caractères chimiques
de ces substances, que nous avons énumérés plus haut,
ont conduit M. Houdé à rapprocher ces produits des
ptomaïnes si bien décrites par M. le professeur Gautier.
Elles ont, en effet, des propriétés à peu près
identiques; injectées à des cobayes elles ont toujours
amené la mort.
De ces curieuses et instructives expériences il résulte,
que dans les champignons comestibles, sous
l ’influence de certaines circonstances, il se développe
des principes extrêmement dangereux, qui suffisent à
expliquer la production d’accidents graves. Ces accidents
ont d’ailleurs été observés et signalés, à maintes
reprises, par des médecins attentifs, chez des individus
ayant absorbé des champignons non vénéneux.
Mais jusqu’à présent il n ’avait pas été possible de se
rendre un compte exact de leur action nocive. Ces
principes ont un degré de toxicité variable. D’après
la rapidité avec laquelle la mort se produit, on peut
assigner le premier rang a la cryptomaïne dissoute
dans le chloroforme, et que, pour cette raison, on a
désigné sous le nom de chloroformique, Véthérée
viendrait ensuite, puis les parties résineuses, et, enfin,
la cryptomaïne amylique. De plus, la cryptomaïne
chloroformique et la partie résineuse ont semblé
produire des mouvements convulsifs qui n ’ont pas
été observés avec les autres substances. Le moyen
d’éviter tout accident est de choisir avec soin les
champignons, et surtout de n’employer que les frais.
M. A. Houdé auquel nous nous sommes adressé
pour savoir s’il avait poursuivi ces intéressantes
études, a eu l’extrême obligeance de nous répondre.
Pressé par d’autres travaux, et d’autres occupations,
il a abandonné ces expériences, dont la communication
à l’Académie de Médecine a été, en partie, re produite
par \e Journal de la Pharmacie centrale 1886:
« L ’intérêt de ces recherches réside dans ce point
bien simple. C’est que les champignons de couche,
dont je m’alimentais auparavant, donnent naissance,
après putréfaction, à une série d’alcaloïdes toxiques,
cryptomaïnes chloroformiques, éthérées, arnyliques
(solubles dans ces véhicules). Or, j ’admettais que ces
champignons, comestibles au moment de leur ingestion,
pouvaient se putrifier dans l’estomac et l’intestin,
après y avoir été triturés, par la digestion et y
engendrer un empoisonnement. Les poisons ainsi
trouvés, étaient très toxiques. Comme conclusion,
j ’admettais que, par putréfaction restreinte et non
prolongée, toutes les plantes non toxiques, choux,
salades, sainfoin, luzerne, champignons, engendraient
comme les animaux, des poisons végétaux. Malheureusement
je n’ai pas eu le temps de continuer ces reBIM;
F