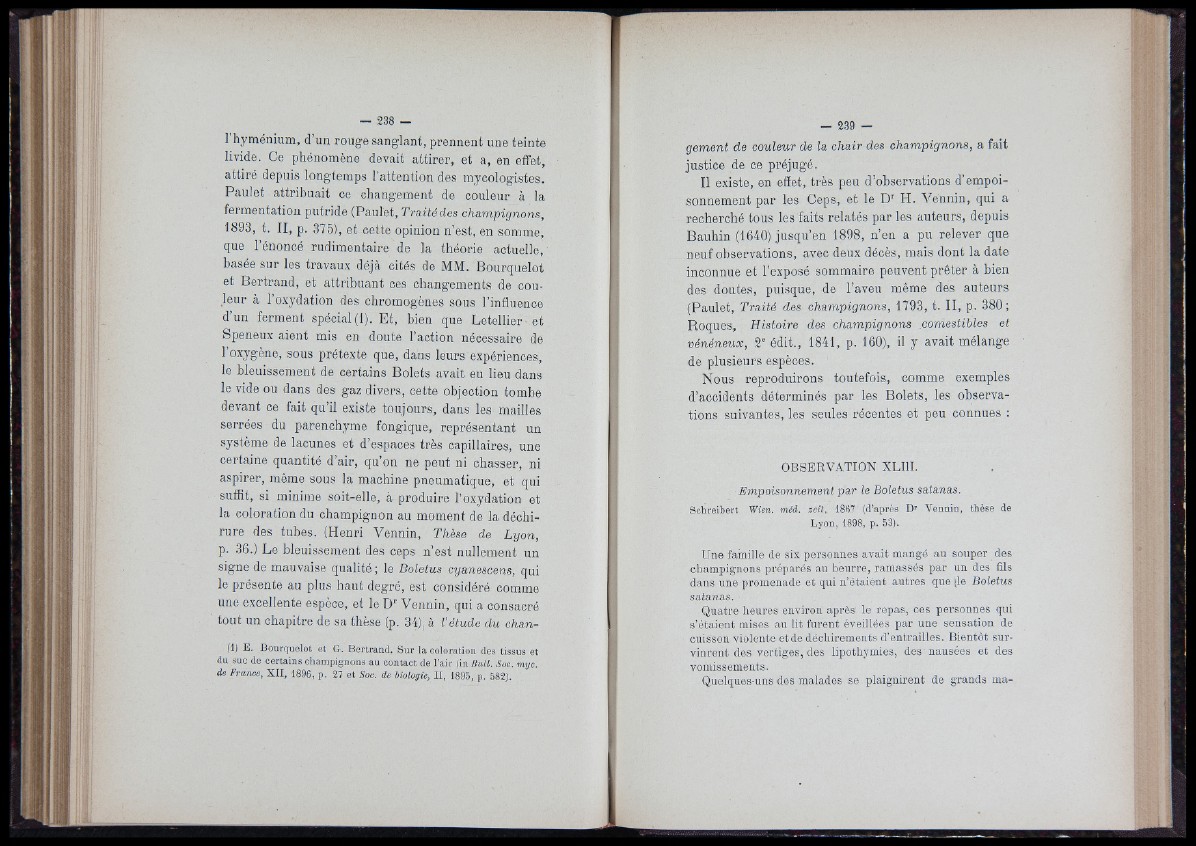
' f
l’hyménium, d’un rouge sanglant, prennent une teinte
livide. Ce phénomène devait attirer, et a, en effet,
attiré depuis longtemps l’attention des mycologistes.
Paulet attribuait ce changement de couleur à la
fermentation putride (Paulet, Traité des champignons,
1893, t. II, p. 375), et cette opinion n’est, en somme,
que l’énoncé rudimentaire de la théorie actuelle,
basée sur les travaux déjà cités de MM. Bourquelot
et Bertrand, et attribuant ces changements de couleur
à l’oxjMation des chromogènes sous l ’influence
d’un ferment spécial (1). Et, bien que Letellier et
Speneux aient mis en doute l’action nécessaire de
l’oxygène, sous prétexte que, dans leurs expériences,
le bleuissement de certains Bolets avait eu lieu dans
le vide ou dans des gaz divers, cette objection tombe
devant ce fait qu’il existe toujours, dans les mailles
serrées du parenchyme fongique, représentant un
système de lacunes et d’espaces très capillaires, une
certaine quantité d’air, qu’on ne peut ni chasser, ni
aspirer, même sous la machine pneumatique, et qui
suffit, si minime soit-elle, à produire l’oxydation et
la coloration du champignon au moment de la déchirure
des tubes. (Henri Vennin, Thèse de Lyon,
p. 36.) Le bleuissement des ceps n ’est nullement un
signe de mauvaise qualité; le Boletus cyanescens, qui
le présente au plus haut degré, est considéré comme
une excellente espèce, et le D' Vennin, qui a consacré
tout un chapitre de sa thèse (p. 34)^ à l'étude du chan-
(1) E. Bourquelot et G. Bertrand. Sur la coloration des tissus et
du suc de certains champignons au contact de l’air (in Buil. Soc. myc.
de France, XII, 1896, p. 27 et Soc. de biologie, II, 1895, p. 582).
gement de couleur de la chair des champignons, a fait
justice de ce préjugé.
Il existe, en effet, très peu d’observations d’empoisonnement
par les Ceps, et le D® H. Vennin, qui a
recherché tous les faits relatés par les auteurs, depuis
Bauhin (1640) jusqu’en 1898, n’en a pu relever que
neuf observations, avec deux décès, mais dont la date
inconnue et l’exposé sommaire peuvent prêter à bien
des doutes, puisque, de l ’aveu même des auteurs
(Paulet, Traité des champignons, 1793, t. H, p. 380;
Roques, Histoire des champignons .comestibles et
vénéneux, 2” édit., 1841, p. 160), il y avait mélange
de plusieurs espèces.
Nous reproduirons toutefois, comme exemples
d’accidents déterminés par les Bolets, les observations
suivantes, les seules récentes et peu connues :
OBSERV AT ION XLIII.
Empoisonnement par le Boletus satanas.
Schreibert Wien. méd. zeit, 1867 (d’après D® Vennin, thèse de
Lyon, 1898, p. 53).
Une famille de six p e rso n n es a v a it mangé au souper des
champignons p rép a ré s au b eu rre , ram a ssés p a r un des fils
dans une promenade et qui n ’é ta ien t a u tre s que (le Boletus
satanas.
Q u a tre heu res environ après le rep as, ces p e rso n n es qui
s’é ta ien t mises au lit fu ren t éveillées p a r une sen sa tio n de
cuisson violente e t de déch irem en ts d’en tra ille s . B ien tô t su rv
in ren t des v e rtig es , des lipothymies, des n au sé es e t des
vomissements.
Quelques-uns des malades se p la ig n iren t de gran d s ma