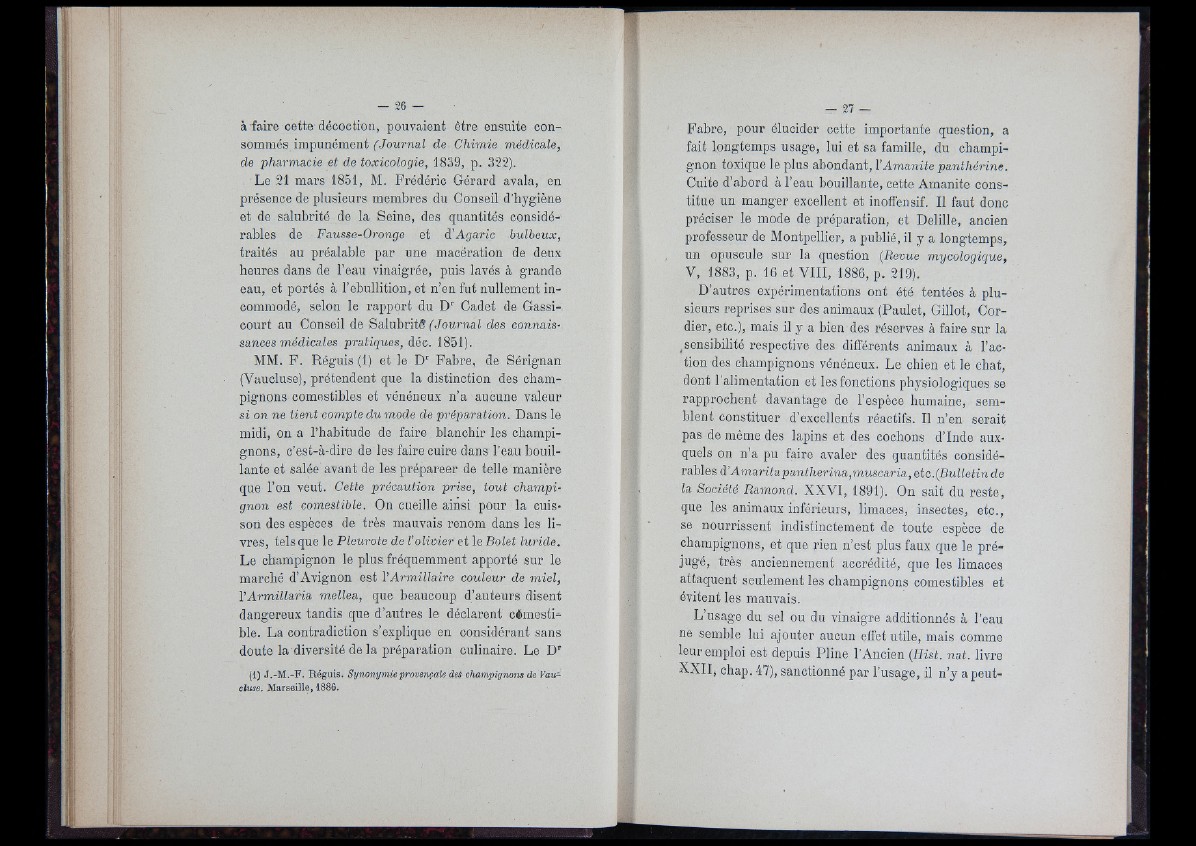
à faire cette décoction, pouvaient être ensuite consommés
impunément (Journal de Chimie médicale,
de pharmacie et de toxicologie, 1839, p. 322).
Le 21 mars 1851, M. Frédéric Gérard avala, en
présence de plusieurs membres du Conseil d’hygiène
et de salubrité de la Seine, des quantités considérables
de Fausse-Oronge et d’Agaric bulbeux,
traités au préalable par une macération de deux
heures dans de l’eau vinaigrée, puis lavés à grande
eau, et portés à l’ebullition, et n’en fut nullement incommodé,
selon le rapport du D" Cadet de Gassi-
court au Conseil de Salubrité (Journal des connaissances
médicales pratiques, déc. 1851).
MM. F . Réguis (1) et le D" Fabre, de Sérignan
(Vaucluse), prétendent que la distinction des champignons
comestibles et vénéneux n ’a aucune valeur
si on ne tient compte du mode de préparation. Dans le
midi, on a l’habitude de faire blanchir les champignons,
c’est-à-dire de les faire cuire dans l ’eau bouillante
et salée avant de les prépareer de telle manière
que l’on veut. Cette précaution prise, tout champignon
est comestible. On cueille ainsi pour la cuisson
des espèces de très mauvais renom dans les livres,
tels que le Pleurote de l’olivier et le Bolet luride.
Le champignon le plus fréquemment apporté sur le
marché d’Avignon est l'Armillaire couleur de miel,
VArmillaria mellea, que beaucoup d’auteurs disent
dangereux tandis que d’autres le déclarent comestible.
La contradiction s’explique en considérant sans
doute la diversité de la préparation culinaire. Le D*'
(1) J.-M.-F. Réguis. Synonymie provençale des champignons de Vaucluse.
Marseille, 1886.
Labre, pour élucider cette importante question, a
fait longtemps usage, lui et sa famille, du champignon
toxique le plus abondant, VAmanite panthérine.
Cuite d’abord à l’eau bouillante, cette Amanite constitue
un manger excellent et inoffensif. Il faut donc
préciser le mode de préparation, et Delille, ancien
professeur de Montpellier, a publié, il y a longtemps,
un opuscule sur la question (Revue mycologique,
V, 1883, p. 16 et VIII, 1886, p. 219).
D’autres expérimentations ont été tentées à plusieurs
reprises sur des animaux (Paulet, Gillot, Cor-
dier, etc.), mais il y a bien des réserves à faire sur la
^sensibilité respective des différents animaux à l’action
des champignons vénéneux. Le chien et le chat,
dont l ’alimentation et les fonctions physiologiques se
rapprochent davantage de l’espèce humaine, semblent
constituer d’excellents réactifs. Il n ’en serait
pas de même des lapins et des cochons d’Inde auxquels
on n ’a pu faire avaler des quantités considérables
d ’Amaritapantherina,muscaria, etc.(Bulletin de
la Société Ramond. XXVI, 1891). On sait du reste,
que les animaux inférieurs, limaces, insectes, etc.,
se nourrissent indistinctement de toute espèce de
champignons, et que rien n ’est plus faux que le préjugé,
très anciennement accrédité, que les limaces
attaquent seulement les champignons comestibles et
évitent les mauvais.
L ’usage du sel ou du vinaigre additionnés à l’eau
ne semble lui ajouter aucun effet utile, mais comme
leur emploi est depuis Pline l ’Ancien (Hist. nat. livre
XXIR chap. 47), sanctionné par l ’usage, il n ’y a peut