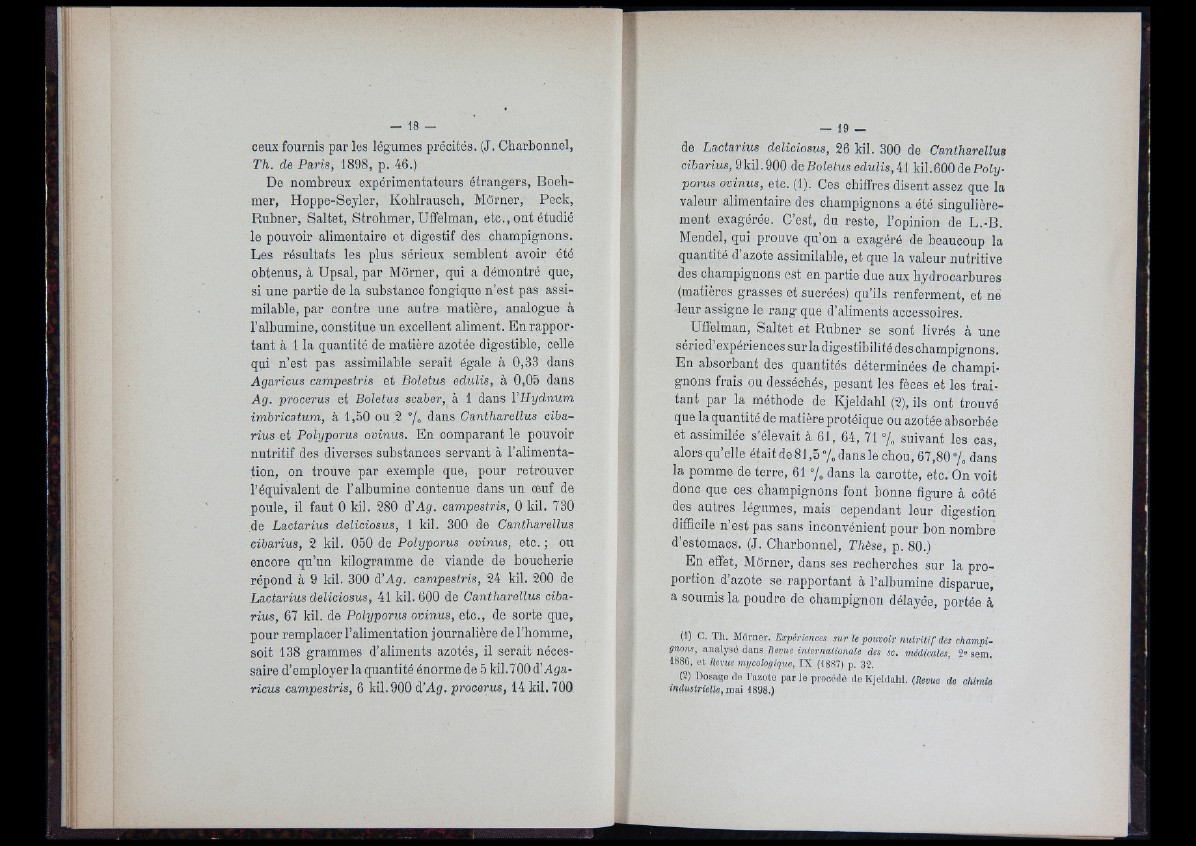
ceux fournis par les légumes précités. (J. Charbonnel,
Th. de Paris, 1898, p. 46.)
De nombreux expérimentateurs étrangers, Boeh-
mer, Hoppe-Seyler, Kohlrauscb, MOrner, Peck,
Rubner, Saltet, Strohmer, Uffelman, etc., ont étudié
le pouvoir alimentaire et digestif des champignons.
Les résultats les plus sérieux semblent avoir été
obtenus, à Upsal, par Môrner, qui a démontré que,
si une partie de la substance fongique n ’est pas assimilable,
par contre une autre matière, analogue à
l’albumine, constitue un excellent aliment. En rapportan
t à 1 la quantité de matière azotée digestible, celle
qui n’est pas assimilable serait égale à 0,33 dans
Agaricus campestris et Boletus edulis, à 0,05 dans
Ag. procerus et Boletus scaber, à 1 dans VHydnum
imbricetum, à 1,50 ou 2 % dans Cantharellus cibarius
et Polyporus ovinus. En comparant le pouvoir
nu tritif des diverses substances servant à l’alimentation,
on trouve par exemple que, pour retrouver
l’équivalent de l’albumine contenue dans un oeuf de
poule, il faut 0 kil. 280 d’Ag. campestris, 0 kil. 730
de Lactarius deliciosus, 1 kil. 300 de Cantharellus
cibarius, 2 kil. 050 de Polyporus ovinus, etc. ; ou
encore qu’un kilogramme de viande de boucherie
répond à 9 kil. 300 d’Ag. campestris, 24 kil. 200 de
Lactarius deliciosus, 41 kil. 600 de Cantharellus cibarius,
67 kil. de Polyporus ovinus, etc., de sorte que,
pour remplacer l’alimentation journalière de l ’homme,
soit 138 grammes d’aliments azotés, il serait nécessaire
d’employer la quantité énorme de 5 kil.700 d’Aga-
ricus campestris, 6 kil. 900 d’Ag. procerus, 14 kil. 700
de Lactarius deliciosus, 26 kil. 300 de Cantharellus
cibarius, 9ÎÏÏ. 900 deBoletus e d u lis ,ii kil. 600 de Poly-
porus ovinus, etc. (1). Ces chiffres disent assez que la
valeur alimentaire des champignons a été singulièrement
exagérée. C’est, du reste, l’opinion de L.-B.
Mendel, qui prouve qu’on a exagéré de beaucoup la
quantité d’azote assimilable, et que la valeur nutritive
des champignons est en partie due aux hydrocarbures
(matières grasses et sucrées) qu’ils renferment, et ne
leur assigne le rang que d’aliments accessoires.
Uffelman, Saltet et Rubner se sont livrés à une
séried’expériences sur la digestibilité des champignons.
En absorbant des quantités déterminées de champignons
frais ou desséchés, pesant les fèces et les tr a itan
t par la méthode de Kjeldahl (2), ils ont trouvé
que la quantité de matière protéique ou azotée absorbée
et assimilée s’élevait à 61, 64, 71 % suivant les cas,
alors qu’elle était de 81,5 % dans le chou, 67,80 % dans
la pomme de terre, 61 % dans la carotte, etc. On voit
donc que ces champignons font bonne figure à côté
des autres légumes, mais cependant leur digestion
difficile n’est pas sans inconvénient pour bon nombre
d’estomacs. (J. Charbonnel, Thèse, p. 80.)
En effet, Morner, dans ses recherches sur la proportion
d’azote se rapportant à l’albumine disparue,
a soumis la poudre de champignon délayée, portée à
(1) G. Th. Môrner. Expériences sur le p o u vo irn u tr itif des champignons,
analysé dans Revue internationale des sc. médicales, 2* sem.
1886, et Revue mycologique, IX (1887) p. 32. ’
(2) Dosage de l’azote par le procédé de Kjeldahl. {Revue de chimie
industrielle, mai 1898.)