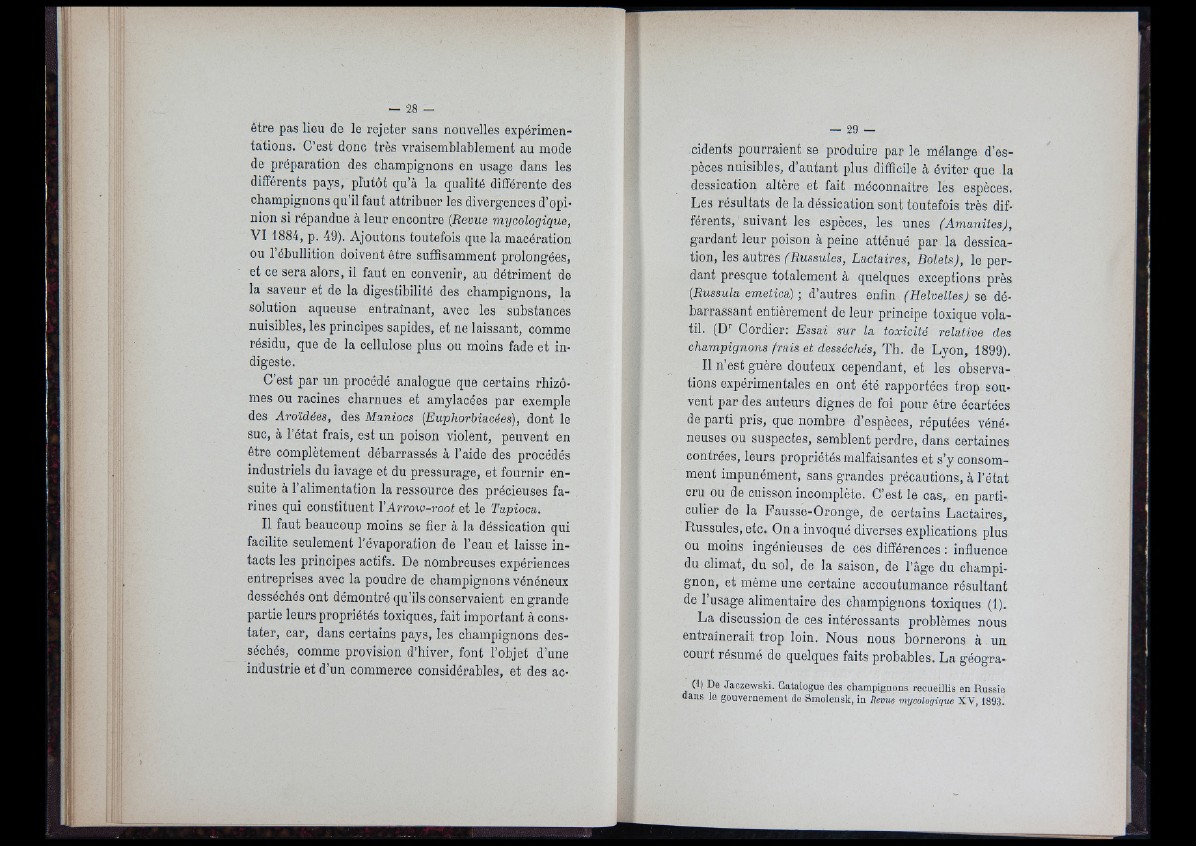
être pas lieu de le rejeter sans nouvelles expérimentations.
C’est donc très vraisemblablement au mode
de préparation des champignons en usage dans les
différents pays, plutôt qu’à la qualité différente des
champignons qu’il faut attribuer les divergences d’opinion
si répandue à leur encontre {Revue mycologique,
VI 1884, p. 49). Ajoutons toutefois que la macération
ou l’ébullition doivent être suffisamment prolongées,
et ce sera alors, il faut en convenir, au détriment de
la saveur et de la digestibilité des champignons, la
solution aqueuse entraînant, avec les substances
nuisibles, les principes sapldes, et ne laissant, comme
résidu, que de la cellulose plus ou moins fade et indigeste.
C’est par un procédé analogue que certains rhizô-
mes ou racines charnues et amylacées par exemple
dés Aroïdées, des Maniocs {Euphorbiacées), dont le
suc, à l ’état frais, est un poison violent, peuvent en
être complètement débarrassés à l’aide des procédés
industriels du lavage et du pressurage, et fournir ensuite
à l’alimentation la ressource des précieuses farines
qui constituent VArrow-root et le Tapioca.
Il faut beaucoup moins se fier à la déssication qui
facilite seulement l’évaporation de l’eau et laisse intacts
les principes actifs. De nombreuses expériences
entreprises avec la poudre de champignons vénéneux
desséchés ont démontré qu’ils conservaient en grande
partie leurs propriétés toxiques, fait important à consta
te r, car, dans certains pays, les champignons desséchés,
comme provision d’hiver, font l’objet d’une
industrie et d’un commerce considérables, et des accidents
pourraient se produire par le mélange d’espèces
nuisibles, d’autant plus difficile à éviter que la
dessication altère et fait méconnaître les espèces.
Les résultats de la déssication sont toutefois très différents,
suivant les espèces, les unes (Amanites),
gardant leur poison à peine atténué par la dessication,
les autres (Russules, Lactaires, Bolets), le perdant
presque totalement à quelques exceptions près
(Russula emetica) ; d’autres enfin (Helvelles) se débarrassant
entièrement de leur principe toxique volatil.
(D'' Cordier: Essai sur la toxicité relative des
champignons frais et desséchés, Th. de Lyon, 1899).
Il n’est guère douteux cependant, et les observations
expérimentales en ont été rapportées trop souvent
par des auteurs dignes de foi pour être écartées
de parti pris, que nombre d’espèces, réputées vénéneuses
ou suspectes, semblent perdre, dans certaines
contrées, leurs propriétés malfaisantes et s’y consomment
impunément, sans grandes précautions, à l’état
cru ou de cuisson incomplète. C’est le cas, en p a rticulier
de la Fausse-Oronge, de certains Lactaires,
Russules, etc. On a invoqué diverses explications plus
ou moins ingénieuses de ces différences ; influence
du climat, du sol, de la saison, de l’âge du champignon,
et même une certaine accoutumance résultant
de l’usage alimentaire des champignons toxiques (1).
La discussion de ces intéressants problèmes nous
entraînerait trop loin. Nous nous bornerons à un
court résumé de quelques faits probables. La géogra-
(1) De Jaczewski. Catalogue des champignons recueillis en Russie
dans le gouvernement de Smolensk, in Revue mycologique XV, 1893.