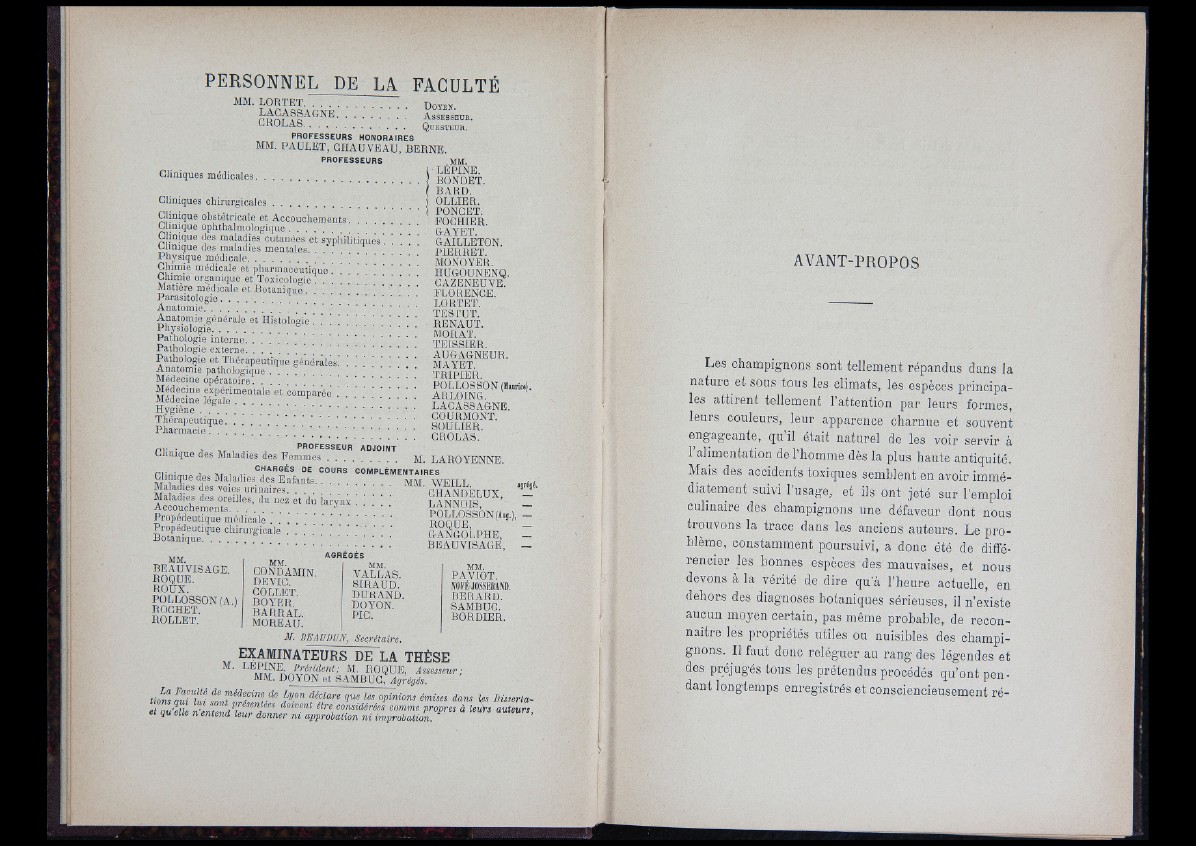
PERSONNEL DE LA FACULTÉ
MM. LORTET........................ Doyen
LAGASSAGNE....................: : : A s s e s s e u « .
Q u e s t e u r ,
OLLIER.
PONGET.
GROLAS,
p r o f e s s e u r s h o n o r a ir e s
MM, PAULET, GHAD VEAU, BERNE.
PROFESSEURS MM.
Cliniques médicales.......................................................... | BOnWe T
’ ' ' i BABD.
Cliniques c h iru rg ic a le s ...............................
Clinique obstétricale et Accouchements. . , FOCHiRR
Clinique ophthalmologique............................... ' ' ' g a y ET
Cliumn» cutanées et syphilitiques'. GAILLETON.
Liiinique des maladies mentales. . p iu r r u t
Physique médicale.................................... ! ' ! ! ! ! ' ' ' ‘ MONOT
Chimie médicale et pharmaceutique. . . . • • • • jjUGOUNENÛ
p im i e organique et Toxicologie . .............. G V/PNErTV^P '
A g r j e 'f é n é r a l e e tH i s t o b ^ ^ ^ r S t -
Pathologie interne’. Y Y ................................... TEiSSIER
Pathologie externe..................................... j ........................... AHP a pnettr
Pathologie et Thérapeutique générales.'Anatomie pathologique ....• .......• ..... ... iMiAAYET
Médecine opératoire. . . . ............................... o n r t Accpxt /» ■ i
, PROFESSEUR
Clinique des Maladies des Femmes
GROLAS.
ADJOINT
. . M. LAROYENNE.
r i in lm , 1 A l 1 r COURS OOM PLÉMENTAIRES Clinique des Maladies des Enfants. . . m m WFTr T
Maladies des voies urinaires............................ ' ' ' WEiLL
Maladies des oreilles, du nez et du ia rv n x ..............
Accouchements.................................... ^ ..............
Propédeutique médicale ..................................
Propédeutique chirurgicale . . . ' ...............................
Botanique.................................. ........................
MM.
BEAUVISAGE.
ROQUE.
ROUX.
POLLOSSON (A.)
ROCHET,
ROLLET.
AQRÉGÉS
«grégé.
GHANDELUX,
LANNOIS, —
POLLOSSON (Aug.), -
ROQUE, _
GANGOLPHE, _
BEAUVISAGE, —
MM. MM
CONDAMIN. v a l l 'a s .
DEVIG. 8IRAUD.
COLLET. DURAND.
BOYER. DOYON.
b a r r a l . PIC.
m o r e a u .
M. BEAUDUN, Secrétaire.
MM.
PAVIOT.
NOVÉ-JOSSEIÌAM).
BERARü.
SAMBUG,
BORDIER.
EXAMINATEURS DE LA THÈSE
p e p i n e . Président: M. ROQUE, Assesseur ■
MM. DOYON et SAMBUG,
t im s p T Î Î i f o , ^ i t 7 ' ' ^ r i“ Dissertaeett
qmui 'ieililee n«' „e„nfte nd1 l7 eur donnedro nivie natp petrroeb caotinosnid nérié iems pcroombmateio pnr.o pres à leuŸs aauutteeuurrss,
i
p§
i
S f-
M
A V A N T - P R O P O S
Les champignons sont tellement répandus dans la
nature et sous tous les climats, les espèces principales
attirent tellement l’attention par leurs formes,
leurs couleurs, leur apparence charnue et souvent
engageante, qu il était naturel de les voir servir à
l’alimentation de l’homme dès la plus haute antiquité.
Mais des accidents toxiques semblent en avoir immédiatement
suivi l’usage, et ils ont jeté sur l'emploi
culinaire des champignons une défaveur dont nous
trouvons la trace dans les anciens auteurs. Le problème,
constamment poursuivi, a donc été de différencier
les bonnes espèces des mauvaises, et nous
devons à la vérité de dire qu’à l’heure actuelle, en
dehors des diagnoses botaniques sérieuses, il n’existe
aucun moyen certain, pas même probable, de reconnaître
les propriétés utiles ou nuisibles des champignons.
Il faut donc reléguer au rang des légendes et
des préjugés tous les prétendus procédés qu’ont pendant
longtemps enregistrés et consciencieusement ré