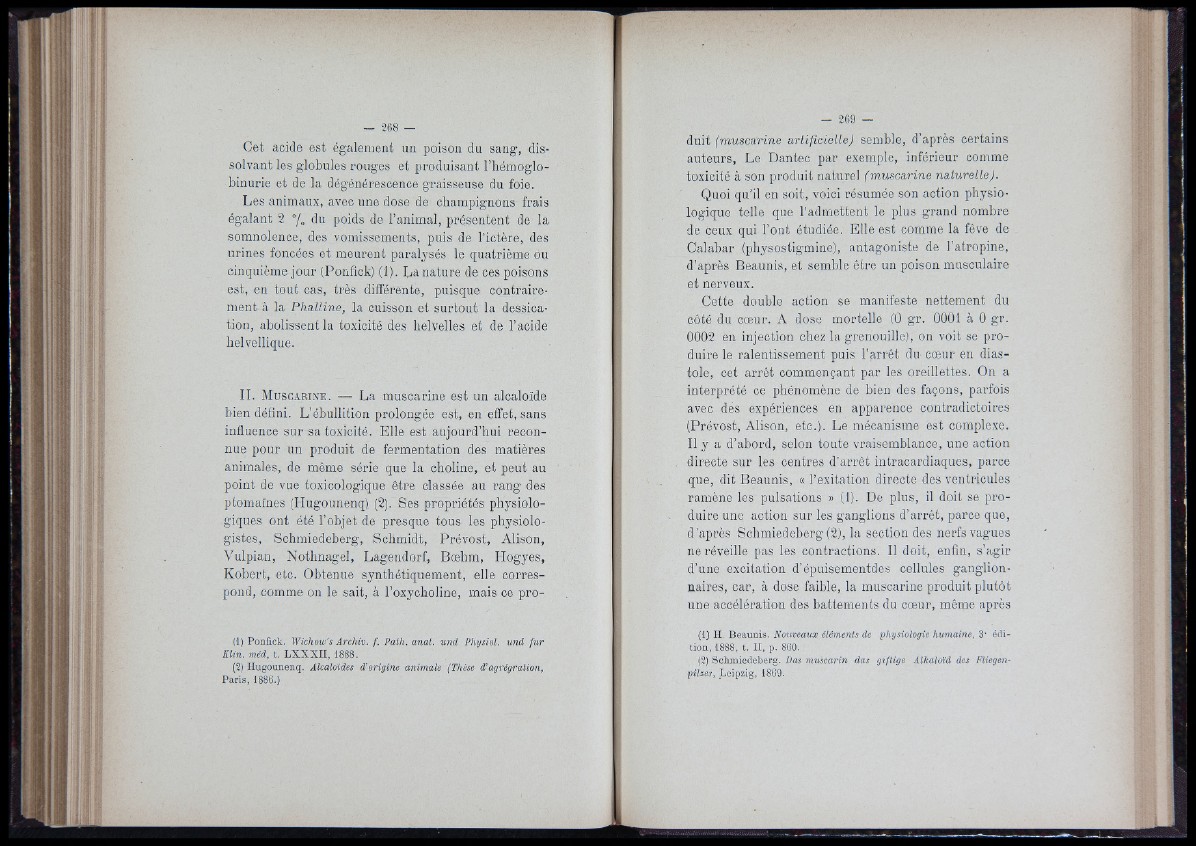
(3et acide est également un poison du sang, dissolvant
les globules rouges et produisant l’hémoglo-
binurie et de la dégénérescence graisseuse du foie.
Les animaux, avec une dose de champignons frais
égalant 2 % poids de l’animal, présentent de la
somnolence, des vomissements, puis de l’ictère, des
urines foncées et meurent paralysés le quatrième ou
cinquième jour (Ponfick) (1). La nature de ces poisons
est, en tout cas, très différente, puisque contrairement
à la Phalline, la cuisson et surtout la dessication,
abolissent la toxicité des helvelles et de l’acide
helvellique.
II. M u s c a r i n e . — La muscarine est un alcaloïde
bien défini. L ’ébullition prolongée est, en effet, sans
influence sur sa toxicité. Elle est aujourd’hui reconnue
pour un produit de fermentation des matières
animales, de même série que la choline, et peut au
point de vue toxicologique être classée au rang des
ptomaïnes (liugounenq) (2). Ses propriétés physiologiques
ont été l’objet de presque tous les physiologistes,
Schmiedeberg, Schmidt, Prévost, Alison,
Vulpian, Nothnagel, Lagendorf, Boehm, Hogyes,
Kobert, etc. Obtenue synthétiquement, elle correspond,
comme on le sait, à l ’oxycholine, mais ce pro-
(1) Ponfick. Wtc/iow's Arc/u'v. f. Path. anat. und Physiol, und fur
Klin, méd, t. LXXXII, 1888.
(2) Hugounenq. Alcaloïdes d’origine animale (Thèse d’agrégration,
Paris, 1886.)
duit (muscarine artificielle) semble, d’après certains
auteurs, Le Dantec par exemple, inférieur comme
toxicité à son produit naturel (muscarine naturelle).
Quoi qu’il en soit, voici résumée son action physiologique
telle que l’admettent le plus grand nombre
de ceux qui l’ont étudiée. Elle est comme la fève de
Calabar (physostigmine), antagoniste de l’atropine,
d’après Beaunis, et semble être un poison musculaire
et nerveux.
Cette double action se manifeste nettement du
côté du coeur. A dose mortelle (0 gr. 0001 à 0 gr.
0002 en injection chez la grenouille), on voit se produire
le ralentissement puis l’arrêt du coeur en diastole,
cet arrêt commençant par les oreillettes. Cn a
interprété ce phénomène de bien des façons, parfois
avec des expériences en apparence contradictoires
(Prévost, Alison, etc.). Le mécanisme est complexe.
Il y a d’abord, selon toute vraisemblance, une action
directe sur les centres d’a rrê t intracardiaques, parce
que, dit Beaunis, « l’exitation directe des ventricules
ramène les pulsations » (1). De plus, il doit se produire
une action sur les ganglions d’arrêt, parce que,
d ’après Schmiedeberg (2), la section des nerfs vagues
ne réveille pas les contractions. Il doit, enfin, s’agir
d’une excitation d’épuisementdes cellules ganglionnaires,
car, à dose faible, la muscarine produit plutôt
une accélération des battements du coeur, même après
(1) H. Beaunis, Nouveaux éléments de physiologie humaine, 3' édi-
lion, 1888, t. II, p. 860.
(2) Schmiedeberg. Das muscarin das giftige Alkalofd des Fliegen-
pilzes, Leipzig, 1869.
i
•p;
U.\
i
h