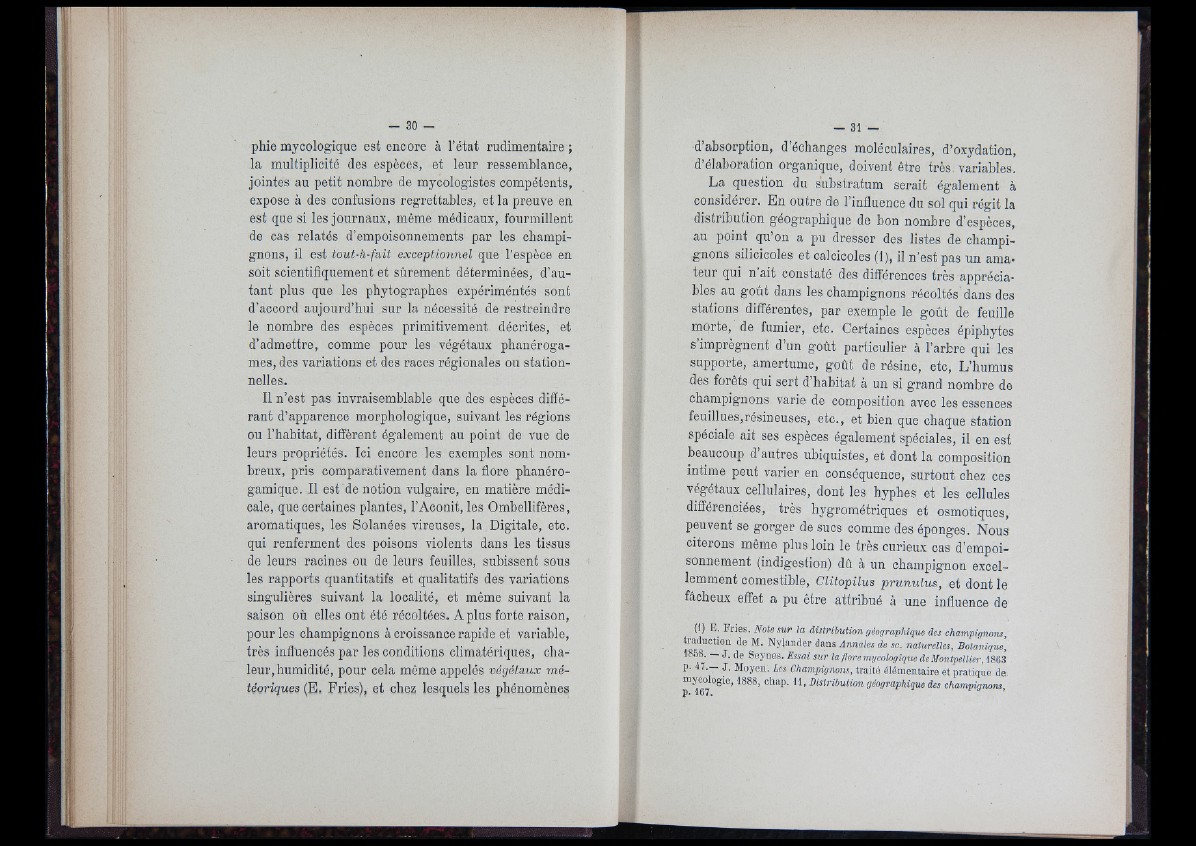
- S o phie
mycologique est encore à l’état rudimentaire ;
la multiplicité des espèces, et leur ressemblance,
jointes au petit nombre de mycologistes compétents,
expose à des confusions regrettables, et la preuve en
est que si les journaux, même médicaux, fourmillent
de cas relatés d’empoisonnements par les champignons,
il est tout-k-fait exceptionnel que l’espèce en
soit scientifiquement et sûrement déterminées, d'autant
plus que les phytographes expériméntés sont
d’accord aujourd’hui sur la nécessité de restreindre
le nombre des espèces primitivement décrites, et
d’admettre, comme pour les végétaux phanérogames,
des variations et des races régionales ou station-
nelles.
Il n ’est pas invraisemblable que des espèces différan
t d’apparence morphologique, suivant les régions
ou l’habitat, diffèrent également au point de vue de
leurs propriétés. Ici encore les exemples sont nombreux,
pris comparativement dans la flore phanéro-
gamique. Il est de notion vulgaire, en matière médicale,
que certaines plantes, l’Aconit, les Ombellifères,
aromatiques, les Solanées vireuses, la Digitale, etc.
qui renferment des poisons violents dans les tissus
de leurs racines ou de leurs feuilles, subissent sous
les rapports quantitatifs et qualitatifs des variations
singulières suivant la localité, et même suivant la
saison où elles ont été récoltées. A plus forte raison,
pour les champignons à croissance rapide et variable,
très influencés par les conditions climatériques, chaleur,
humidité, pour cela même appelés végétaux météoriques
(E, Fries), et chez lesquels les phénomènes
d’absorption, d’échanges moléculaires, d’oxydation,
d’élaboration organique, doivent être très variables.
La question du substratum serait également à
considérer. E n outre de l’influence du sol qui régit la
distribution géographique de bon nombre d’espèces,
au point qu’on a pu dresser des listes de champignons
silicicoles et calcicoles (1), il n ’est pas un amateur
qui n ait constaté des différences très appréciables
au goût dans les champignons récoltés dans des
stations différentes, par exemple le goût de feuille
morte, de fumier, etc. Certaines espèces épiphytes
s imprègnent d’un goût particulier à l’arbre qui les
supporte, amertume, goût de résine, etc. L ’humus
des forêts qui sert d’habitat à un si grand nombre de
champignons varie de composition avec les essences
feuillues,résineuses, etc., et bien que chaque station
spéciale ait ses espèces également spéciales, il en est
beaucoup d’autres ubiquistes, et dont la composition
intime peut varier en conséquence, surtout chez ces
végétaux cellulaires, dont les hyphes et les cellules
différenciées, très hygrométriques et osmotiques,
peuvent se gorger de sucs comme des éponges. Nous
citerons même plus loin le très curieux cas d’empoisonnement
(indigestion) dû à un champignon excellemment
comestible, Clitopilus prunulus, et dont le
fâcheux effet a pu être attribué à une influence de
(1) E. Fries. Note sur la distribution géographique des champignons,
traduction de M. Nyjander dans Annales de sc. naturelles. Botanique,
1858. — J . de Seynes. Essai sur la flore mycologique de Montpellier, 1863
p. 47.— J . Moyen. Les Champignons, traité élémentaire et pratique de.
mycologie, 1888, oliap. 11, Distribution géographique des champignons.