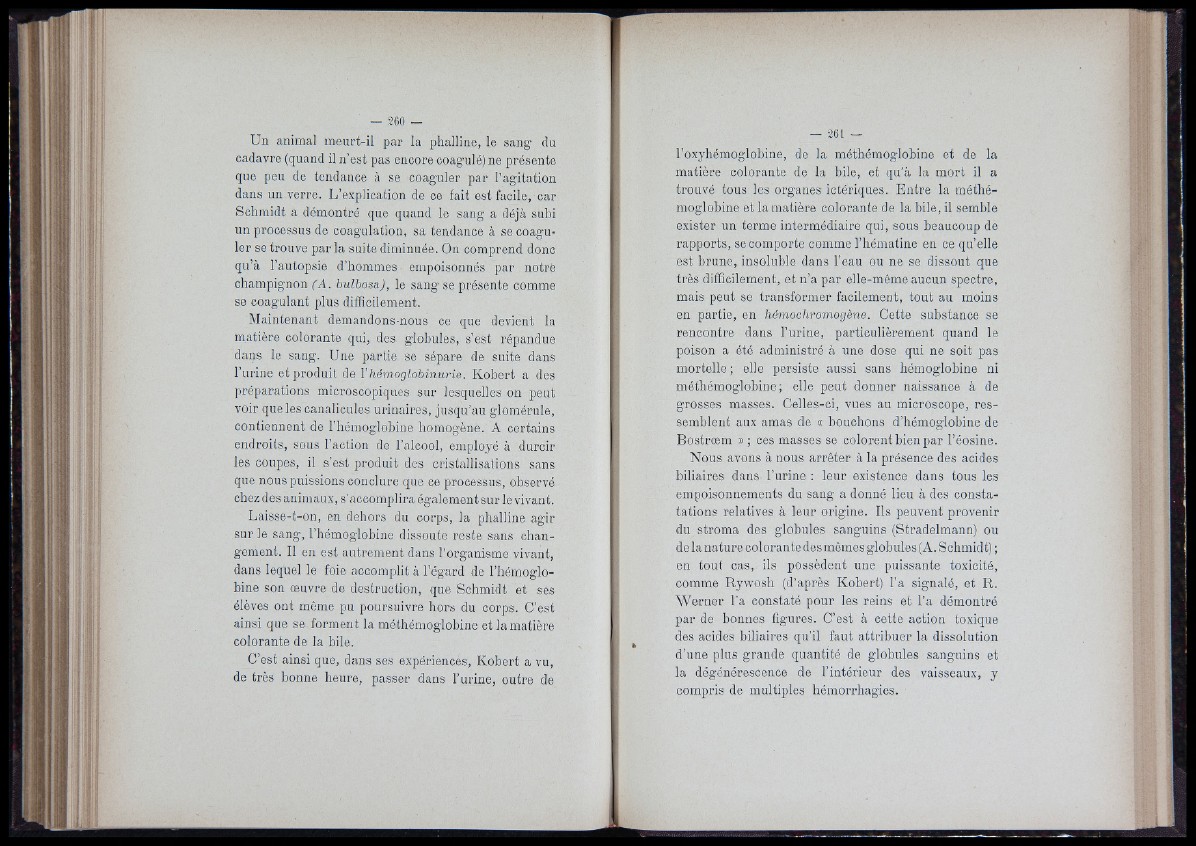
' f
Un animal meurt-il par la phalline, le sang du
cadavre (quand il n’est pas encore coagulé) ne présente
que peu de tendance à se coaguler par l’agitation
dans un verre. L ’explication de ce fait est facile, car
Schmidt a démontré que quand le sang a déjà subi
un processus de coagulation, sa tendance à se coaguler
se trouve par la suite diminuée. On comprend donc
qu’à l’autopsie d’hommes empoisonnés par notre
champignon (A. bulbosa), le sang se présente comme
se coagulant plus difficilement.
Maintenant demandons-nous ce que devient la
matière colorante qui, des globules, s’est répandue
dans le sang. Une partie se sépare de suite dans
l’urine et produit de Yhéxnoglobinurie. Kobert a des
préparations microscopiques sur lesquelles on peut
voir que les canalicules urinaires, jusqu’au glomérule,
contiennent de l’hémoglobine homogène. A certains
endroits, sous l’action de l ’alcool, employé à durcir
les coupes, il s’est produit des cristallisations sans
que nous puissions conclure que ce processus, observé
chez des animaux, s'accomplira également sur le vivant.
Laisse-t-on, en dehors du corps, la phalline agir
sur ie sang, l’hémoglobine dissoute reste sans changement.
Il en est autrement dans l’organisme vivant,
dans lequel le foie accomplit à l’égard de l’hémoglobine
son oeuvre de destruction, que Schmidt et ses
élèves ont même pu poursuivre hors du corps. C’est
ainsi que se forment la méthémoglobine et la matière
colorante de la bile.
C’est ainsi que, dans ses expériences, Kobert a vu,
de très bonne heure, passer dans l’urine, outre de
l ’oxyhémoglobine, de la méthémoglobine et de la
matière colorante de la bile, et qu’à la mort il a
trouvé tous les organes ictériques. Entre la méthémoglobine
et la matière colorante de la bile, il semble
exister un terme intermédiaire qui, sous beaucoup de
rapports, se comporte comme l’hématine en ce qu’elle
est brune, insoluble dans l’eau ou ne se dissout que
très difficilement, et n’a par elle-même aucun spectre,
mais peut se transformer facilement, tout au moins
en partie, en hémochromogène. Cette substance se
rencontre dans l’urine, particulièrement quand le
poison a été administré à une dose qui ne soit pas
mortelle ; elle persiste aussi sans hémoglobine ni
méthémoglobine; elle peut donner naissance à de
grosses masses. Celles-ci, vues au microscope, ressemblent
aux amas de « bouchons d’hémoglobine de
Bostroem » ; ces masses se colorent bien par l’éosine.
Nous avons à nous arrêter à la présence des acides
biliaires dans l’urine : leur existence dans tous les
empoisonnements du sang a donné lieu à des constatations
relatives à leur origine. Ils peuvent provenir
du stroma des globules sanguins (Stradelmann) ou
de la nature colorante des mêmes globules (A. Schmidt) ;
en tout cas, ils possèdent une puissante toxicité,
comme Rywosh (d’après Kobert) l’a signalé, et R.
W e rn e r l ’a constaté pour les reins et l’a démontré
par de bonnes figures. C’est à cette action toxique
des acides biliaires qu’il faut attribuer la dissolution
d’une plus grande quantité de globules sanguins et
la dégénérescence de l’intérieur des vaisseaux, y
compris de multiples ilémorrhagies.
d i •, r »
.