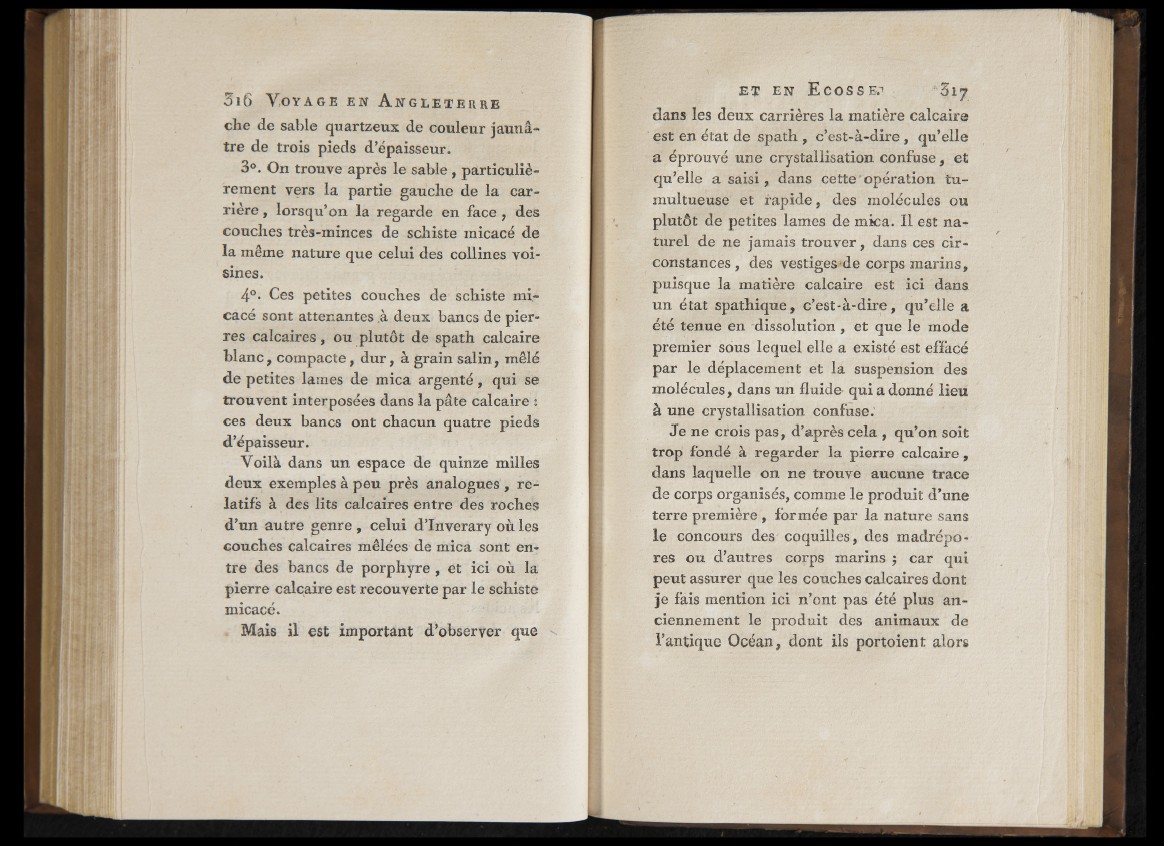
che de sable quartzeux de couleur jaunâtre
de trois pieds d’épaisseur.
3°. On trouve après le sable, particulièrement
vers la partie gauche de la carrière
, lorsqu’on la regarde en face , des
couches très-minces de schiste micacé de
la même nature que celui des collines voisines.
4°. Ces petites couches de schiste micacé
sont attenantes à deux bancs de pierres
calcaires, ou plutôt de spath calcaire
blanc, compacte, dur, à grain salin, mêlé
de petites lames de mica argenté, qui se
trouvent interposées dans la pâte calcaire :
ces deux bancs ont chacun quatre pieds
d’épaisseur.
Voilà dans un espace de quinze milles
deux exemples à peu près analogues , relatifs
à des lits calcaires entre des roches
d’un autre genre , celui d’Inverary où les
couches calcaires mêlées de mica sont entre
des bancs de porphyre, et ici où la
pierre calcaire est recouverte par le schiste
micacé.
Mais il est important d’observer que
dans les deux carrières la matière calcaire
est en état de spath , c’est-à-dire , qu’elle
a éprouvé une crystallisation confuse, et
qu’elle a saisi, dans cette * opération tumultueuse
et rapide, des molécules ou
plutôt de petites lames de mica. Il est naturel
de ne jamais trouver, dans ces circonstances,
des vestiges*de corps marins,
puisque la matière calcaire est ici dans
un état spathique, c’est-à-dire, qu’elle a
été tenue en dissolution, et que le mode
premier sous lequel elle a existé est effacé
par le déplacement et là suspension des
molécules, dans un fluide- qui a donné lieu
à une crystallisation confuse.
Je ne crois pas, d’après cela , qu’on soit
trop fondé à regarder la pierre calcaire ,
dans laquelle on ne trouve aucune trace
de corps organisés, comme le produit d’une
terre première , formée par la nature sans
le concours des coquilles, des madrépores
ou d’autres corps marins ; car qui
peut assurer que les couches calcaires dont
je fais mention ici n’ont pas été plus anciennement
le produit des animaux de
l’antique Océan, dont ils portoient alors