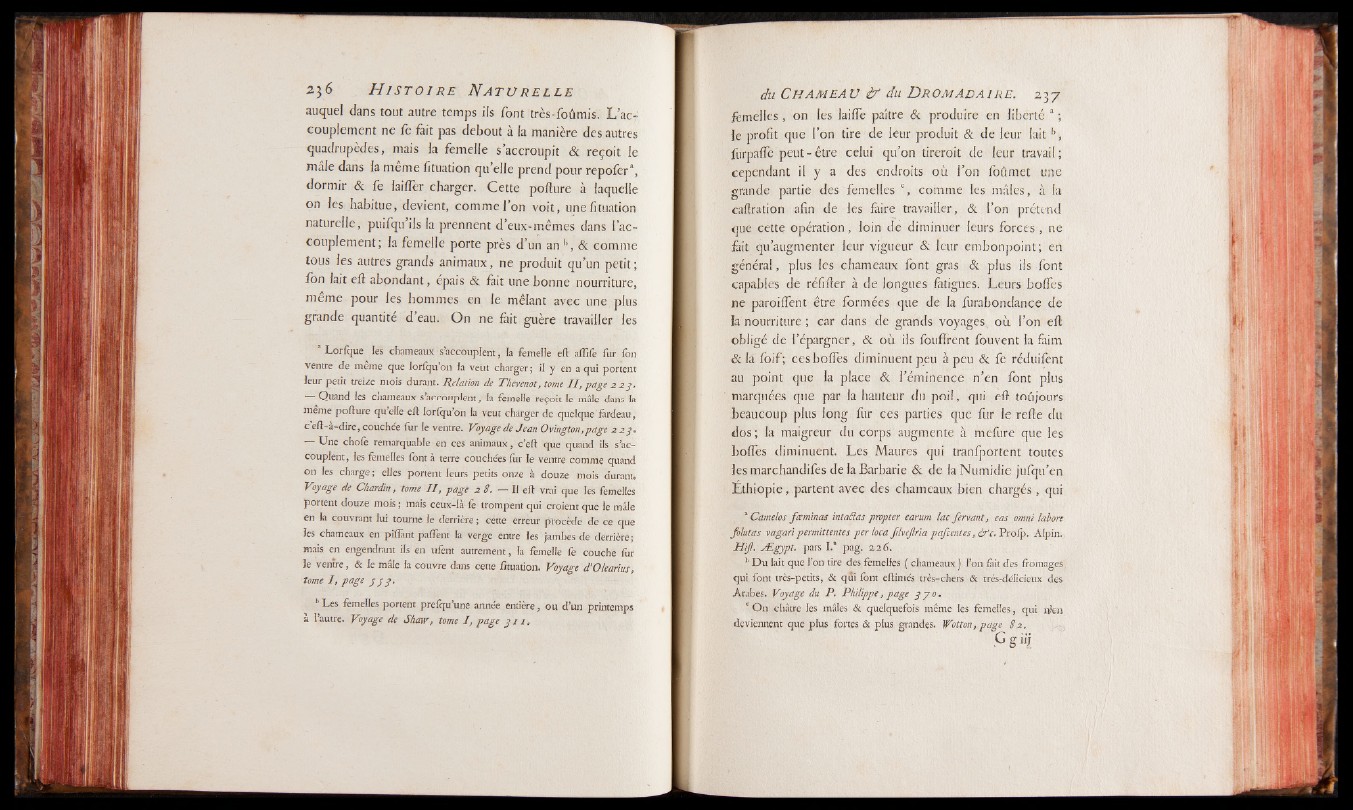
auquel dans tout autre temps ils font très-foûmis. L ’acT'
couplement ne fe fait pas debout à la manière des autres
quadrupèdes, mais la femelle s’accroupit & reçoit le
male dans la meme fituation qu’elle prend pour repofcra,
dormir 6c fe laiflèr charger. Cette pofture à laquelle
on les habitue, devient, comme l’on voit, une fituation
naturelle, puifqu’ils la prennent d’eux-mêmes dans l’accouplement;
la femelle porte près d’un an 11, 6c comme
tous les autres grands animaux, ne produit qu’un petit;
fort lait eft abondant, épais 6c fait une bonne nourriture,
même pour les hommes en le mêlant avec une plus
grande quantité d’eau. On ne fait guère travailler les
’ Lorfque les chameaux s’accouplent, la femelle eft aflife fur fon
ventre de meme que lorlqu’on fa veut charger ; il y en a qui portent
leur petit treize mois durant. Relation de Thevenot, tome I I , page 2 2 y.
— Quand fes chameaux s’accouplent, fa femelle reçoit le mâle dans la
même pofture qu’elle eft lorfqu’on la veut charger de quelque fardeau,
ceft-à-dire, couchée fur le ventre. Voyage de Jean Ovington,page 223.
— Une chofè remarquable en ces animaux, c’eft que quand ils s’accouplent,
les femelles font a terre couchées fur le ventre comme quand
on les charge; elles portent leurs petits onze à douze mois durant.
Voyage de Chardin, tome I I , page 2 8. — II eft vrai que les femelles
portent douze mois ; mais ceux-là fè trompent qui croient que le mâle
en la couvrant lui tourne le derrière ; cette erreur procède de ce que
les chameaux en piflànt pafîènt la verge entre les jambes de derrière;
mais en engendrant ils en ufent autrement, la femelle fe couche fur
le ventre, & le mâle la couvre dans cette fituation. Voyage d’Olearius,
tome I , page y y 3 .
b Les femelles portent prefqu’une année entière, ou d’un printemps
à l’autre. Voyage de Shaw, tome I , page 3 1 1 ,
du Ch a mea u ir du Dr omada ir e . 2 3 7
femelles, on les laide paître 6c produire en liberté a ;
le profit que l’on tire de leur produit 6c de leur laitb,
furpaffe peut - être celui qu’on tirerait de leur travail;
cependant il y a des endroits où l’on foûmet une
grande partie des femelles c, comme les mâles, à la
caftration afin de les faire travailler, 6c l’on prétend
que cette opération , loin de diminuer leurs forces , ne
fcit qu’augmenter leur vigueur 6c leur embonpoint; en
généra!, plus les chameaux font gras 6c plus ils font
capables de réfifter à de longues fatigues. Leurs boffes
ne paroiffent être formées que de Ja furabondance de
la nourriture ; car dans de grands voyages, où l’on eft
obligé de l’épargner, 6c où ils foufïrent fouvent la faim
6c la foif; ces boffes diminuent peu à peu 6c fe réduifent
au point que la place 6c l’éminence n’en font plus
marquées que par la hauteur du poil, qui eft toujours
beaucoup plus long fur ces parties que for le refte du
dos ; la maigreur du corps augmente à mefure que les
boffes diminuent. Les Maures qui tranfportent toutes
les marchandifes de la Barbarie 6c de laNumidie jufqu’en
Ethiopie, partent avec des chameaux bien chargés , qui
* Camelos feeminas intaélas propter earum lac ferrant, eas omni lahore
filmas vagari permittentes per loca füvejlria pafientes, àTc. Profjp. Alpin.
wmf, Ægypt. pars J.* pag. 226.
1: D u lait que l’on tire des femelles ( chameaux ' l’on fait des fromages-,
qui font très-petits, & qui font efljmés très-chers & très-déficieux des
Arabes. Voyage du P . Philippe, page 3 y 0.
c On châtre les mâles & quelquefois même les femelles, qui nfen
deviennent que plus fortes & plus grandes. JVotton, page 82.
1 g s i