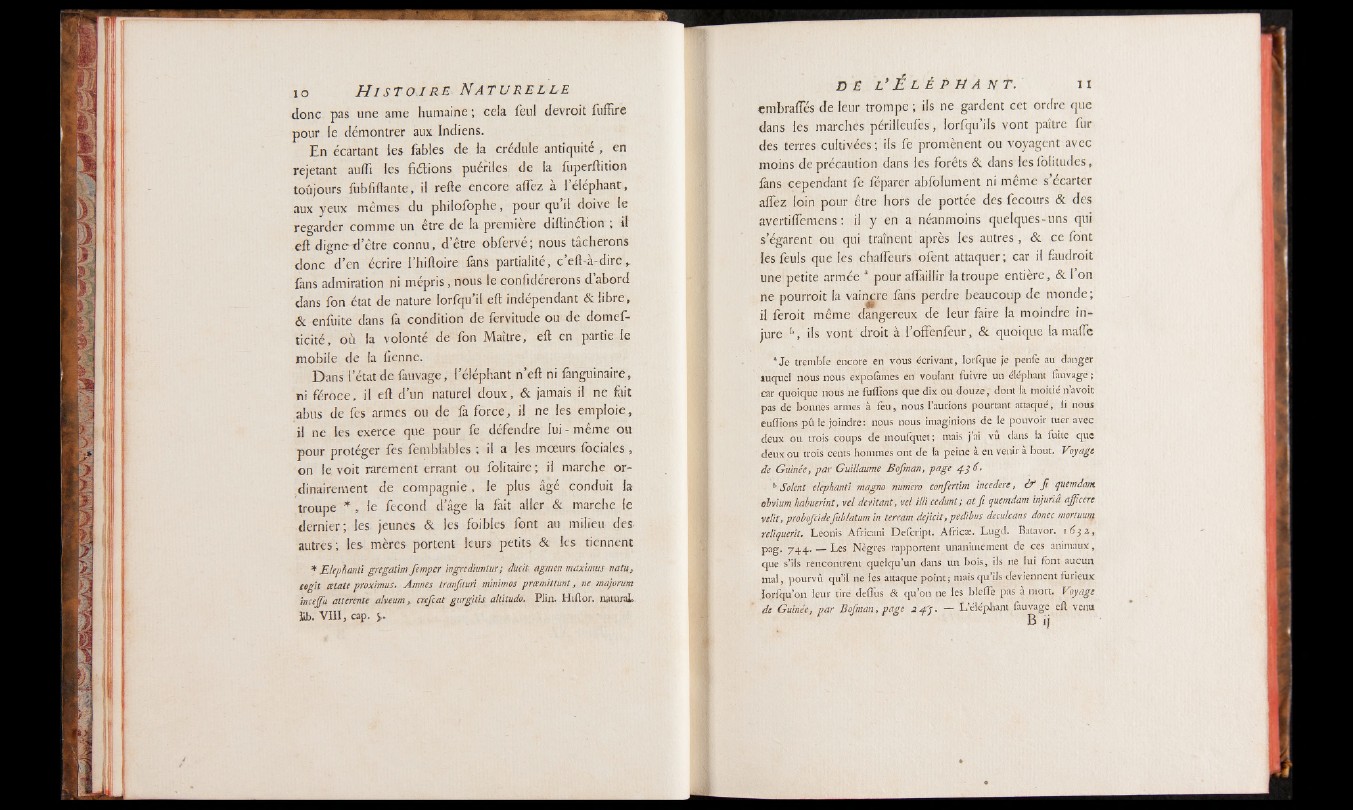
1 0 H i s t o i r e N a t u r e l l e
donc pas une ame humaine ; cela feul devrait fufEre
pour le démontrer aux Indiens.
En écartant les fables de la crédule antiquité , en
rejetant auïïi les frétions puériles de la fuperftition
toujours fubfiftante, il relie encore allez à l’éléphant,
aux yeux mêmes du philofophe, pour qu il doive le
regarder comme un être de la première diltinétion ; il
elt digne d ’être connu, d’être obfervé; nous tâcherons
donc d’en écrire l’hilloire fans partialité, c ’eft-à-dire,,
fans admiration ni mépris, nous le confidérerons d’abord
dans fon état de nature lorfqu’il elt indépendant & libre,
& enfuite dans fa condition de fervitude ou de domef-
ticité, où. la volonté de ion Maître, elt en partie le
mobile de la lienne.
Dans l’état de fauvage, l’éléphant n’efl ni fanguinaire,
ni féroce, il elt d’un naturel doux, & jamais il ne fait
abus de fes armes ou de fa force^ il ne les emploie,
11 ne les exerce que pour fe défendre lui - même ou
pour protéger fes femblabies ; il a les moeurs fociales,
on le voit rarement errant ou folitaire ; il marche ordinairement
de compagnie, le plus âgé conduit la
troupe * , le fécond d’âge la fait aller & marche le
dernier; les jeunes & les foibles font au milieu des-
autres; les mères portent leurs petits & les tiennent
* Elephanti gregatim femper ingrediuntur ; dùcit agmen maximus natu,
a g it Mate proximus. Amnes tranfüuri minimos proemittunt, ne majorura
incejju atterente alveumcrefçat gurgitis allitudo. Plin. Hiitor. naturaL
Jib. V III, cap. iembralTés
de leur trompe ; ils ne gardent cet ordre que
dans les marches périlleufes, lorfqu’ils vont paître fur
des terres cultivées; ils fe promènent ou voyagent avec
moins de précaution dans les forêts & dans les folitudes,
fans cependant fe féparer abfolument ni même s’écarter
alfez loin pour être hors de portée des fecours & des
avertiffemens : il y en a néanmoins quelques-uns qui
s’égarent ou qui trament après les autres, & ce font
lesfeuls que les chalfeurs ofent attaquer; car il faudrait
une petite armée a pour alfaillir la troupe entière, & 1 on
ne pourrait la vaincre fans perdre beaucoup de monde;
il ferait même dangereux de leur faire la moindre injure
b, ils vont droit à l’offenfeur, & quoique la maffe
’ J e tremble encore en vous écrivant, iorfque je penfe au danger
auquel nous nous expofames en voulant fuivre un éléphant lâuvage ;
car quoique nous ne fuifions que dix ou douze, dont la moitié navoit
pas de bonnes armes à feu, nous l’aurions pourtant attaqué, Ci nous
eullîons pû le joindre: nous nous imaginions de le pouvoir tuer avec
deux ou trois coups de inoufquet; mais j’ai vu dans la fuite que
deux ou trois cents hommes ont de la peine à en venir à bout. Voyage
de Guinée, par Guillaume Bofman, page 4 3 6.
b Soient elephanti magno numéro confertim incedere, & ft quemdam.
obvium habuerint, vel devitant, vel illi cedunt; at J ! quemdam injuria afficere
relit, probofcidefublatum in terram dejicit, pedibus deculcans donec mortuum
reliquerit. Leonis Africani Defcript. Africæ. Lugd. Batavor. 1 6 3 2 ,
pag. 7 4 4 . — Les Nègres rapportent unanimément de ces animaux,
que s’ils rencontrent quelqu’un dans un bois, ils ne lui font aucun
mal, pourvu qu’il ne les attaque point; mais qu’ils deviennent furieux
lorfqu’on leur tire deffits & qu’011 ne les bleffe pas à mort. Voyage
de Guinée, par Bofman, page 2 f y . — L ’éiéphant làuvage eft venu