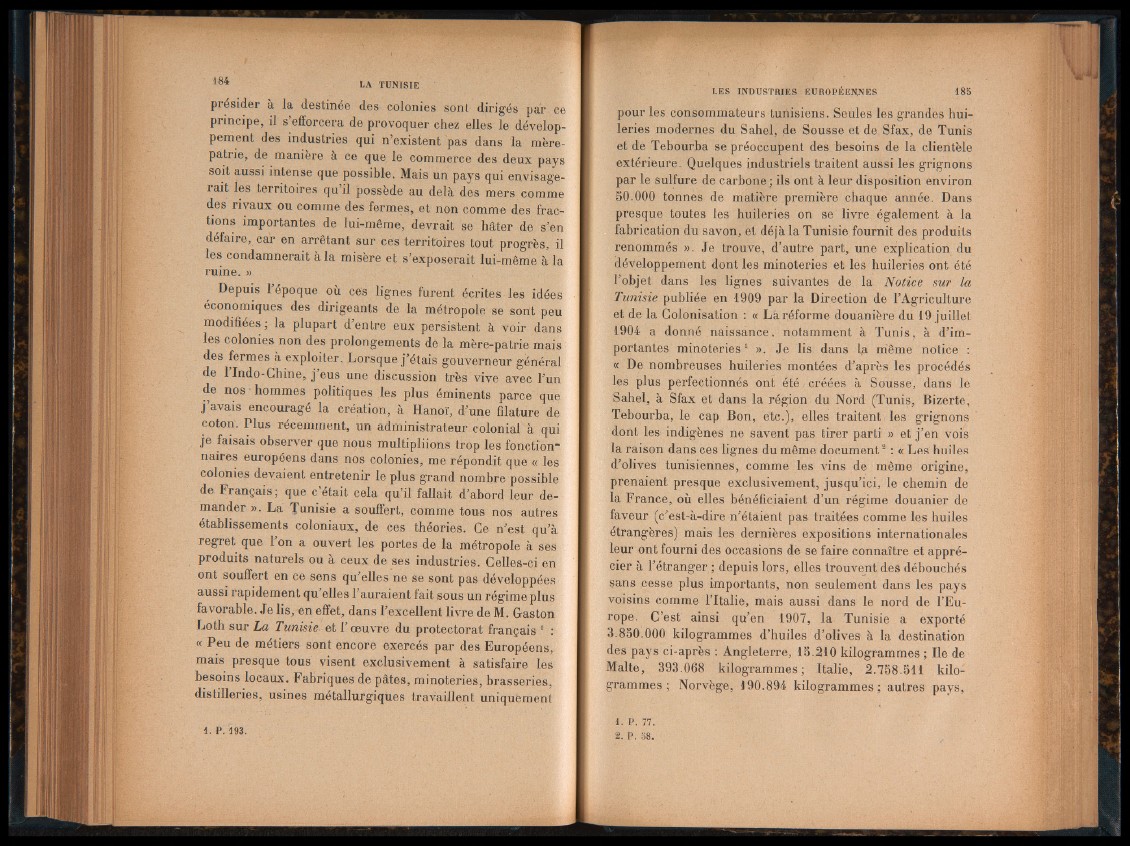
présider à la destinée des colonies sont dirigés par ce
principe, il s efforcera de provoquer chez elles le développement
des industries qui n’existent pas dans la mère-
patrie, de manière à ce que le commerce des deux pays
soit aussi intense que possible. Mais un pays qui envisagerait
les territoires qu’il possède au delà des mers comme
des rivaux ou comme des fermes, et non comme des fractions
importantes de lui-même, devrait se hâter de s’en
défaire, car en arrêtant sur ces territoires tout progrès, il
les condamnerait à la misère et s’exposerait lui-même à la
ruine. »
Depuis l’époque où ces lignes furent écrites les idées
économiques des dirigeants de la métropole se sorït peu
modifiées ; la plupart d’entre eux persistent à voir dans
les colonies non des prolongements dé la mère-patrie mais
des fermes à exploiter. Lorsque j ’étais gouverneur général
de 1 Indo-Chine, j ’eus une discussion très vive avec l’un
de nos hommes politiques les plus éminents parce que
j ’avais encouragé la création, à Hanoï, d’une filature de
coton. Plus récemment, un administrateur colonial à qui
je faisais observer que nous multipliions trop les fonctionnaires
européens dans nos colonies, me répondit que « les
colonies devaient entretenir le plus grand nombre possible
de Français ; que c’était cela qu’il fallait d’abord leur demander
». La Tunisie a souffert, comme tous nos autres
établissements coloniaux, de ces théories. Ce n’est qu’à
regret que 1 on a ouvert les portes de la métropole à ses
produits naturels ou à ceux de ses industries. Celles-ci en
ont souffert en ce sens qu elles ne se sont pas développées
aussi rapidement qu’elles l’auraient fait sous un régime plus
favorable. Je lis,-en effet, dans l’excellent livre de M. Gaston
Jjoth sur La Tunisie.-et l’oeuvre du protectorat français 1 :
« Peu de métiers sont encore exercés par des Européens,
mais presque tous visent exclusivement à satisfaire les
besoins locaux. Fabriques de pâtes, minoteries, brasseries,
distilleries, usines métallurgiques travaillent uniquement
pour les consommateurs tunisiens. Seules les grandes huileries
modernes du Sahel, de Sousse et de Sfax, de Tunis
et de Tebourba se préoccupent des besoins de la clientèle
extérieure. Quelques industriels traitent aussi les grignons
par le sulfure de carbone; ils ont à leur disposition environ
50.000 tonnes de matière première chaque année. Dans
presque toutes les huileries on se livre également à la
fabrication du savon, et déjà la Tunisie fournit des produits
renommés ». Je trouve, d’autre part, une explication du
développement dont les minoteries et les huileries ont été
l’objet dans les lignes suivantes de la Notice sur la
Tunisie publiée en 1909 par la Direction de l’Agriculture
et de la Colonisation : « La réforme douanière du 19 juillet
1904 a donné naissance, notamment à Tunis, à d’importantes
minoteries1 ». Je lis dans ba même notice :
« De nombreuses huileries montées d’après les procédés
les plus perfectionnés ont été , créées à Sousse, dans le
Sahel, à Sfax et dans la région du Nord (Tunis, Bizerte,
Tebourba, le cap Bon, etc.), elles traitent les grignons
dont les indigènes ne savent pas tirer parti » et j’en vois
la raison dans ces lignes du même document2 : « Les huiles
d’olives tunisiennes, comme les vins de même origine,
prenaient presque exclusivement, jusqu’ici, le chemin de
la France, où elles bénéficiaient d’un régime douanier de
faveur (c’est-à-dire n’étaient pas traitées comme les huiles
étrangères) mais les dernières expositions internationales
leur ont fourni des occasions de se faire connaître et apprécier
à l’étranger ; depuis lors, elles trouvent des débouchés
Sans cesse plus importants, non seulement dans les pays
voisins comme l’Italie, mais aussi dans le nord de l’Europe.
C’est ainsi qu’en 1907, la Tunisie a exporté
3.850.000 kilogrammes d’huiles d’olives à la destination
des pays ci-après : Angleterre, 15.210 kilogrammes ; Ile de
Malte, 393.068 kilogrammes; Italie, 2.758.511 kiln-
grammes ; Norvège, 190.894 kilogrammes; autres pays,
1. P. 77.
2. P . 58.