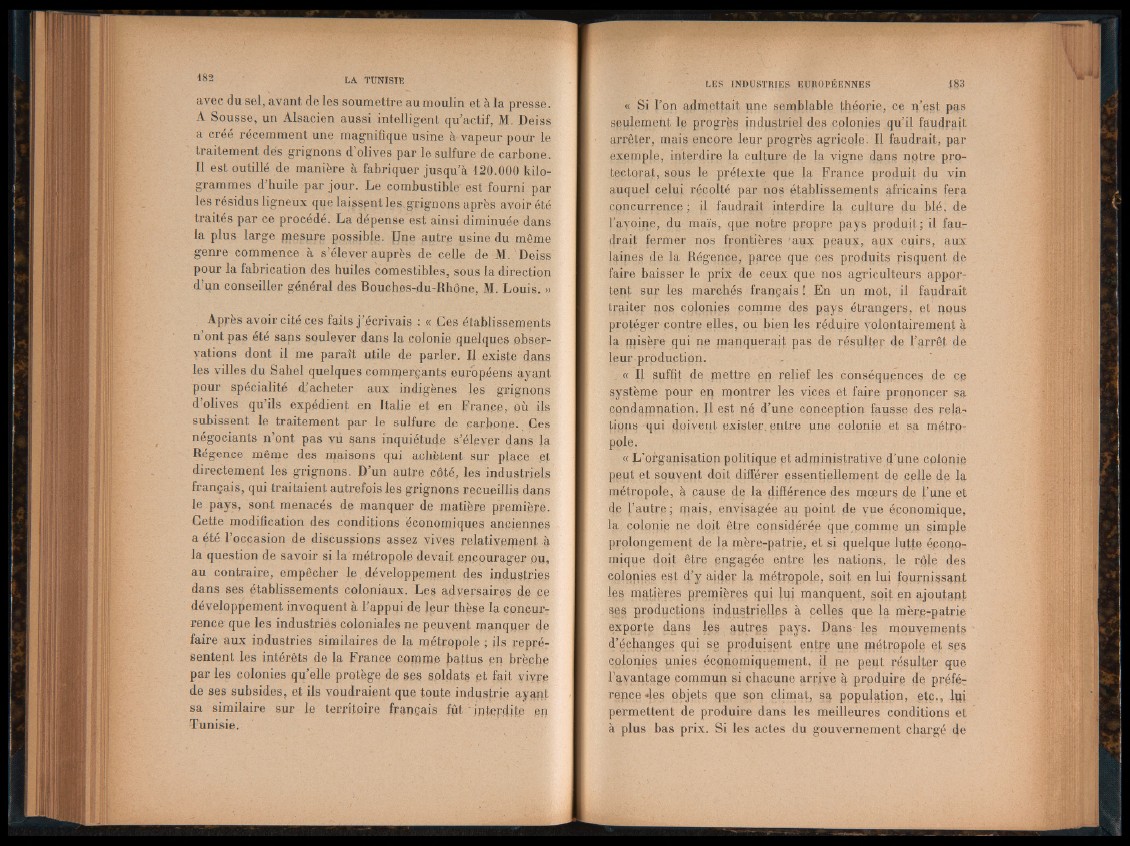
avec du sel, avant de les soumettre au moulin et à la presse.
A Sousse, un Alsacien aussi intelligent qu’actif, M. Deiss
a créé récemment une magnifique usine à vapeur poür le
traitement dés grignons d'olives par le sulfure de carbone.
Il est outillé de manière à fabriquer jusqu’à 120.000 kilogrammes
d’huile par jour. Le combustible est fourni par
les résidus ligneux que laissant les.grignons après avoir été
traités par ce procédé. La dépense est ainsi diminuée dans
la plus large piesjire possible. jQpe autre usine du même
genre commence à s’élever auprès de celle de M. Deiss
pour la fabrication des huiles comestibles, sous la direction
d’qn conseiller général des Bouches-du-Rhône, M. Louis. »
Après avoir cité ces faits j ’écrivais : « Ces établissements
n ont pas été saps soulever dans la colonie quelques observations
dont il me paraît utile de parler. Il existe dans
les villes du Sahel quelques commerçants européens ayant
pour spécialité d’acheter aux indigènes les grignons
d olives qu’ils expédient en Italie et en France, où ils
subissent le traitement par le sulfure de carbone. Ces
négociants n’ont pas vu sans inquiétude s’élever dans la
Régence même des maisons qui achètent sur place et
directement les grignons. D’un autre côté, les industriels
français, qui traitaient autrefois les grignons recueillis dans
le pays, sont menacés de manquer de matière première.
Cette modification des conditions économiques anciennes
a été l’occasion de discussions assez vives relativement à
la question de savoir si la métropole devait encourager pu,
au contraire, empêcher le développement des industries
dans ses établissements coloniaux. Les adversaires de ce
développement invoquent à l’appui de leur thèse la concurrence
que les industries coloniales ne peuvent manquer de
faire aux industries similaires de la métropole ; ils reprér
sentent les intérêts de la France comme Jiattus en brèche
par les colonies qu’elle protège de ses soldats et fait vivre
de ses subsides, et ils voudraient que toute industrie ayant
sa similaire sur le territoire français fût interdite en
Tunisie.
« Si l’on admettait une semblable théorie, °e n’est pas
seulemeht le progrès industriel des cplonies .qu’il faudrait
arrêter, mais encore leur progrès agricole. Il faudrait, par
exemple, interdire la culture de la vigne dans notre protectorat,
sops le prétexte que la France produit du vin
auquel celui récolté par nos établissements africains fera
concurrence ; il faudrait intprdire la culture du blé, de
l’avoine, du maïs, que notre propre pays produit; il faudrait
fermer nos frontières 'aux peaux, apx cpirs, aux
lames de la Régence, parce que pes produits risquent de
faire baisser le prix de ceux que nos agriculteurs apportent
sur les marchés français ! En un mot, il faudrait
traiter nos colonies pomme des pays étrangers, et nous
protéger contre elles, ou bien les réduire volontairement à
la misère qui ne maOquerait pas de résulter, de l’arrêt de
leur production-
. « Il suffit de mettre en relief les conséquences de ce
système pour et! montrer lps vices et faire prononcer sa
condamnation. J1 est né d’une conception fausse des relations
qui doivent exister, entre une colonie et sa métropole.
« L’organisation politique et administrative d’une colonie
peut et souvent doit différer essentiellement de celle de la
métropole, à cause de la différence des mfipurs de Tune pt
de l’autre; mais, envisagée ap point d® YUe économique,
la colonie ne dpit ûtpe cpnsidérée que,comme un simple
prolongement de la mère-patrie, et si quelque lutte économique
dpit être engagée entre les nations, le rûJê des
colonies est d’y aider la métropole, soit en lui fournissant
les matières premières qui lui manquent, soit en ajoutant
sgs productions industrielles à celles que la mère-patrie
exporte dans les autres pays. Dqns les mouvements
d’échanges qui se produisent entre une métropole et sps
cplonies unies économiquement, n ne peut résulter que
l'avantage commun si chacune arrive q produire de préfér
rencedes objets que son climat, sa PPpnlatipn, etc., lui
permettent de produire dans les meilleures conditions et
à plus bas prix. Si les actes du gouvernement chargé de