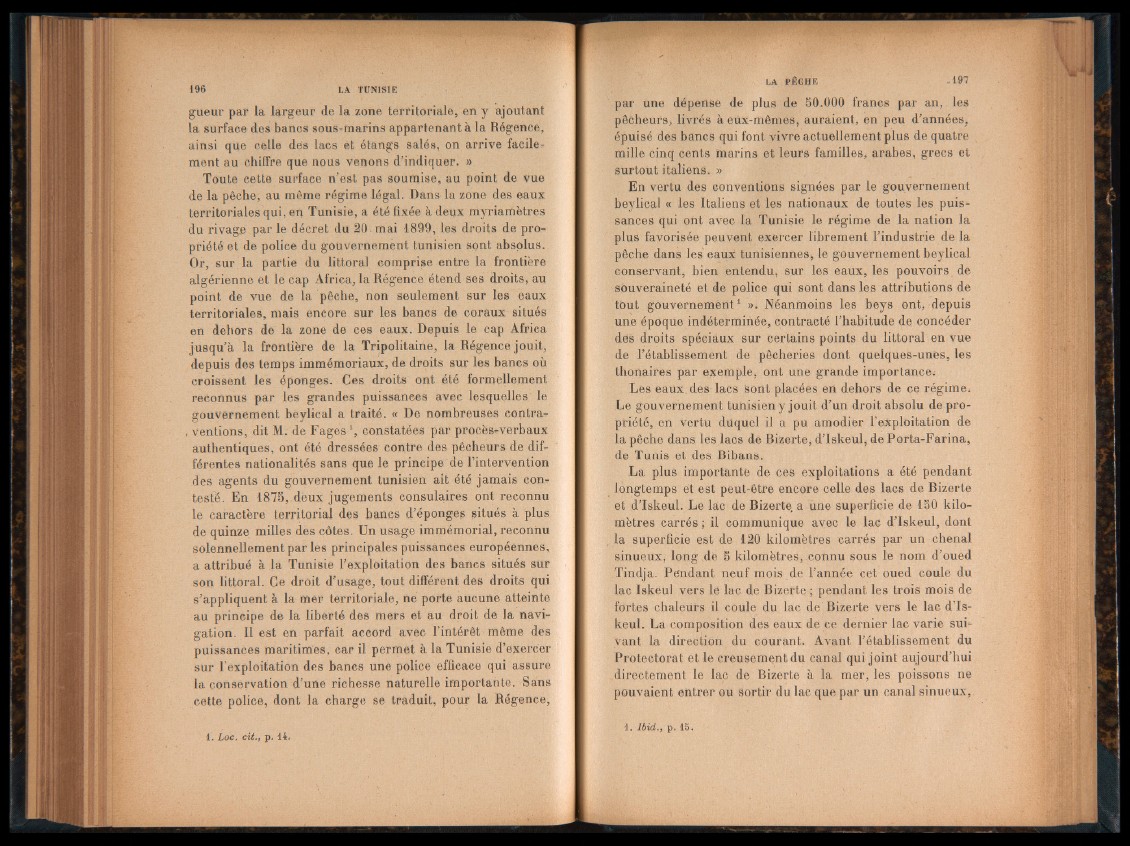
gueur par la largeur de la zone territoriale, en y ajoutant
la surface des bancs sous-marins appartenant à la Régence,
ainsi que celle dés lacs et étangs salés, on arrive facile-
ment au chiffre que nous venons d’indiquer. »
Toute cette surface n’est pas soumise, au point de vue
de la pêche, au même régime légal. Dans la zone des eaux
territoriales qui, en Tunisie, a été fixée à deux myriam'etres
du rivage par le décret du 20. mai 1899, les droits de propriété
et de police du gouvernement tunisien sont absolus.
Or, sur la partie du littoral comprise entre la frontière
algérienne et le cap Africa, la Régence étend ses droits, au
point de vue de la pêche, non seulement sur les eaux
territoriales, mais encore sur les bancs de coraux situés
en dehors de la zone de ces eaux. Depuis le cap Africa
jusqu’à la frontière de la Tripolitaine, la Régence jouit,
depuis des temps immémoriaux, de droits sur les bancs où
croissent les éponges. Ces droits ont été formellement
reconnus par les grandes puissances avec lesquelles le
gouvernement beylical a traité. « De nombreuses contraventions,
dit M. de Fages l, constatées par procès-verbaux
authentiques, ont été dressées contre des pêcheurs de différentes
nationalités sans que le principe de l’intervention
des agents du gouvernement tunisien ait été jamais contesté.
En 1875, deux jugements consulaires ont reconnu
le caractère territorial des bancs d’éponges situés à plus
de quinze milles des côtes. Un usage immémorial, reconnu
solennellement par les principales puissances européennes,
a attribué à la Tunisie l’exploitation des bancs situés sur
son littoral. Ce droit d’usage, tout différent des droits qui
s’appliquent à la mer territoriale, ne porte aucune atteinte
au principe de la liberté des mers et au droit de la navigation.
Il est en parfait accord avec l’intérêt même des
puissances maritimes, car il permet à la Tunisie d’exercer
sur l'exploitation des bancs une police efficace qui assure
la conservation d’une richesse naturelle importante. Sans
cette police, dont la charge se traduit, pour la Régence,
par une dépense de plus de 50.000 francs par an, les
pêcheurs, livrés à eux-mêmes, auraient, en peu d’années,
épuisé des bancs qui font vivre actuellement plus de quatre
mille cinq cents marins et leurs familles, arabes, grecs et
surtout italiens. »
En vertu des conventions signées par le gouvernement
beylical « les Italiens et les nationaux de toutes les puissances
qui ont avec la Tunisie le régime de la nation la
plus favorisée peuvent exercer librement l’industrie de la
pêche dans les' eaux tunisiennes^ le gouvernement beylical
conservant, bien entendu, sur les eaux, les pouvoirs de
souveraineté et de police qui sont dans les attributions de
tbut gouvernement1 ». Néanmoins les beys ont, depuis
une époque indéterminée, contracté l’habitude de concéder
des droits spéciaux sur certains points du littoral en vue
de l’établissement de pêcheries dont quelques-unes, les
thonaires par exemple, ont une grande importance.
Les eaux des lacs sont placées en dehors de ce régime.
Le gouvernement tunisien y jouit d’un droit absolu de propriété,
en vertu duquel il a pu amodier l’exploitation de
la pêche dans les lacs de Bizerte, d’Iskeul, de Porta-Farina,
de Tunis et des Bibans.
La plus importante de ces exploitations a été pendant
longtemps et est peut-être encore celle des lacs de Bizerte
et d’Iskeul. Le lac de Bizerte, a une superficie de 150 kilomètres
carrés ; il communique avec le lac d’Iskeul, dont
la superficie est de 120 kilomètres carrés par un chenal
sinueux, long de 5 kilomètres; connu sous le nom d’oued
Tindja. Pendant neuf mois de l’année cet oued coule du
lac Iskeul vers le lac de Bizerte ; pendant les trois mois de
fortes chaleurs il coule du lac de Bizerte vers le lac d’Is-
keul. La composition des eaux de ce dernier lac varie suivant
la direction du courant. Avant l’établissement du
Protectorat et le creusement du canal qui joint aujourd’hui
directement le lac de Bizerte à la mer, les poissons ne
pouvaient entrer ou sortir du lac que par un canal sinueux,
4. IbicL., p. 15.