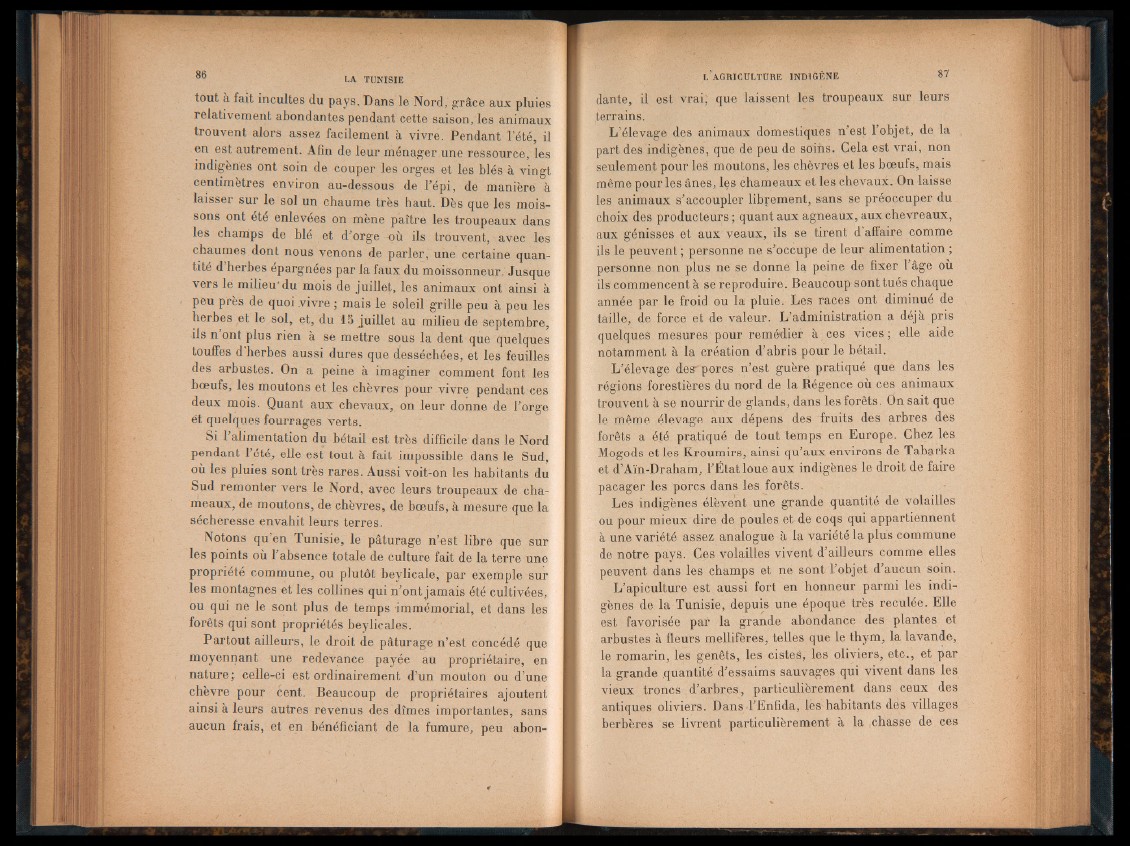
tout à fait incultes du pays. Dans le Nord, grâce aux pluies
relativement abondantes pendant cette saison, les animaux
trouvent alors assez facilement à vivre. Pendant l ’été, il
en est autrement. Afin de leur ménager une ressource, les
indigènes ont soin de couper les orges et les blés à vingt
centimètres environ au-dessous de l’épi, de manière à
laisser sur le sol un chaume très haut. Dès que les moissons
ont été enlevées on mène paître les troupeaux dans
les champs de blé et d’orge nù ils trouvent, avec les
chaumes dont nous venons de parler, une certaine quantité
d herbes épargnées par la faux du moissonneur, jusque
vers le milieu'du mois de juillet, les animaux ont ainsi à
peu près de quoi vivre ; mais le soleil grille peu à peu les
herbes et le sol, et, du 15 juillet au milieu de septembre,
ils n ont plus rien à se mettre sous la dent que quelques
touffes d herbes aussi dures que desséchées, et les feuilles
des arbustes. On a peine à imaginer comment font les
boeufs, les moutons et les chèvres pour vivre pendant ces
deux mois. Quant aux chevaux, on leur donne de l’orge
et quelques fourrages verts.
Si 1 alimentation du bétail est très difficile dans le Nord
pendant l’été, elle est tout à fait impossible dans le Sud,
où les pluies sont très rares. Aussi voit-on les habitants du
Sud remonter vers le Nord, avec leurs troupeaux de chameaux,
de moutons, de chèvres, de boeufs, à mesure que la
sécheresse envahit leurs terres.
Notons qu’en Tunisie, le pâturage n’ost libre que sur
les points où 1 absence totale de culture fait de la terre une
propriété commune, ou plutôt bevlicale, par exemple sur
les montagnes et les collines qui n’ont jamais été cultivées,
ou qui ne le sont plus de temps immémorial, et dans les
forêts qui sont propriétés beylicales.
Partout ailleurs, le droit de pâturage n’est concédé que
moyennant une redevance payée au propriétaire, en
nature; celle-ci est ordinairement d’un mouton ou d’une
chèvre pour cent. Beaucoup de propriétaires ajoutent
ainsi à leurs autres revenus des dîmes importantes, sans
aucun frais, et en bénéficiant de la fumure, peu abondante,
il est vrai; que laissent les troupeaux sur leurs
terrains.
L’élevage des animaux domestiques n’est l’objet, de la
part des indigènes, que de peu de soins. Cela est vrai, non
seulement pour les moutons, les chèvres et les boeufs, mais
même pour les ânes, les chameaux et les chevaux. On laisse
les animaux s’accoupler librement, sans se préoccuper du
choix des producteurs ; quant aux agneaux, aux chevreaux,
aux génisses et aux veaux, ils se tirent d’affaire comme
ils le peuvent ; personne ne s’occupe de leur alimentation ;
personne non plus ne se donne la peine de fixer l’âge où
ils commencent à se reproduire. Beaucoup sont tués chaque
année par le froid ou la pluie. Les races ont diminué de
taille, de force et de valeur. L’administration a déjà pris
quelques mesures pour remédier à ces vices; elle aide
notamment à la création d’abris pour le bétail.
L’élevage des" porcs n’est guère pratiqué que dans les
régions forestières du nord de la Régence où ces animaux
trouvent à se nourrir de glands, dans les forêts. On sait que
le même élevage aux dépens des fruits des arbres des
forêts a été pratiqué de tout temps en Europe. Chez les
Mogods et les Kroumirs, ainsi qu’aux environs de Tabarka
et d’Aïn-Draham, l’État loue aux indigènes le droit de faire
pacager les porcs dans les forêts.
Les indigènes élèvent une grande quantité de volailles
ou pour mieux dire de poules et de coqs qui appartiennent
à une variété assez analogue à la variété la plus commune
de notre pays. Ces volailles vivent d’ailleurs comme elles
peuvent dans les champs et ne sont l’objet d’aucun soin.
L’apiculture est aussi fort en honneur parmi les indigènes
de la Tunisie, depuis une époque très reculée. Elle
est favorisée par la grande abondance des plantes et
arbustes à fleurs mellifères, telles que le thym, la lavande,
le romarin, les génêts, les cistes, les oliviers, etc., et par
la grande quantité d’essaims sauvages qui vivent dans les
vieux troncs d’arbres, particulièrement dans ceux des
antiques oliviers. Dans l’Enfida, lès habitants des villages
berbères se livrent particulièrement à la chasse de ces