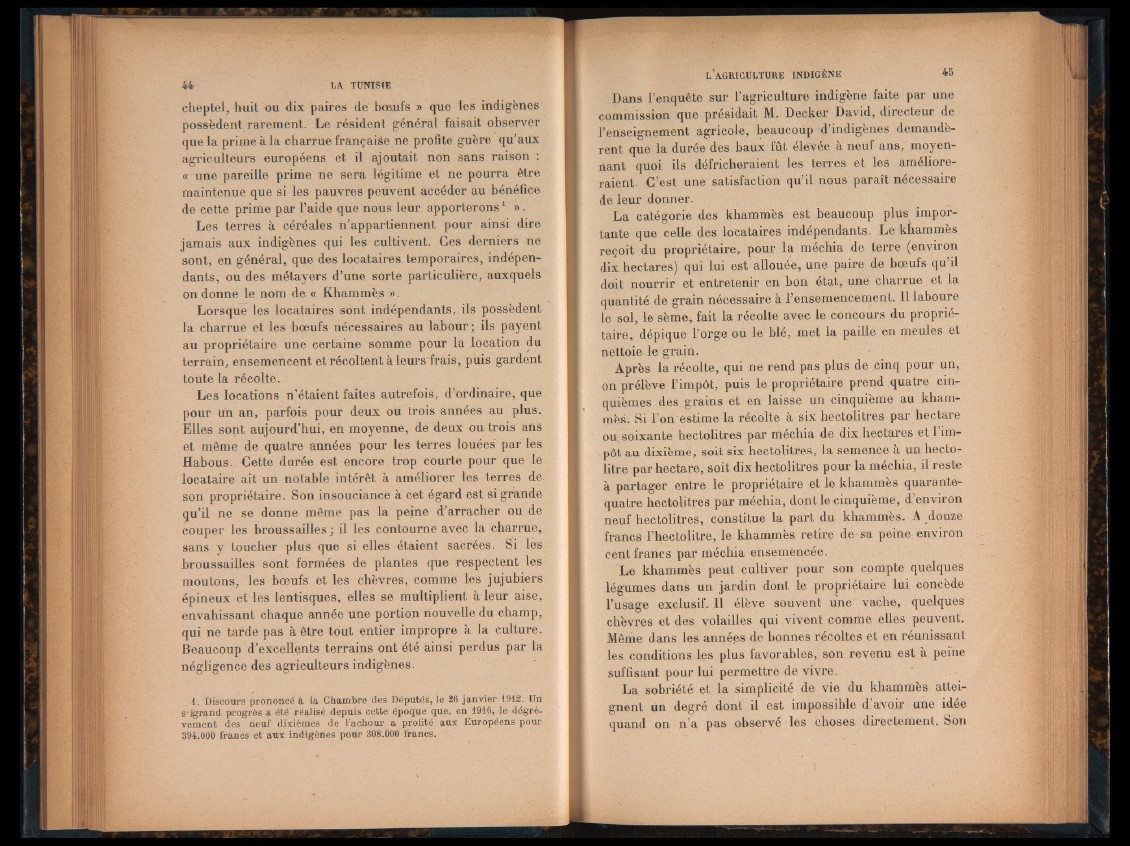
cheptel, huit ou dix paires de boeufs » que les indigènes
possèdent rarement. Le résident général faisait observer
que la prime à la charrue française ne profite guère qu'aux
agriculteurs européens et il ajoutait non sans raison :
« une pareille prime ne sera légitime et ne pourra être
maintenue que si les pauvres peuvent accéder au bénéfice
de cette prime par l’aide que nous leur apporterons1 ».
Les terres à céréales n’appartiennent pour ainsi dire
jamais aux indigènes qui les cultivent. Ces derniers ne
sont, en général, que des locataires temporaires, indépendants,
ou des métayers d’une sorte particulière, auxquels
on donne le nom de « Khammès ».
Lorsque les locataires sont indépendants, ils possèdent
la charrue et les boeufs nécessaires au labour; ils payent
au propriétaire une certaine somme pour la location du
terrain, ensemencent et récoltent à leurs frais, puis gardent
toute la récolte.
Les locations n’étaient faites autrefois, d’ordinaire, que
pour Un an, parfois pour deux ou trois années au plus.
Elles sont aujourd’hui, en moyenne, de deux ou trois ans
et même de quatre années pour les terres louées parles
flabous. Cette durée est encore trop courte pour que le
locataire ait un notable intérêt à améliorer les terres de
son propriétaire. Son insouciance à cet égard est si grande
qu’il ne se donne même pas la peine d’arracher ou de
couper les broussailles ; il les contourne avec la charrue,
sans y toucher plus que si elles étaient sacrées. Si les
broussailles sont formées de plantes que respectent les
moutons, les boeufs et les chèvres, comme les jujubiers
épineux et les lentisques, elles se multiplient à leur aise,
envahissant chaque année une portion nouvelle du champ,
qui ne tarde pas à être tout entier impropre à la culture.
Beaucoup d’excellents terrains ont été ainsi perdus par la
négligence des agriculteurs indigènes.
1. Discours prononcé à la Chambre des Députés, le 26 janvier 1912. Un
s-igrand progrès a été réalisé depuis cette époque que, en 1916, le dégrèvement
des neuf dixièmes de l’achour a profité aux Européens pour
394.000 francs et aux indigènes pour 308.000 francs.
Dans l’enquête sur l’agriculture indigène faite par une
commission que présidait M. Decker David, directeur de
l’enseignement agricole, beaucoup d’indigènes demandèrent
que la durée des baux fût élevée à neuf ans, moyennant
quoi ils défricheraient les terres et les amélioreraient.
C’est une satisfaction qu’il nous paraît nécessaire
de leur donner.
La catégorie des khammès est beaucoup plus importante
que celle des locataires indépendants. Le khammès
reçoit du propriétaire, pour la méchia de terre (environ
dix hectares) qui lui est allouée, une paire de boeufs qu il
doit nourrir et entretenir en bon état, une charrue et la
quantité de grain nécessaire à l’ensemencement. 11 laboure
le sol, le sème, fait la récolte avec le concours du propriétaire,
dépique l’orge ou le blé, met la paille en meules et
nettoie le grain.
Après la récolte, qui ne rend pas plus de cinq pour un,
on prélève l’impôt, puis le propriétaire prend quatre cinquièmes
des grains et en laisse un cinquième au khammès.
Si l’on estime la récolte à six hectolitres par hectare
ou soixante hectolitres par mechia de dix hectares et 1 impôt
au dixième, soit six hectolitres, la semence à un hectolitre
par hectare, soit dix hectolitres pour la méchia, il reste
à partager entre le propriétaire et le khammès quarante-
quatre hectolitres par méchia, dont le cinquième, d’environ
neuf hectolitres, constitue la part du khammès. A douze
francs l’hectolitre, le khammès retire de sa peine environ
cent francs par méchia ensemencée.
Le khammès peut cultiver pour son compte quelques
légumes dans un jardin dont le propriétaire lui concède
l’usage exclusif. Il élève souvent une vache, quelques
chèvres et des volailles qui vivent comme elles peuvent.
Même dans les anné.es de bonnes récoltes et en réunissant
les conditions les plus favorables, son revenu est à peine
suffisant pour lui permettre de vivre.
La sobriété et la simplicité de vie du khammès atteignent
un degré dont il est impossible d avoir une idee
quand on n’a pas observé les choses, directement. Son