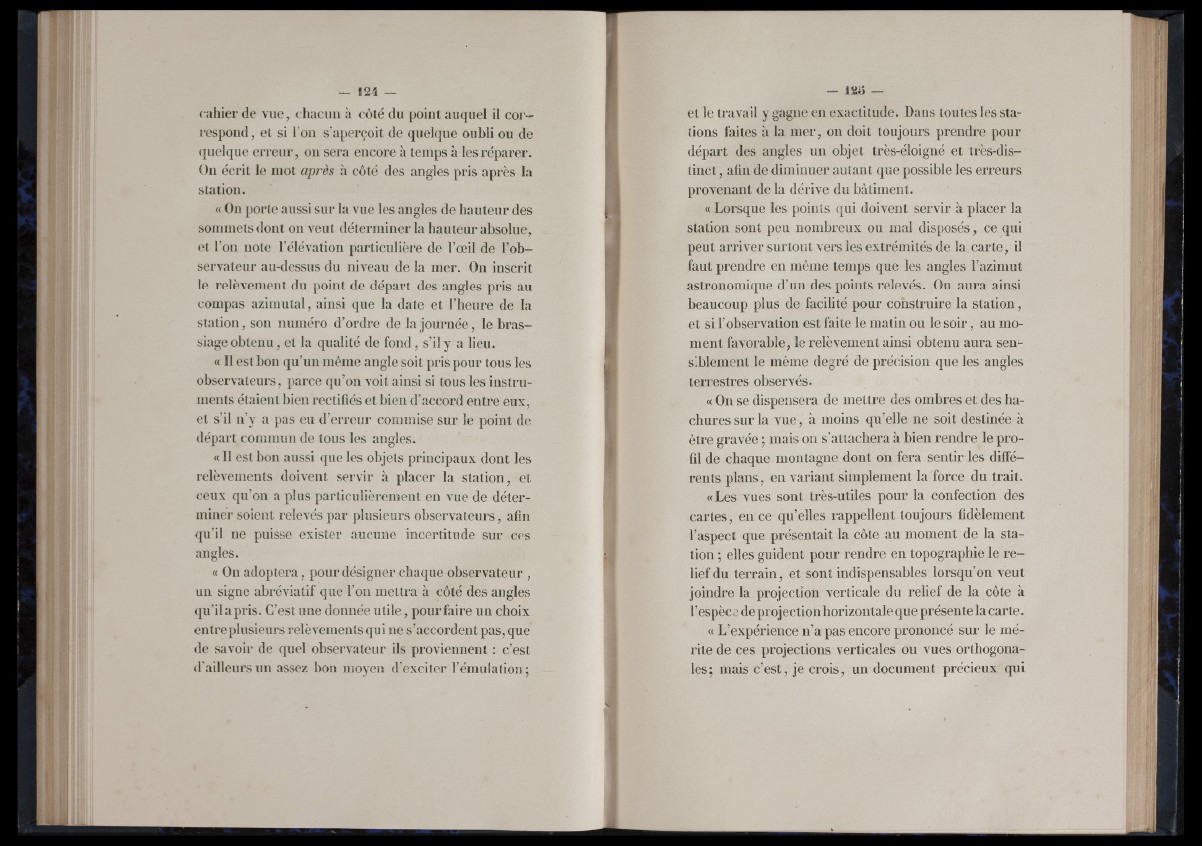
cahier de vue, cliacuii à côté du point auquel il correspond,
et si l'on s’aperçoit de quelque oubli ou de
(juclque e rre u r, ou sera encore à temps à les réparer-.
On écrit le mot après k côté des angles pris après la
station.
« On porte aussi sur la vue les angles de Inmteur des
sommets dont on veut déterminer la hauteur absolue,
et l’on note l’élévation particulière de l’oeil de l’observateur
au-dessus du niveau de la mer. On inscrit
le relèvement du point de départ des angles pris au
compas azimutal, ainsi que la date et l’heure de la
station, son numéi’O d’ordre de la jo u rn é e , le b ra s-
siage o b ten u , el la qualité de fond, s’il y a lieu.
« Il est bon q u ’un même angle soit pris pour tous les
observateurs, pai-ce qu’on voit ainsi si tous les in stru ments
étaient bien rectifiés et bien d’accord entre eux,
et s’il n ’y a pas en d’e rreu r commise sur le point de
départ commun de tous les angles.
« Il est bon aussi que les objets principaux dont les
relèvements doivent servir à placer la station, et
ceux qu’on a plus particulièrement en vue de déterminer
soient relevés par plusieurs observateurs, afin
qu’il ne puisse exister aucune incertitude sur ces
angles.
« On ad o p te ra , pour désigner chaque observateur ,
un signe abréviatif que l’on mettra à côté des angles
qu’il a pris. C’est une donnée u tile , pour faire un choix
entre plusieurs relèvements qui ne s ’accordent pas, que
de savoir de quel observateur ils proviennent : c’est
d'ailleurs un assez bon moyen d’exciter l’émulation;
et le travail y gagne en exactitude. Dans toutes les stations
faites à la m e r, on doit toujours prendre pour
départ des angles un objet très-éloigné et très-distinct
, afin de diminuer autant que possible les erreurs
provenant de la dérive du bâtiment.
« Lorsque les points qui doivent servir à placer la
station sont peu nombreux ou mai disposés, ce qui
peut arriver surtout vers les extrémités de la c arte, il
faut prendre en même temps que les angles l’azimut
astronomique d’un des points relevés. On aura ainsi
beaucoup plus de facilité pour construire la sta tio n ,
et si l’observation est faite le matin ou le so ir , au moment
favorable, le relèvement ainsi obtenu aura sensiblement
le même degré de précision que les angles
terrestres observés.
« On se dispensera de mettre des ombres et des hachures
sur la v u e , à moins qu’elle ne soit destinée à
être gravée ; mais on s’attachera k bien rendre le profil
de chaque montagne dont on fera sentir les différents
p lan s, en variant simplement la force du trait.
« Les vues sont très-utiles pour la confection des
c artes, en ce qu’elles rappellent toujours fidèlement
l’aspect que présentait la côte au moment de la station
; elles guident pour rendre en topographie le re lief
du te rra in , et sont indispensables lorsqu’on veut
joindre la projection verticale du relief de la côte à
l’espèca de projection horizontale que présente la carte.
« L’expérience n ’a pas encore prononcé sur le mérite
de ces projections verticales ou vues orthogonales;
mais c’e st, je crois, un document précieux qui