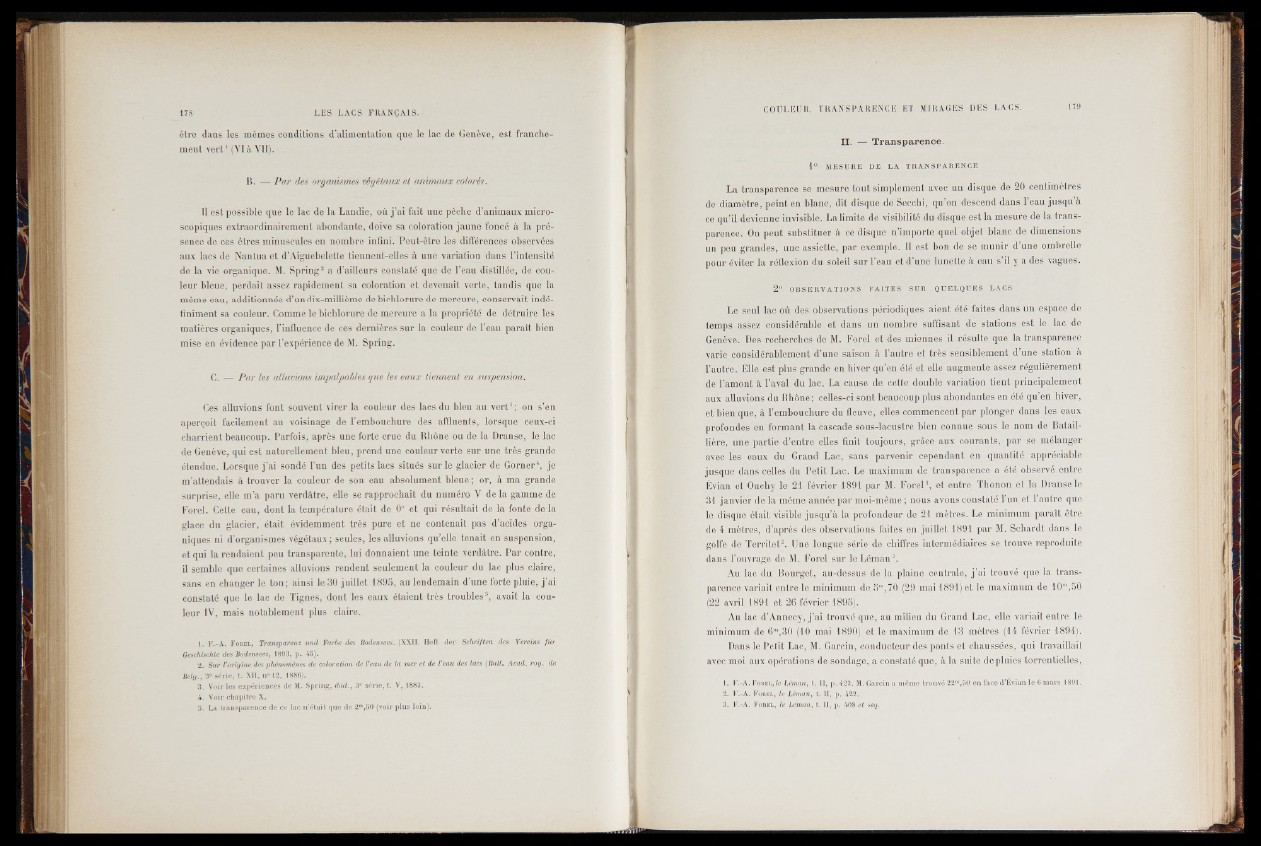
être dans les mêmes conditions d'alimentation que le lac de Genève, est franchement
vert1 (VI à, VII).
B. — Par des organismes végétante et animaux colorés.
Il est possible que le lac de la Landie, où j ’ai fait une pêche d’animaux microscopiques
extraordinairement abondante, doive sa coloration jaune foncé à la présence
de ces êtres minuscules en nombre infini. Peut-être les différences observées
aux lacs de Nantua et d’Aiguebelette tiennent-elles à une variation dans l’intensité
de la vie organique. M. Spring2 a d’ailleurs constaté que de l’eau distillée, de couleur
bleue, perdait assez rapidement sa coloration et devenait verte, tandis que la
même eau, additionnée d’un dix-millième debichlorure de mercure, conservait indéfiniment
sa couleur. Comme le bichlorure de mercure a la propriété de détruire les
matières organiques, l’influence de ces dernières sur la couleur de l’eau paraît bien
mise en évidence par l ’expérience de M. Spring.
C. — Par les alluvions impalpables que les eaux tiennent en suspension.
Ces alluvions font souvent virer la couleur des lacs du bleu au vert3 ; on s’en
aperçoit facilement au voisinage de l’embouchure des affluents, lorsque ceux-ci
charrient beaucoup. Parfois, après une forte crue du Rhône ou de la Dranse, le lac
de Genève, qui est naturellement bleu, prend une couleur verte sur une très grande
étendue. Lorsque j ’ai sondé l’un des petits lacs situés sur le glacier de Gorner4, je
m’attendais à trouver la couleur de son eau absolument bleue ; or, à ma grande
surprise, elle m’a paru verdâtre, elle se rapprochait du numéro V de la gamme de
Forel. Cette eau, dont la température était de 0° et qui résultait de la fonte de la
glace du glacier, était évidemment très pure et ne contenait pas d’acides organiques
ni d’organismes végétaux ; seules, les alluvions qu’elle tenait en suspension,
et qui la rendaient peu transparente, lui donnaient une teinte verdâtre. Par contre,
il semble que certaines alluvions rendent seulement la couleur du lac plus claire,
sans en changer le ton; ainsi le 30 juillet 1895, au lendemain d’une forte pluie, j ’ai
constaté que le lac de Tignes, dont les eaux étaient très troubles5, avait la couleur
IV, mais notablement plus claire.
1. F .-A . F orel, Tran sp a rent u nd Farbe des Bodensees. (XXII. Heft d e r S chriften des Vereins fu r
Geschischie des Bodensees, 1893, p . 45).
2 . S ur F origin e des phénomènes de coloration de Veau d e la mer e t de Veau des lacs (Bull. A ca d . r o y . de
B e lg ., 3« s é r ie , t. XII, n» 1 2 , 1886).
3 . V o ir le s e x p é r ien c e s d e M. S pr in g , ib id ., 3® s é r ie , t. V, 1883.
4. Voir ch a p itr e X.
5. La tr ansp a renc e d e c e la c n ’é ta it q u e de 2“ ,5 0 (voir p lu s lo in ).
n . — Transparence.
1°- M E SU R E D E LA T R A N S P A R E N C E
La transparence se mesure tout simplement avec un disque de 20 centimètres
de diamètre, peint en blanc, dit disque de Secchi, qu’on descend dans l’eau jusqu’à
ce qu’il devienne invisible. La limite de visibilité du disque est la mesure de la transparence.
On peut substituer à ce disque n’importe quel objet blanc de dimensions
un peu grandes, une assiette, par exemple. Il est bon de se munir d’une ombrelle
pour éviter la réflexion du soleil sur l’eau et d’une lunette à eau s’il y a des vagues.
2° O B S E R V A T IO N S F A IT E S SU R Q U E L Q U E S L A C S
Le seul lac où des observations périodiques aient été faites dans un espace de
temps assez considérable et dans un nombre suffisant de stations est le lac de
Genève. Des-recherches de M. Forel et des miennes il résulte que la transparence
varie considérablement d’une saison à l’autre et très sensiblement d’une station à
l’autre. Elle est plus grande en hiver qu’en été et elle augmente assez régulièrement
de l’amont à l’aval du lac. La cause de cette double variation tient principalement
aux alluvions du Rhône; celles-ci sont beaucoup plus abondantes en été qu’en hiver,
et bien que, à l’embouchure du fleuve, elles commencent par plonger dans les eaux
profondes en formant la cascade sous-lacustre bien connue sous le nom de Batail-
lière, une partie d’entre elles finit toujours, grâce aux courants, par se mélanger
avec les eaux du Grand Lac, sans parvenir cependant en quantité appréciable
jusque dans celles du Petit Lac. Le maximum de transparence a été observé entre
Évian et Ouchy le 21 février 1891 par M. Forel*, et entre Thonon et la Dranse le
31 janvier de la même année par moi-même ; nous avons constaté l’un et l’autre que
le disque était visible jusqu’à la profondeur de 21 mètres. Le minimum paraît être
de 4 mètres, d’après des observations faites en juillet 1891 par M. Schardt dans le
golfe de Territet8, Une longue série de chiffres intermédiaires se trouve reproduite
dans l’ouvrage de M. Forel sur le Léman3.
Au lac du Bourget, au-dessus de la plaine centrale, j ’ai trouvé que la transparence
variait entre le minimum de 5m,70 (29 mai 1891) et le maximum de 10m,50
(22 avril 1891 et 26 février 1895)',
Au lac d’Annecy, j’ai trouvé que, au milieu du Grand Lac, elle variait entre le
minimum de 6m,30 (10 mai 1890) et le maximum de 13 mètres (14 février 1894).
Dans le Petit Lac, M. Garcin, conducteur des ponts et chaussées, qui travaillait
avec moi aux opérations de sondage, a constaté que, à la suite de pluies torrentielles,
■I. F.-A. F o r e l , le Léman, t. II, p. 423. M. Garcin a m êm e trouvé 22m,5 0 en fa c e d’Évian l e 6 m a r s 1891.
2 . F.-A. F o r e l , le Léman, t. II, p . 4 2 2 .
3 . F.-A. F o r e l , le Léman, t. II, p . 4 0 8 e t seq.