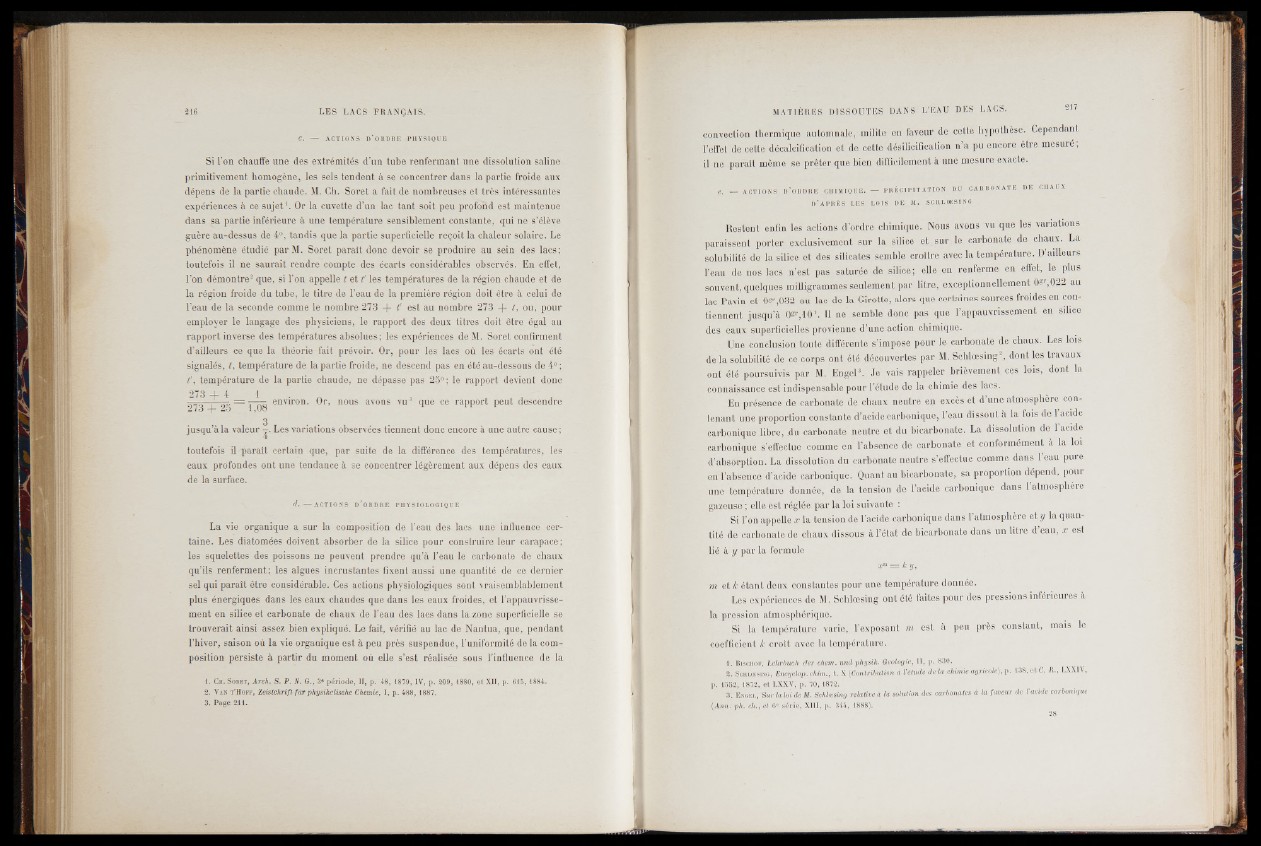
C. — ACTIONS D ORDRE PHYSIQUE
Si l’on chauffe une des extrémités d’un tube renfermant une dissolution saline
primitivement homogène, les sels tendent à se concentrer dans la partie froide aux
dépens de la partie chaude. M. Ch. Soret a fait de nombreuses et très intéressantes
expériences à ce sujet1. Or la cuvette d’un lac tant soit peu profond est maintenue
dans sa partie inférieure à une température sensiblement constante, qui ne s’élève
guère au-dessus de 4°, tandis que la partie superficielle reçoit la chaleur solaire. Le
phénomène étudié par M. Soret paraît donc devoir se produire au sein des lacs;
toutefois il ne saurait rendre compte des écarts considérables observés. En effet,
l ’on démontre8 que, si l’on appelle t et l'les températures de la région chaude et de
la région froide du tube, le titre de l’eau de la première région doit être à celui de
l’eau de la seconde comme le nombre 273 -f- t' est au nombre 273 + t, ou, pour
employer le langage des physiciens, le rapport des deux titres doit être égal au
rapport inverse des températures absolues; les expériences de M. Soret confirment
d’ailleurs ce que la théorie fait prévoir. Or, pour les lacs où les écarts ont été
signalés, t, température de la partie froide, ne descend pas en été au-dessous de 4° ;
t', température de la partie chaude, ne dépasse pas 23°; le rapport devient donc
273 + 4 1
environ. Or, nous avons vu3 que ce rapport peut descendre
273 + 25 1,08
3
jusqu’à la valeur - . Les variations observées tiennent donc encore à une autre cause ;
toutefois il paraît certain que, par suite de la différence des températures, les
eaux profondes ont une tendance à se concentrer légèrement aux dépens des eaux
de la surface.
d . — ACTIONS D ’ORDRE PHYSIOLOGIQUE
La vie organique a sur la composition de l’eau des lacs une influence certaine.
Les diatomées doivent absorber de la silice pour construire leur carapace;
les squelettes des poissons ne peuvent prendre qu’à l’eau le carbonate de chaux
qu’ils renferment; les algues incrustantes fixent aussi une quantité de ce dernier
sel qui paraît être considérable. Ces actions physiologiques sont vraisemblablement
plus énergiques dans les eaux chaudes que dans les eaux froides, et l’appauvrissement
en silice et carbonate de chaux de l’eau des lacs dans la zone superficielle se
trouverait ainsi assez bien expliqué. Le fait, vérifié au lac de Nantua, que, pendant
l’hiver, saison où la vie organique est à peu près suspendue, l’uniformité de la composition
persiste à partir du moment où elle s’est réalisée sous l’influence de la
1. Ch. S oret, A reh . S . P. H. G., 3« p é r io d e , II, p. 4 8 , 1879, IV, p. 209, 1880, e t XII, p. 615, 1884,
2. V a n t ’H o f f , Zeistch rift fü r ph ysik a lische Chemie, I, p.. 4 8 8 , 1887.
3 . Page 211.
convection thermique automnale, milite en faveur de cette hypothèse. Cependant
l’effet de celte décalcification et de cette désilicification n’a pu encore être mesuré,
il ne paraît même se prêter que bien difficilement à une mesure exacte.
C. — ACTIONS D’ORDRE CHIMIQUE. — PRÉ C IP ITA T IO N DU CARBONATE DE CHAUX
d ’a p r è s l e s l o t s d e m . s c h l o e s in g
Restent enfin les actions d’ordre chimique. Nous avons vu que les variations
paraissent porter exclusivement sur la silice et sur le carbonate de chaux. La
solubilité de la silice et des silicates semble croître avec la température. D ailleurs
l’eau de nos lacs n’est pas saturée de silice; elle en renferme en effet, le plus
souvent, quelques milligrammes seulement par litre, exceptionnellement 0+ 0 2 2 eu
lac Pàvin et 0sr,032 au lac de la Girotte, alors que certaines sources froides en contiennent
jusqu’à 0 + 1 0 1. Il ne semble donc pas que l’appauvrissement en silice
des eaux superficielles provienne d’une action chimique.
Une conclusion toute différente s’impose pour le carbonate de chaux. Les lois
de la solubilité de ce corps ont été découvertes par M. Schloesing8, dont les travaux
ont été poursuivis par M. Engel3. Je vais rappeler brièvement ces lois, dont la
connaissance est indispensable pour l'étude de la chimie des lacs.
En présence de carbonate de chaux neutre en excès et d une atmosphère contenant
une proportion constante d’acide carbonique, l’eau dissout à la fois de 1 acide
carbonique libre, du carbonate neutre et du bicarbonate. La dissolution de 1 acide
carbonique s’effectue comme en l’absence de carbonate et conformément à la loi
d’absorption. La dissolution du carbonate neutre s’effectue comme dans 1 eau pure
en l’absence d’acide carbonique. Quant au bicarbonate, sa proportion dépend, pour
une température donnée, de la tension de l’acide carbonique dans 1 atmosphère
gazeuse ; elle est réglée par la loi suivante :
Si l’on appelle x la tension de l ’acide carbonique dans l’atmosphère et y la quantité
de carbonate de chaux dissous à l’état de bicarbonate dans un litre d eau, x est
lié à y par la formule
xm = k y,
m et k étant deux constantes pour une température donnée.
Les expériences de M. Schloesing ont été faites pour des pressions inférieures à
la pression atmosphérique.
Si la température varie, l’exposant ni est à peu près constant, mais le
coefficient k croît avec la température.
d. B isch o p, Lehrbuch â e r client, m u i p h y sik . Geologie, II, p . 8 3 0 .
2 . S ciiloe s in g , Encyclop. ch im ., t. X (Contribution à l’étude d e la chimie agricole), p . 138, e t C. Ii-, LXX1V,
p. 1552, 1872, e t LXXV, p . 7 0 ,1 8 7 2 .
3. E n g e l, S u r la loi d e M. Schloesing re la tiv e à la solution des carbonates à la fav eur de l’acide carbonique
[A n n. p h . ch ., el 6° s é r ie , XIII, p. 344, 1888).