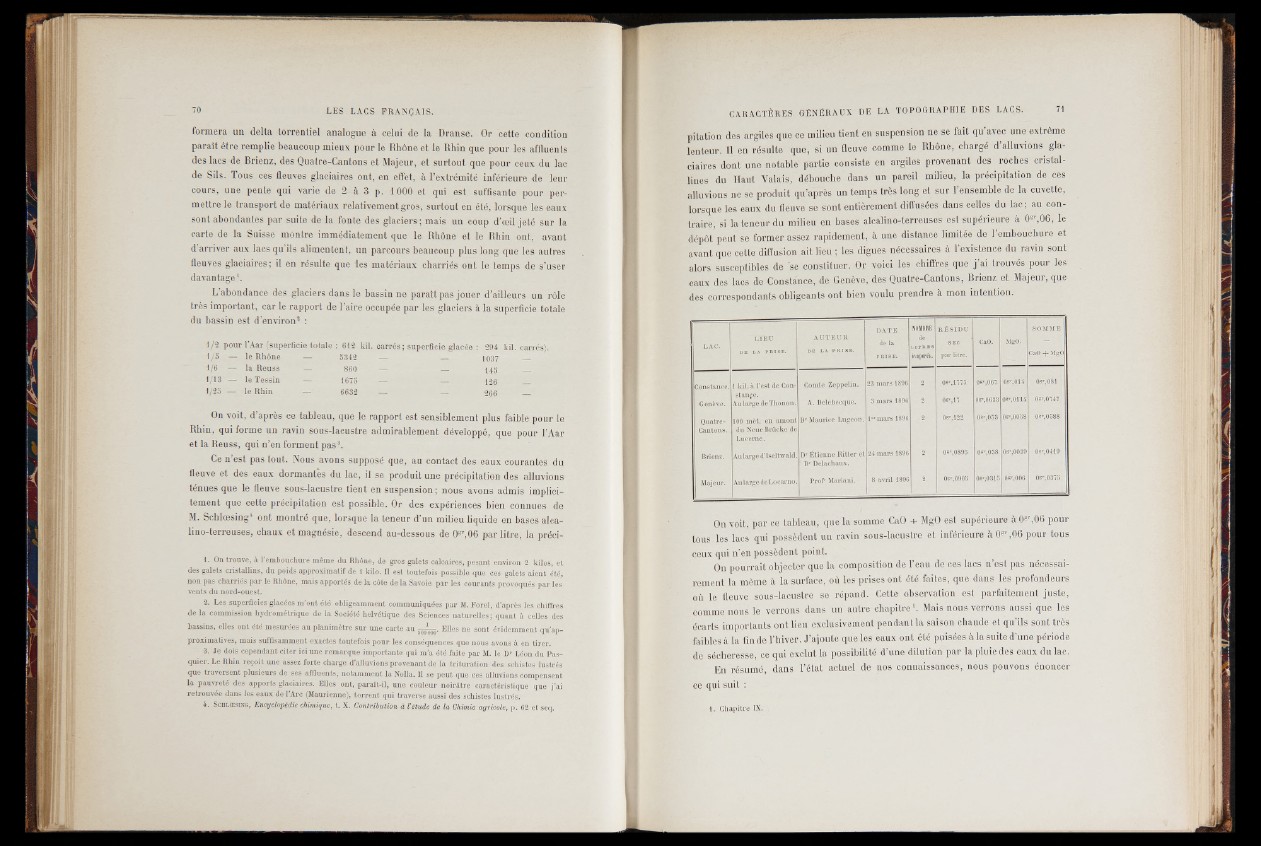
formera un delta torrentiel analogue à celui de la Dranse. Or cette condition
paraît être remplie beaucoup mieux pour le Rhône et le Rhin que pour les affluents
des lacs de Brienz, des Qualre-Cantons et Majeur, et surtout que pour ceux du lac
de Sils. Tous ces fleuves glaciaires ont, en effet, à l’extrémité inférieure de leur
cours, une pente qui varie de 2 à 3 p. 1000 et qui est suffisante pour permettre
le transport de matériaux relativement gros, surtout en été, lorsque les eaux
sont abondantes par suite de la fonte des glaciers ; mais un coup d’oeil jeté sur la
carte de la Suisse montre immédiatement que le Rhône et le Rhin ont, avant
d’arriver aux lacs qu ils alimentent, un parcours beaucoup plus long que les autres
fleuves glaciaires; il en résulte que les matériaux charriés ont le temps de s’user
davantage *.
L’abondance des glaciers dans le bassin ne paraît pas jouer d’ailleurs un rôle
très important, car le rapport de l’aire occupée par les glaciers à la superficie totale
du bassin est d’environ* :
t / 2 p o u r l ’A a r ( s u p e r f ic ie t o t a l e : 6 1 2 k il . c a r r é s ; s u p e r f i c i e g la c é e : 2 9 1 k i l . c a r r é s ) .
1 /5 — l e R h ô n e Z .-fcY 5 3 1 2 a B a B f e ? . - 'T; . ' jQ37_________
1 /6 S l a R e u s s 8 6 0 — 1 4 3 s Ë S OE
1 /1 3 B l e T e s s i n 1 6 7 5 —
1 /2 5 — l e R h in — 6 6 3 2 ' — 3 6 6 | 9 E f B
On voit, d’après ce tableau, que le rapport est sensiblement plus faible pour le
Rhin, qui forme un ravin sous-lacustre admirablement développé, que pour l’Aar
et la Reuss, qui n’en forment pas3.
Ce n est pas tout. Nous avons supposé que, au contact des eaux courantes du
fleuve et des eaux dormantes du lac, il se produit une précipitation des alluvions
ténues que le fleuve sous-lacustre tient en suspension ; nous avons admis implicitement
que cette précipitation est possible. Or des expériences bien connues de
M. Schloesing4 ont montré que, lorsque la teneur d’un milieu liquide en bases alca-
lino-terreuses, chaux et magnésie, descend au-dessous de 0^,06 par litre, la préci1.
On tr ou v e , à l ’em b o u ch u r e m êm e du Rh ône , d e g ro s g a le ts ca lc a ir e s, p e sa n t en v iron 2 k ilo s , et
d e s g a le ts cr ista llin s, d u p o id s a p p r o x im a tif d e 1 k ilo . Il e s t to u te fo is p o ssib le q u e c e s g a le ts a ien t é té ,
n o n p a s ch a rr iés p ar l e Rh ône , m a is ap po r té s de la cô te de la S avoie par le s cou ran ts p ro v oq ué s par le s
v en ts du n o rd -o u e st.
2 . Les su p e r fic ie s g la c é e s m ’o n t é té o b lig e am m en t com m u n iq u é e s p ar M. F o r e l, d’après le s chiffr es
d e la c om m is s io n h yd r om é tr iq u e de la S o c ié té h e lv é tiq u e d es S c ien c e s n a tu r e lle s ; q u an t à c e lle s des
b a ssin s, e lle s o n t é té m e su r é e s a u p la n im è tr e su r u n e car te a u £ ¿ 0- E lle s n e so n t év id em m en t qu ’app
r o x im a tiv e s, m a is su ffisam m en t ex a c te s to u te fo is p o u r l e s c o n séq u en c e s q u e n o u s av on s à en tir e r .
3. Je d o is c ep en d an t c ite r i c i u n e r em a rq u e im p o r ta n te qui m ’a é té fa ite p ar M. l e Dr Léon du P a s-
q u ie r . Le R h in r e ç o it u n e a sse z fo r te ch a rg e d’a lluv ion s p ro v en an t d e la tr itu r a tio n d e s s ch is te s lu str é s
q u e tr a v ersent p lu sieu r s d e s e s a fflu en ts, n o tam m en t la No lla . Il s e p eu t q u e c e s a lluv ion s com p en sen t
la p a u v r e té d e s apports g la c ia ir e s. E lle s o n t, p a ra ît-il, u n e c o u leu r n o ir â tr e ca r a c té r istiq u e q u e j ’ai
r e tr o u v é e dans le s e a u x d e l’Arc (Maurienne), to r r en t q u i tr a v e r se a u ssi d e s s ch is te s lu s tr é s .
4 . S chloesing, Encyclopédie chimique, t. X. Contribution à l’étude d e la Chimie agricole, p . 62 e t seq.
pitation des argiles que ce milieu tient en suspension ne se fait qu avec une extrême
lenteur. Il en résulte que, si un fleuve comme le Rhône, chargé d alluvions gla-
claires dont une notable partie consiste en argiles provenant des roches cristallines
du Haut Valais, débouche dans un pareil milieu, la précipitation de ces
alluvions ne se produit qu’après un temps très long et sur l’ensemble de la cuvette,
lorsque les eaux du fleuve se sont entièrement diffusées dans celles du lad; au contraire,
si la teneur du milieu en bases alcalino-terreuses est supérieure à 0**,06, le
dépôt peut se former assez rapidement, à une distance limitée de 1 embouchure et
avant que cette diffusion ait lieu ; les digues nécessaires à l’existence du ravin sont
alors susceptibles de se constituer. Or voici les chiffres que j ’ai trouvés pour les
eaux des lacs de Constance, de Genève, des Quatre-Cantons, Brienz et Majeur, que
des correspondants obligeants ont bien voulu prendre à mon intention.
DATE NOMBRE RÉSIDU SOMME
LAC..
LIETJ AUTEUR
de
|B |S de la
S E C CaO. MgO. DE LA PR ISE . DE LA PR ISE .
PR ISE . évaporés. par litre. CaO + MgO
Constance. •1 kil. ä l’est de ConComte
Zeppelin. 23 mars 1896 2 0er,177S 08e,- 067 06*,014 06*, 081
G enève.
stanze.
Au large deThonon. A. Delebecque. 3 mars 1896 2 OS1,17 0s*,0633 0s*, 0114 06*, 0747
Quatre- 100 mfct. en amont D* Maurice Lugeon. l°*mars 1896 . 2 Os1, 122 Os**,053 06*,0058 06*, 0588
Cantons. du Neue Brücke de
Lucerne.
Brienz. Au large d’Iseltwald. Dr Étienne Ritter et
5 Dr Delachaux.
24 mars 1896 2 Os*, 0895 Os*', 038 06*,0039 06*,0419
Majeur. Aularge de Locarno. Profr Mariani. 8 avril 1896 Os*1, 0905 0s*,0315 Os*,006 Os*,0375
On voit, par ce tableau, que la somme CaO + MgO est supérieure à 0^,06 pour
tous les lacs qui possèdent un ravin sous-lacustre et inférieure à 0s>-,06 pour tous
ceux qui n’en possèdent point.
On pourrait objecter que la composition de l’eau de ces lacs n’est pas nécessairement
la même à la surface, où les prises ont été faites, que dans les profondeurs
où le fleuve sous-lacustre se répand. Cette observation est parfaitement juste,
comme nous le verrons dans un autre chapitre*. Mais nous verrons aussi que les
écarts importants ont lieu exclusivement pendant la saison chaude et qu’ils sont très
faibles à la fin de l’hiver. J’ajoute que les eaux ont été puisées à la suite d’une période
de sécheresse, ce qui exclut 1a. possibilité d’une dilution par la pluie des eaux du lac.
En résumé dans l’état actuel de nos connaissances, nous pouvons énoncer
ce qui suit :
1 . Chapitre IX.