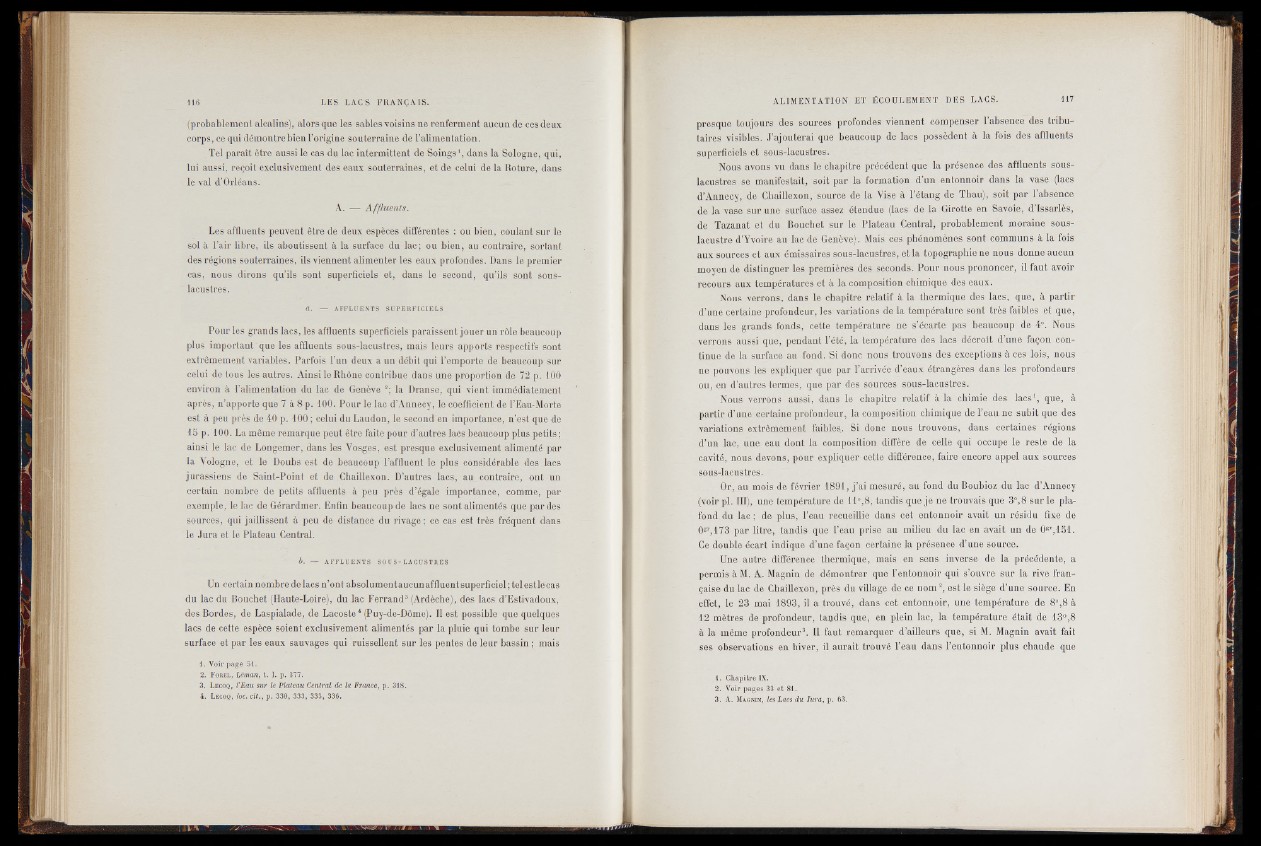
(probablement alcalins), alors que les sables voisins ne renferment aucun de ces deux
corps, ce qui démontre bien l’origine souterraine de l’alimentation.
Tel parait être aussi le cas du lac intermittent de Soings *, dans la Sologne, qui,
lui aussi, reçoit exclusivement des eaux souterraines, et de celui de la Roture, dans
le val d’Orléans.
A. — Affluents.
Les affluents peuvent être de deux espèces différentes : ou bien, coulant sur le
sol à l ’air libre, ils aboutissent à la surface du lac; ou bien, au contraire, sortant
des régions souterraines, ils viennent alimenter les eaux profondes. Dans le premier
cas, nous dirons qu’ils sont superficiels et, dans le second, qu’ils sont sous-
lacustres.
a . — AFFLUENTS SU PE R F IC IE L S
Pour les grands lacs, les affluents superficiels paraissent jouer un rôle beaucoup
plus important que les affluents sous-lacustres, mais leurs apports respectifs sont
extrêmement variables. Parfois l’un deux a un débit qui l’emporte de beaucoup sur
celui de tous les autres. Ainsi le Rhône contribue dans une proportion de 72 p. 100
environ à l’alimentation du lac de Genève 2; la Dranse, qui vient immédiatement
après, n’apporte que 7 à 8 p. 100. Pour le lac d’Annecy, le coefficient de l’Eau-Morte
est à peu près de 40 p. 100 ; celui du Laudon, le second en importance, n’est que de
15 p. 100. La même remarque peut être faite pour d’autres lacs beaucoup plus petits ;
ainsi le lac de Longemer, dans les Vosges, est presque exclusivement alimenté par
la Vologne, et le Doubs est de beaucoup l’affluent le plus considérable des lacs
jurassiens de Saint-Point et de Chaillexon. D’autres lacs, au contraire, ont un
certain nombre de petits affluents à peu près d’égale importance, comme, par
exemple, le lac de Gérardmer. Enfin beaucoup de lacs ne sont alimentés que par des
sources, qui jaillissent à peu de dislance du rivage; ce cas est très fréquent dans
le Jura et le Plateau Central.
b. — AF FLUENTS SO U S -LA CUSTRES
Un certain nombre delacs n’ont absolumentaucunaffluentsuperficiel ; telestlecas
du lac du Bouchet (Haute-Loire), du lac Ferrand3 (Ardèche), des lacs d’Estivadoux,
des Bordes, de Laspialade, de Lacoste4 (Puy-de-Dôme). Il est possible que quelques
lacs de cette espèce soient exclusivement alimentés par la pluie qui tombe sur leur
surface et par les eaux sauvages qui ruissellent sur les pentes de leur bassin ; mais
d . V o ir p a g e 5 1 .
2 . F orel, Léman, t . I . p . 3 7 7 .
3 . L ecoq, l ’Eau su r le Plateau Central de la France, p . 3 1 8 .
4 . Lecoq, loc. c it ., p . 3 3 0 , 3 3 3 , 3 3 5 , 3 3 6 .
presque toujours des sources profondes viennent compenser l’absence des tributaires
visibles. J’ajouterai que beaucoup de lacs possèdent à la fois des affluents
superficiels et sous-lacustres.
Nous avons vu dans le chapitre précédent que la présence des affluents sous-
lacustres se manifestait, soit par la formation d’un entonnoir dans la vase (lacs
d’Annecy, de Chaillexon, source de la Vise à l ’étang de Tliau), soit par l’absence
de la vase sur une surface assez étendue (lacs de la Girotte en Savoie, d Issarlès,
de Tazanat et du Bouchet sur le Plateau Central, probablement moraine sous-
lacustre d’Yvoire au lac de Genève). Mais ces phénomènes sont communs à la fois
aux sources et aux émissaires sous-lacustres, et la topographie ne nous donne aucun
moyen de distinguer les premières des seconds. Pour nous prononcer, il faut avoir
recours aux températures et à la composition chimique des eaux.
Nous verrons, dans le chapitre relatif à la thermique des lacs, que, à partir
d’une certaine profondeur, les variations de la température sont très faibles et que,
dans les grands fonds, cette température ne s’écarte pas beaucoup de 4°. Nous
verrons aussi que, pendant l’été, la température des lacs décroît d’une façon continue
de la surface au fond. Si donc nous trouvons des exceptions à ces lois, nous
ne pouvons les expliquer que par l’arrivée d’eaux étrangères dans les profondeurs
ou, en d’autres termes, que par des sources sous-lacustres.
Nous verrons aussi, dans le chapitre relatif à la chimie des lacs1, que, à
partir d’une certaine profondeur, la composition chimique de l’eau ne subit que des
variations extrêmement faibles.. Si donc nous trouvons, dans certaines régions
d’un lac, une eau dont la composition diffère de celle qui occupe le reste dé" la
cavité, nous devons, pour expliquer cette différence, faire encore appel aux sources
sous-lacustres.
Or, au mois de février 1894, j’ai mesuré, au fond du Boubioz du lac d’Annecy
(voir pl. III), une température de 11“,8, tandis que je ne trouvais que 3“,8 sur le plafond
du lac ; de plus, l’eau recueillie dans cet entonnoir avait un résidu fixe de
par litre, tandis que l’eau prise au milieu du lac en avait un de 0B',151.
Ce double écart indique d’une façon certaine la présence d’une source.
Une autre différence thermique, mais en sens inverse de la précédente, a
permis à M. A. Magnin de démontrer que l’entonnoir qui s’ouvre sur la rive française
du lac de Chaillexon, près du village de ce nom3, est le siège d’une source. En
effet, le 23 mai 1893, il a trouvé, dans cet entonnoir, une température de 8“,8 à
12 mètres de profondeur, tandis que, en plein lac, la température était de 13°,8
à la même profondeur3. 11 faut remarquer d’ailleurs que, si M. Magnin avait fait
ses observations en hiver, il aurait trouvé l’eau dans l’entonnoir plus chaude que
1. Chapitre IX.
2 . Voir p a g e s 33 e t 81.
3 . A. Magnin, les Lacs du Ju ra, p . 6 3 .