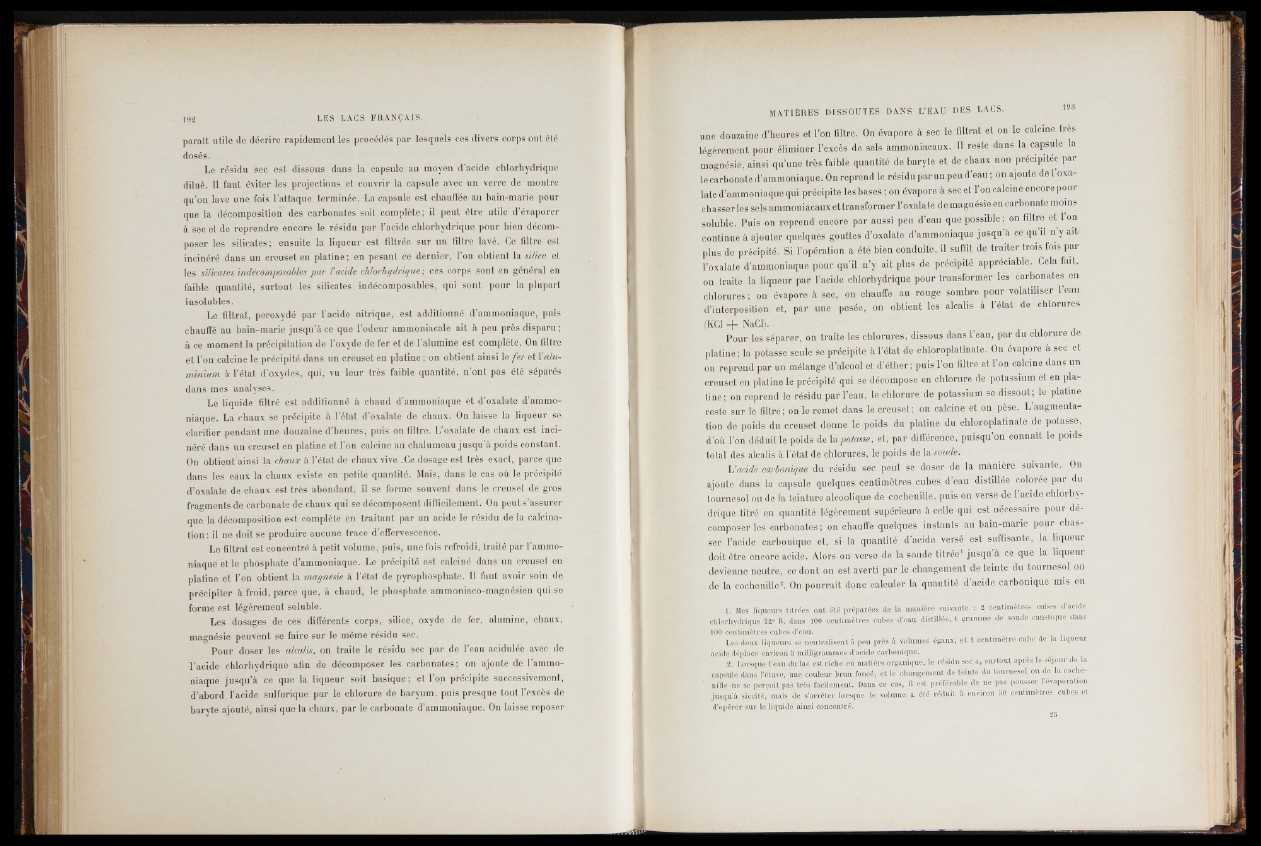
paraît utile de décrire rapidement les procédés par lesquels ces divers corps ont été
dosés.
Le résidu sec est dissous dans la capsule au moyen d’acide chlorhydrique
dilué. 11 faut éviter les projections et couvrir la capsule avec un verre de montre
qu’on lave une fois l’attaque terminée. La capsule est chauffée au bain-marie pour
que la décomposition des carbonates soit complète; il peut être utile d’évaporer
à sec et de reprendre encore le résida par l’acide chlorhydrique pour bien décomposer
les silicates; ensuite la liqueur est filtrée sur un filtre lavé. Ce filtre est
incinéré dans un creuset en platine; en pesant ce dernier, l’on obtient la silice et
les silicates indécomposables par l’acide chlorhydrique ; ces corps sont en général en
faible quantité, surtout les silicates indécomposables, qui sont pour la plupart
insolubles.
Le filtrat, peroxydé par l’acide nitrique, est additionné d’ammoniaque, puis
chauffé au bain-marie jusqu’à ce que l’odeur ammoniacale ait à peu près disparu ;
à ce moment la précipitation de l’oxyde de fer et de l’alumine est complète. On fillre
et l’on calcine le précipité dans un creuset en platine ; on obtient ainsi le fer et Xaluminium
à l’état d’oxydes, qui, vu leur très faible quantité, n’ont pas été séparés
dans mes analyses.
Le liquide filtré est additionné à chaud d’ammoniaque et d’oxalate d’ammoniaque.
La chaux se précipite à l’état d’oxalate de chaux. On laisse la liqueur se
clarifier pendant une douzaine d’heures, puis on filtre. L’oxalate de chaux est incinéré
dans un creuset en platine et l’on calcine au chalumeau jusqu’à poids constant.
On obtient ainsi la chaux à l’état de chaux vive .Ce dosage est très exact, parce que
dans les eaux la chaux existe en petite quantité. Mais, dans le cas où le précipité
d’oxalate de chaux est très abondant, il se forme souvent dans le creuset de gros
fragments de carbonate de chaux qui se décomposent difficilement. On peut s’assurer
que la décomposition est complète en traitant par un acide le résidu de la calcination
: il ne doit se produire aucune trace d’effervescence.
Le filtrat est concentré à petit volume, puis, une fois refroidi, traité par l’ammoniaque
et le phosphate d’ammoniaque. Le précipité est calciné dans un creuset en
platine et l’on obtient la magnésie à l’état de pyrophosphate. Il faut avoir soin de
précipiter à froid, parce que, à chaud, le phosphate ammoniaco-magnésien qui se
forme est légèrement soluble.
Les dosages de ces différents corps, silice, oxyde de fer, alumine, chaux,
magnésie peuvent se faire sur le même résidu sec.
Pour doser les alcalis, on traite le résidu sec par de l’eau acidulée avec de
l’acide chlorhydrique afin de décomposer les carbonates; on ajoute de l’ammoniaque
jusqu’à ce que la liqueur soit basique; et l’on précipite successivement,
d’abord l’acide sulfurique par le chlorure de baryum, puis presque tout l’excès de
baryte ajouté, ainsi que la chaux, par le carbonate d’ammoniaque. On laisse reposer
une douzaine d’heures et l’on filtre. On évapore à sec le filtrat et on le calcine très
légèrement pour éliminer l’excès de sels ammoniacaux. Il reste dans la capsule la
magnésie, ainsi qu’une très faible quantité de baryte et de chaux non précipitée par
le carbonate d’ammoniaque. On reprend le résidu par un peu d’eau ; on ajoute de 1 oxa-
late d’ammoniaque qui précipite les bases ; on évapore à sec et l’on calcine encore pour
chasser les sels ammoniacaux et transformer l’oxalate de magnésie en carbonate moins
soluble. Puis on reprend encore par aussi peu d’eau que possible; on filtre et 1 on
continue à ajouter quelques gouttes d’oxalate d’ammoniaque jusqu’à ce qu il n y ait-
plus de précipité. Si l’opération a été bien conduite, il suffit de traiter trois fois par
l’oxalate d’ammoniaque pour qu’il n’y ait plus de précipité appréciable. Cela fait,
on traite la liqueur par l’acide chlorhydrique pour transformer les carbonates en
chlorures ; on évapore à sec, on chauffe au rouge sombre pour volatiliser 1 eau
d’interposition et, par une pesée, on obtient les alcalis à l’état de chlorures
(KO -j- NaCl).
Pour les séparer, on traite les chlorures, dissous dans l’eau, par du chlorure de
platine; la potasse seule se précipite à l’état de chloroplatinate. On évapore à sec et
on reprend par un mélange d’alcool et d’éther; puis l’on filtre et l’on calcine dans un
creuset en platine le précipité qui se décompose en chlorure de potassium et en platine;
on reprend le résidu par l’eau, le chlorure de potassium se dissout; le platine
reste sur le filtre; on le remet dans le creuset ; on calcine et on pèse. L’augmentation
de poids du creuset donne le poids du platine du chloroplatinate de potasse,
d’où l’on déduit le poids de lajvotasse, et, par différence, puisqu’on connaît le poids
total des alcalis à l’état de chlorures, le poids de la soude.
L’acide carbonique du résidu sec peut se doser de la manière suivante. On
ajoute dans la capsule quelques centimètres cubes d’eau distillée colorée par du
tournesol ou de la teinture alcoolique de cochenille, puis on verse de 1 acide chlorhydrique
titré en quantité légèrement supérieure à celle qui est nécessaire pour décomposer
les carbonates ; on chauffe quelques instants au bain-marie pour chasser
l’acide carbonique et, si la quantité d’acide versé est suffisante, la liqueur
doit être encore acide. Alors on verse de la soude titrée* jusqu à ce que la liqueur
devienne neutre, ce dont on est averti par le changement de teinte du tournesol ou
de la cochenille*. On pourrait donc calculer la quantité d acide carbonique mis en
1. Mes liqueurs titrées ont été préparées de la manière suivante : 2 centimètres cubes d’acide
chlorhydrique 22“ B. dans 100 centimètres cubes d’eau distillée, 1 gramme de soude caustique dans
100 centimètres cubes d’eau.
Les deux liqueurs se neutralisent à peu près à volumes égaux, et t centimètre cube de la liqueur
acicle déplace environ 5 milligrammes d’acide carbonique.
2. Lorsque l’eau du lac est riche en matière organique, le résidu sec a, surtout après le séjour de la
capsule dans l’étuve, une couleur brun foncé, et le changement de teinte du tournesol ou de la coche-
' nille ne se perçoit pas très facilement. Dans ce cas, il est préférable de ne pas pousser l’évaporation
jusqu’à siccité, mais de s’arrêter lorsque le volume a été réduit à environ 50 centimètres cubes .et
d’opérer sur le liquide ainsi concentré.