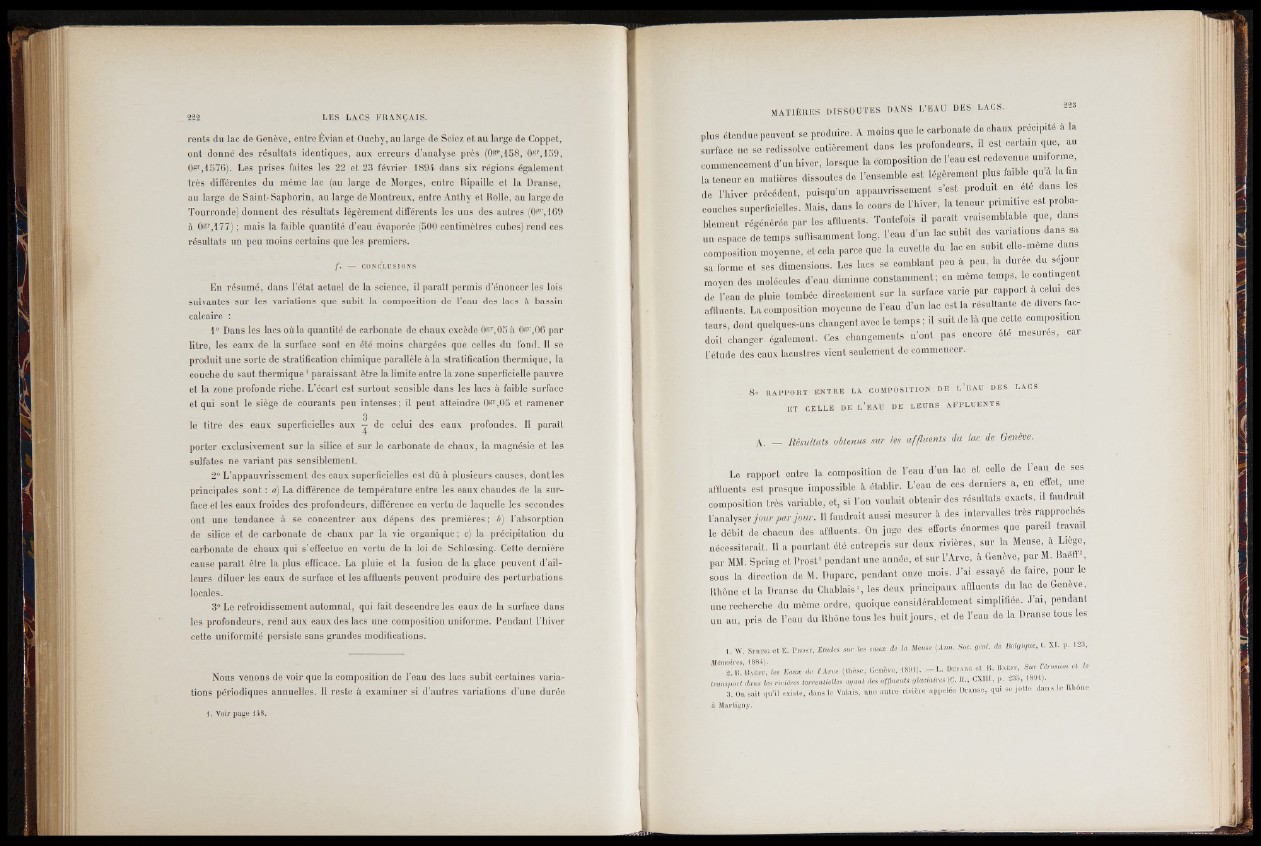
rents du lac de Genève, entre Évian et Ouchy, au large de Sciez et au large de Coppet,
ont donné des résultats identiques, aux erreurs d’analyse près 0er,159,
Os1',1576). Les prises faites les 22 et 23 février 1894 dans six régions également
très différentes du même lac (au large de Morges, entre Ripaille et la Dranse,
au large de Sainl-Saphorin, au large deMontreux, entre Anthy et Rolle, au large de
Tourronde) donnent des résultats légèrement différents les uns des autres (0sr,169
à OP',177) ; mais la faible quantité d’eau évaporée (500 centimètres cubes) rend ces
résultats un peu moins certains que les premiers.
f. I l | C O N C L U S IO N S
En résumé, dans l’état actuel de la science, il parait permis d’énoncer les lois
suivantes sur les variations que subit la composition de l’eau des lacs à bassin
calcaire :
1° Dans les lacs où la quantité de carbonate de chaux excède 0?r,05 à 0sr,06 par
litre, les eaux de la surface sont en été moins chargées que celles du fond. Il sé
produit une sorte de stratification chimique parallèle à la stratification thermique, la
couche du saut thermique1 paraissant être la limite entre la zone superficielle pauvre
et la zone profonde riche. L’écart est surtout sensible dans les lacs à faible surface
et qui sont le siège de courants peu intenses; il peut atteindre Os'.OS et ramener
3
le titre des eaux superficielles aux - de celui des eaux profondes. Il parait
porter exclusivement sur la silice et sur le carbonate de chaux, la magnésie et les
sulfates ne variant pas sensiblement.
2° L’appauvrissement des eaux superficielles est dû à plusieurs causes, dont les
principales sont : a) La différence de température entre les eaux chaudes de la surface
et les eaux froides des profondeurs, différence en vertu de laquelle les secondes
ont une tendance à se concentrer aux dépens des premières; b) l’absorption
de silice et de carbonate de chaux par la vie organique; c) la précipitation du
carbonate de chaux qui s’effectue en vertu de la loi de Schloesing. Cette dernière
cause parait être la plus efficace. La pluie et la fusion de la glace peuvent d’ailleurs
diluer les eaux de surface et les affluents peuvent produire des perturbations
locales.
3° Le refroidissement automnal, qui fait descendre les eaux de la surface dans
les profondeurs, rend aux eaux des lacs une composition uniforme. Pendant l’hiver
cette uniformité persiste sans grandes modifications.
Nous venons de voir que la composition de l’eau des lacs subit certaines variations
périodiques annuelles. 11 reste à examiner si d’autres variations d’une durée
1. Voir pa g e 148.
plus étendue peuvent se produire. 1 moins que le carbonate de chaux précipité a la
surface ne se redissolve entièrement dans les profondeurs, il est certain que, au
commencement d’un hiver, lorsque la composition de l’eau est redevenue uniforme,
la teneur en matières dissoutes de l’ensemble est légèrement plus faible qu a la fin
de l’hiver précédent, puisqu’un appauvrissement s ’est produit en été dans les
couches superficielles. Mais, dans le cours de l’hiver, la teneur primitive est probablement
régénérée par les affluents. Toutefois il parait vraisemblable que, dans
un espace de temps suffisamment long, l’eau d’un lac subit des variations dans sa
composition moyenne, et cela parce que la cuvette du lac en subit elle-meme dans
sa forme et ses dimensions. Les lacs se comblant peu à peu, la durée du séjour
moyen des molécules d’eau diminue constamment; en même temps, le contingent
de l’eau de pluie tombée directement sur la surface varie par rapport à celui des
affluents. La composition moyenne de l’eau d’un lac est la résultante de divers facteurs,
dont quelques-uns changent avec le temps ; il suit de là que cette composition
doit changer également. Ces changements n’ont pas encore été mesures, car
l’étude des eaux lacustres vient seulement de commencer.
. 8 » R A P PO R T E N T R E LA COM PO S IT IO N D E L ’E A U D E S L A C S
ET C E L L E DE L ’E A U DE L E U R S A F F L U E N T S
A. — Résultats obtenus sur les affluents du lac de Genève.
Le rapport entre la composition de l’eau d’un lac et celle de l’eau de ses
affluents est presque impossible à établir. L’eau de ces derniers a, en effet une
composition très variable, et, si l’on voulait obtenir des résultats exacts, il faudrait
l’analyser jour par jour. Il faudrait aussi mesurer à des intervalles très rapproches
le débit de chacun des affluents. On juge des efforts énormes que pareil travail
nécessiterait. Il a pourtant été entrepris sur deux pivières, sur la Meuse, à Liege,
par MM. Spring et Prost* pendant une année, et sur l’Arve, à Genève, par M. Baeff ,
sous la direction de M. Duparc, pendant onze mois. J’ai essayé de faire, pour le
Rhône et la Dranse du Chablais3, les deux principaux affluents du lac de Geneve,.
une recherche du même ordre, q u o i q u e considérablement simplifiée. Ja i, pendant
un an, pris de l’eau du Rhône tous les huit jours, et de l’eau de la Dranse tous les
1. W . S pring e t E. P rost, Éludes sur les eau x de la Meuse (A n n. Soc. gèol. de B elg ique , t. XI. p . 123,
Mémoires, 1884). _
2 . B. B a ü ff, les Eaux de l 'A n e (th è se , Genève , 1891). - L. D uparq e t B. Baépf, Sur ¡ é ro sio n e t
tran sp o rt dans les rivière s to rrentielles ag an t des affluents g la cia ires (C. IL-, CXIII, p . 23S, 1891).
3. On sa it q u ’il e x is te , dans l e Valais, u n e au tr e r iv ièr e ap p e lé e D r a n se , q u i se j e t t e d a n s l e Rho
I Martigny.