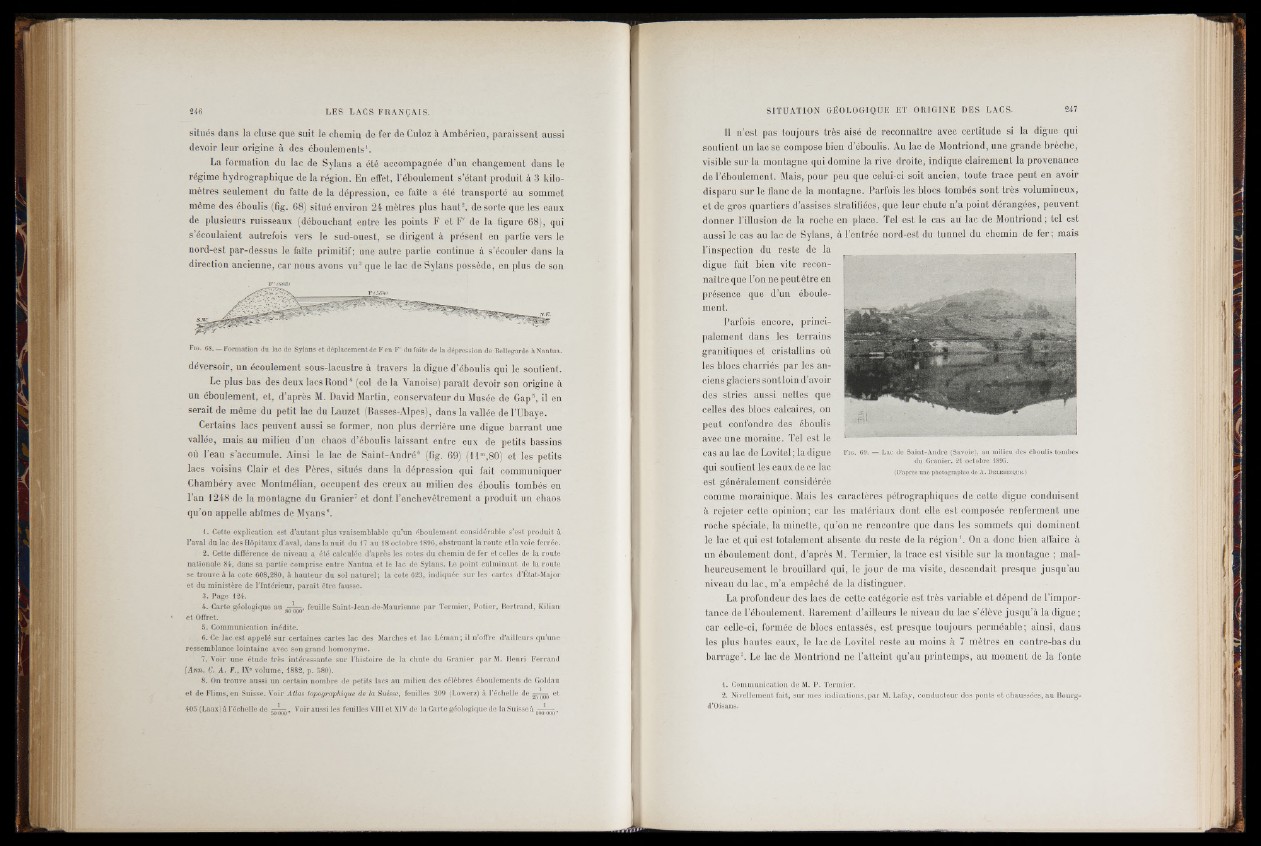
situés dans la cluse que suit le chemin de fer de Culoz à Ambérieu, paraissent aussi
devoir leur origine à des éboulements1.
La formation du lac de Sylans a été accompagnée d’un changement dans le
régime hydrographique de la région. En effet, l’éboulement s’étant produit à 3 kilomètres
seulement du faite de la dépression, ce faîte a été transporté au sommet
même des éboulis (fig. 68) situé environ 24 mètres plus haut2, de sorte que les eaux
de plusieurs ruisseaux (débouchant entre les points F et F' de la figure 68), qui
s’écoulaient autrefois vers le sud-ouest, se dirigent à présent en partie vers le
nord-est par-dessus le faite primitif; une autre partie continue à s’écouler dans la
direction ancienne, car nous avons vu3 que le lac de Sylans possède, en plus de son
F ig . 68. — Formation du lac de Sylans et déplacement de F en F' du faite de la dépression de Bellegarde àNantua.
déversoir, un écoulement sous-lacustre à travers la digue d’éboulis qui le soutient.
Le plus bas des deux lacs Rond* (col de la Vanoise) parait devoir son origine à
un éboulement, et, d’après M. David Martin, conservateur du Musée de Gap5, il en
serait de même du petit lac du Lauzet (Basses-Alpes), dans la vallée de l’Ubaye.
Certains lacs peuvent aussi se former, non plus derrière une digue barrant une
vallée, mais au milieu d’un chaos d’éboulis laissant entre eux de petits bassins
où l’eau s ’accumule. Ainsi le lac de Saint-André6 (fig. 69) (11”,80) et les petits
lacs voisins Clair et des Pères, situés dans la dépression qui fait communiquer
Chambéry avec Montmélian, occupent des creux au milieu des éboulis tombés en
l’an 1248 de là montagne du Granier7 et dont l’enchevêtrement a produit un chaos
qu’on appelle abîmes de Myans8.
1. Cette e x p lic a tio n e s t d’au tan t p lu s v ra isem blab le qu ’u n éb o u lem en t con sid é rab le s’e s t p rod u it à
l ’aval du la c des H ôpitaux d’av a l, d ans la n u i t du 17 au 18 octobr e 1896, ob stru ant la rou te e t la v o ie fe rré e.
2 . Cette d iffér en ce d e n iv e au a, é té c a lc u lé e d’a p rès le s co te s du ch em in de fe r e t c e lle s de la rou te
n a tio n a le 84, dans sa p a r tie com p r ise en tr e N an tu a e t l e la c d e Sy lan s. Le p o in t cu lm in a n t de la rou te
s e trouve à la c o t e 608,280, à h a u teu r du so l n a tu r e l; la co te 623, in d iq u é e su r le s ca r te s d ’État-Major
e t d u m in is tè r e de l’In té r ieur , p a ra ît être fau sse.
3 . P a g e 124.
4 . Carte g éo lo g iq u e a u ^ 55, fe u ille Saint-Jean-de-Maurienne p a r T erm ier, P o tie r , Bertrand, Kilian
e t Offret.
5 . C om m un ica tion in é d ite .
6. Ce la c e st a p p e lé su r c e r ta in e s ca r te s la c des Marches e t la c Léman ; il n ’offre d’a ille u r s qu ’u n e
r e ssem b la n c e lo in ta in e a v e c so n grand h om on ym e .
7 . Voir u n e é tu d e tr ès in té r e s sa n te su r l ’h isto ir e d e la ch u te du Granier p ar M. Henri Ferrand
(A n n . C. A . F., IXe v o lum e , 1882, p. 580).
8 . On trouve au ssi u n c e r ta in n omb re d e p e tits la c s au m ilieu d es c é lèb r e s éb o u lem en ts de Goldau
e t d e F lim s , en S u isse . Voir A tla s topographique de la Suisse, feu ille s 209 (Lowerz) à l’é c h e lle d e ^ Q0() e t
405 (Laax) à l ’é c h e lle d e . Voir au ssi le s feu ille s VIII e t XIV de la Carte g éo lo g iq u e d e la S u isse à ¿5^555.
Il n’est pas toujours très aisé de reconnaître avec certitude si la digue qui
soutient un lac se compose bien d’éboulis. Au lac de Montriond, une grande brèche,
visible sur la montagne qui domine la rive droite, indique clairement la provenance
de l’éboulement. Mais, pour peu que celui-ci soit ancien, toute trace peut en avoir
disparu sur le flanc de la montagne. Parfois les blocs tombés sont très volumineux,
et de gros quartiers d’assises stratifiées, que leur chute n’a point dérangées, peuvent
donner l’illusion de la roche en place. Tel est le cas au lac de Montriond; tel est
aussi le cas au lac de Sylans, à l’entrée nord-est du tunnel du chemin de fer ; mais
l’inspection du reste de la
digue fait bien vite reconnaître
que Ton ne peut être en
présence que d’un éboulement.
Parfois encore, principalement
dans les terrains
granitiques et cristallins où
les blocs charriés par les anciens
glaciers sontloin d’avoir
des stries aussi nettes que
celles des blocs calcaires, on
peut confondre des éboulis
avec une moraine. Tel est le
cas au lac de Lovitel ; la digue
qui soutient les eaux dece lac
est généralement considérée
comme morainique. Mais les caractères pétrographiques de cette digue conduisent
à rejeter cette opinion ; car les matériaux dont elle est composée renferment une
roche spéciale, la minette, qu’on ne rencontre que dans les sommets qui dominent
le lac et qui est totalement absente du reste de la région1. On a donc bien affaire à
un éboulement dont, d’après M. Termier, la trace est visible sur la montagne ; malheureusement
le brouillard qui, le jour de ma visite, descendait presque jusqu’au
niveau du lac, m’a empêché de la distinguer.
La profondeur des lacs de cette catégorie est très variable et dépend de l’importance
de l’éboulement. Rarement d’ailleurs le niveau du lac s’élève jusqu’à la digue ;
car celle-ci, formée de blocs entassés, est presque toujours perméable; ainsi, dans
les plus hautes eaux, le lac de Lovitel reste au moins à 7 mètres en contre-bas du
barrage2. Le lac de Montriond ne l’atteint qu’au printemps, au moment de la fonte
1. Com mun ica tion d e M. P . Termier.
2. N iv e llem en t fa it, sur m e s in d ic a tio n s, par M. Lafay, co n d u c teu r d e s p o n ts e t ch a u ssé e s, au Bourg-
d’Oisans.