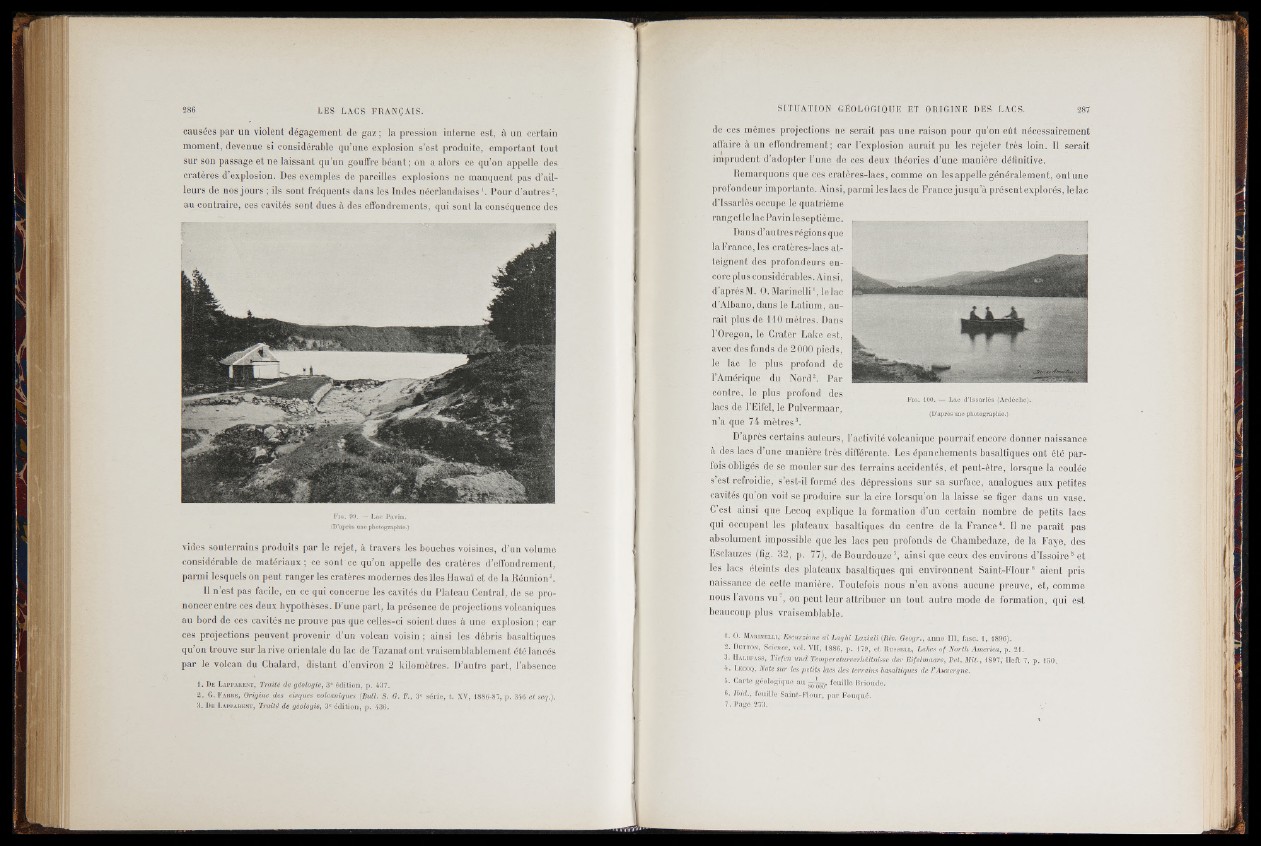
causées par un violent dégagement de gaz ; la pression interne est, à un certain
moment, devenue si considérable qu’une explosion s’est produite, emportant tout
sur son passage et ne laissant qu’un gouffre béant ; on a alors ce qu’on appelle des
cratères d’explosion. Des exemples de pareilles explosions ne manquent pas d’ailleurs
de nos jours ; ils sont fréquents dans les Indes néerlandaises*. Pour d’autres*,
au contraire, ces cavités sont dues à des effondrements, qui sont la conséquence des
F ie . 99. — Lac Pavin.
(D’après une photographie.)
vides souterrains produits par le rejet, à travers les bouches voisines, d’un volume
considérable de matériaux; ce sont ce qu’on appelle des cratères d’effondrement,
parmi lesquels on peut ranger les cratères modernes des îles Hawaï et dé la Réunion3.
Il n’est pas facile, en ce qui concerne les cavités du Plateau Central, de se prononcer
entre ces deux hypothèses. D’une part, la présence de projections volcaniques
au bord de ces cavités ne prouve pas que celles-ci soient dues à une explosion ; car
ces projections peuvent provenir d’un volcan voisin ; ainsi les débris basaltiques
qu’on trouve sur la rive orientale du lac de Tazanatont vraisemblablement été lancés
par le volcan du Chalard, distant d’environ 2 kilomètres. D’autre part, l’absence
1 . D e Lappabent, Traité d e géologie, 3e é d i t io n , p . 437.
2 . G. F abius, Origine des cirques volcaniques (Bull. S . G. F., 3‘ sé r ie , t. XV, 1886-87, p . 346 et seq.).
3. D e Lappabent, Traité d e géologie, 3° é d i t io n , p . 436.
de ces mêmes projections ne serait pas une raison pour qu’on eût nécessairement
affaire à un effondrement; car l’explosion aurait pu les rejeter très loin. Il serait
imprudent d’adopter l’une de ces deux théories d’une manière définitive.
Remarquons que ces cratères-lacs, comme on les appelle généralement, ont une
profondeur importante. Ainsi, parmi les lacs de France j usqu’à présent explorés, le lac
d’Issarlès occupe le quatrième
rangetle lac Pavin leseptième.
Dans d’autresrégionsque
la France, les cratères-lacs atteignent
des profondeurs encore
plus considérables. Ainsi,
d’aprèsM. 0. Marinelli1, le lac
d’Albano, dans le Latium, aurait
plus de HO mètres. Dans
l ’Oregon, le Crater Lake est,
avec des fonds de 2 000 pieds,
le lac le plus profond de
l’Amérique du Nord*. Par
contre, le plus profond des
lacs de l’Eifel, le Pulvermaar,
n’a que 74 mètres3.
Fig. 100. — Lac d’Issa rlè s (Ardèche)..
(D’après une photographie;)
D’après certains auteurs, l’activité volcanique pourrait encore donner naissance
à des lacs d’une manière très différente. Les épanchements basaltiques ont été parfois
obligés de se mouler sur des terrains accidentés, et peut-être, lorsque la couléè
s est refroidie, s’est-il formé des dépressions sur sa surface, analogues aux pètites
cavités qu on voit se produire sur la cire lorsqu’on la laisse se figer dans un vase.
C est ainsi que Lecoq explique la formation d’un certain nombre de petits lacs
qui occupent les plateaux basaltiques du centre de la France4. Il ne paraît pas
absolument impossible que les lacs peu profonds de Chambedaze, de la Faye, des
Esclauzes (fîg. 32, p. 77), de Bourdouze5, ainsi que ceux des environs d’Issoire5 et
les lacs éteints des plateaux basaltiques qui environnent Saint-Flour6 aient pris
naissance de cette manière. Toutefois nous n’en avons aucune preuve, et, comme
nous l’avons vu ', on peut leur attribuer un tout autre mode de formation, qui est
beaucoup plus vraisemblable.
1. 0 . Marinelli,- Escurzione a i Laghi L a z ia li (R iv . Geogr., an no III, fa sc . d, 1896).
2. D u t t o n , Science, v o l. VII, 1886, p . 179, e t Rüssell, Lahes o f North America, p . 21.
3. H albfas s , Tiefen u n d Temperaturverhâltnisse d e r E ifelm a a re, P e t, M it., d 897, Heft 7, p. 150.
4 . L e c o q , Note sû r les p e tits lacs des terra ins basaltiques de VAuvergne,
b. Carte g éo lo g iq u e au — fe u ille B rioud e.
6. Ib id ., fe u ille S a in t-F lo u r , p ar F ou qu é.
7 . P a g e 273.