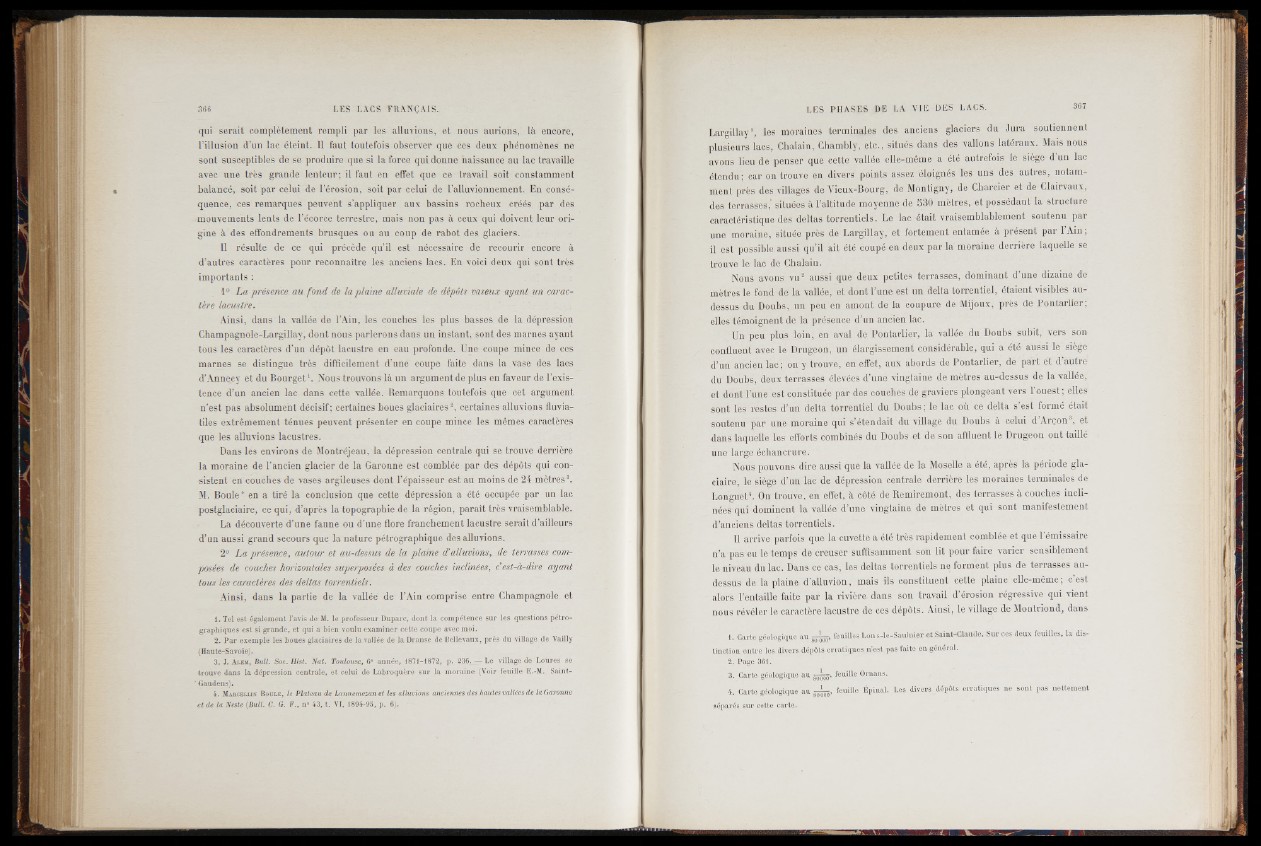
qui serait complètement rempli par les alluvions, et nous aurions, là encore,
l’illusion d’un lac éteint. 11 faut toutefois observer que ces deux phénomènes ne
sont susceptibles de se produire que si la force qui donne naissance au lac travaille
avec une très grande lenteur; il faut en effet que ce travail soit constamment
balancé, soit par celui de l’érosion, soit par celui de l’alluvionnement. En conséquence,
ces remarques peuvent s’appliquer aux bassins rocheux créés par des
mouvements lents de l’écorce terrestre, mais non pas à ceux qui doivent leur origine
à des effondrements brusques ou au coup de rabot des glaciers.
Il résulte de ce qui précède qu’il est nécessaire de recourir encore à
d’autres caractères pour reconnaître les anciens lacs. En voici deux qui sont très
importants :
1° La présence au fond de la plaine alluviale de dépôts vasetix ayant un caractère
lacustre.
Ainsi, dans la vallée de l’Ain, les couches les plus basses de la dépression
Champagnole-Largillay, dont nous parlerons dans un instant, sont des marnes ayant
tous les caractères d’un dépôt lacustre en eau profonde. Une coupe mince de ces
marnes se distingue très difficilement d’une coupe faite dans la vase des lacs
d’Annecy et du Bourget1. Nous trouvons là un argument de plus en faveur de l’existence
d’un ancien lac dans cette vallée. Remarquons toutefois que cet argument
n’est pas absolument décisif; certaines boues glaciaires2, certaines alluvions fluviátiles
extrêmement ténues peuvent présenter en coupe mince les mêmes caractères
que les alluvions lacustres.
Dans les environs de Montréjeau, la dépression centrale qui se trouve derrière
la moraine de l’ancien glacier de la Garonne est comblée par des dépôts qui consistent
en couches de vases argileuses dont l’épaisseur est au moins de 24 mètres3.
M. Boule* en a tiré la conclusion que cette dépression a été occupée par un lac
postglaciaire, ce qui, d’après la topographie de la région, parait très vraisemblable.
La découverte d’une faune ou d’une flore franchement lacustre serait d’ailleurs
d’un aussi grand secours que la nature pétrographique des alluvions.
2° La présence, autour et au-dessus de la plaine d’allumons, de terrasses composées
de couches horizontales superposées à des couches inclinées, c’est-à-dire ayant
tous les caractères des deltas torrentiels.
Ainsi, dans la partie de la vallée de l’Ain comprise entre Champagnole et
1. Tel e s t ég a lem en t l’avis de M. l e p ro fe sseu r Duparc, d o n t la com p é ten c e su r le s q u e stio n s p é tr o -
g r a p h iq u e s e s t s i g ran d e, e t q ui a b ie n vou lu e x am in e r c e tte cou p e av ec m o i.
2 . P a r e x em p le le s b o u e s g la c ia ir e s d e la v a llé e de la Dranse d e B ellev au x , p rès du v illa g e d e Vailly
(Hau te-Savoie).
3. J. Alem, Bull. Soc. H ist. N a t. Toulouse, 6e a n n é e , 1 8 7 1 -1 8 7 2 , p. 236. — Le v illa g e de Loures se
trouve d ans la d ép r e ssio n c en tr a le , e t c e lu i d e Labroquèr e su r la m o r a in e (Voir feu ille E.-M. S a in t-
Gaudens).
4 . Marcellin Boule, le P la tea u de Lan neme zane t les alluvions anciennes d e s hautes vallées d e la Garonne
e t d e la Neste [Bull. G. G. P ., n° 43, t. VI, 1894-95, p . 6). r
Largillay1, les moraines terminales des anciens glaciers du Jura soutiennent
plusieurs lacs, Chalain, Chambly, etc., situés dans des vallons latéraux. Mais nous
avons lieu de penser que cette vallée elle-même a été autrefois le siège d un lac
étendu ; car on trouve en divers points assez éloignés les uns des autres, notamment
près des villages de Vieux-Bourg, de Montigny, de Charcier et de Clairvaux,
des terrasses,' situées à l’altitude moyenne de 530 mètres, et possédant la structure
caractéristique des deltas torrentiels. Le lac était vraisemblablement soutenu par
une moraine, située près de Largillay, et fortement entamée à présent par lA in,
il est possible aussi qu’il ait été coupé en deux par la moraine derrière laquelle se
trouve le lac de Chalain.
Nous avons vu2 aussi que deux petites terrasses, dominant d’une dizaine de
mètres le fond de la vallée, et dont l’une est un delta torrentiel, étaient visibles au-
dessus du Doubs, un peu en amont de la coupure de Mijoux, près de Pontarlier;
elles témoignent de la présence d’un ancien lac.
Un peu plus loin, en aval de Pontarlier, la vallée du Doubs subit, vers son
confluent avec le Drugeon, un élargissement considérable, qui a été aussi le siège
d’un ancien lac; on y trouve, en effet, aux abords de Pontarlier, de part et d autre
du Doubs, deux terrasses élevées d’une vingtaine de mètres au-dessus de la vallée,
et dont l’une est constituée par des couches de graviers plongeant vers l’ouest; elles
sont les restes d’un delta torrentiel du Doubs ; le lac où ce delta s’est formé était
soutenu par une moraine qui s’étendait du village du Doubs à celui d’Arçon3, et
dans laquelle les efforts combinés du Doubs et de son affluent le Drugeon ont taillé
une large échancrure.
Nous pouvons dire aussi que la vallée de la Moselle a été, après la période glaciaire,
le siège d’un lac de dépression centrale derrière les moraines terminales de
Longuet4. On trouve, en effet, à côté de Remiremont, des terrasses à couches inclinées
qui dominent la vallée d’une vingtaine de mètres et qui sont manifestement
d'anciens deltas torrentiels.
11 arrive parfois que la cuvette a été très rapidement comblée et que l’émissaire
n’a pas eu le temps de creuser suffisamment son lit pour faire varier sensiblement
le niveau du lac. Dans ce cas, les deltas torrentiels ne forment plus de terrasses au-
dessus de la plaine d’alluvion, mais ils constituent cette plaine elle-même, c est
alors l’entaille faite par la rivière dans son travail d’érosion régressive qui vient
nous révéler le caractère lacustre de ces dépôts. Ainsi, le village de Montriond, dans
1. Carte g é o lo g iq u e a u fe u ille s L o n s - le -S a u ln ie r e t S a in t-C lau d e . S u r c e s d eu x f e u ille s , la d istin
c tio n en tr e le s d ive rs dép ôts e r ra tiq u e s n ’e s t p a s fa ite e n g én é r a l.
2. P a g e 361.
3. Carte g éo lo g iq u e a u fe u ille Ornans.
4 . Carte g éo lo g iq u e a u - L j , fe u ille É pin a l. Les d iv e r s d ép ô ts e r r a tiq u e s n e so n t p a s n e tt em e n t
s ép a ré s su r c e tte ca r te.