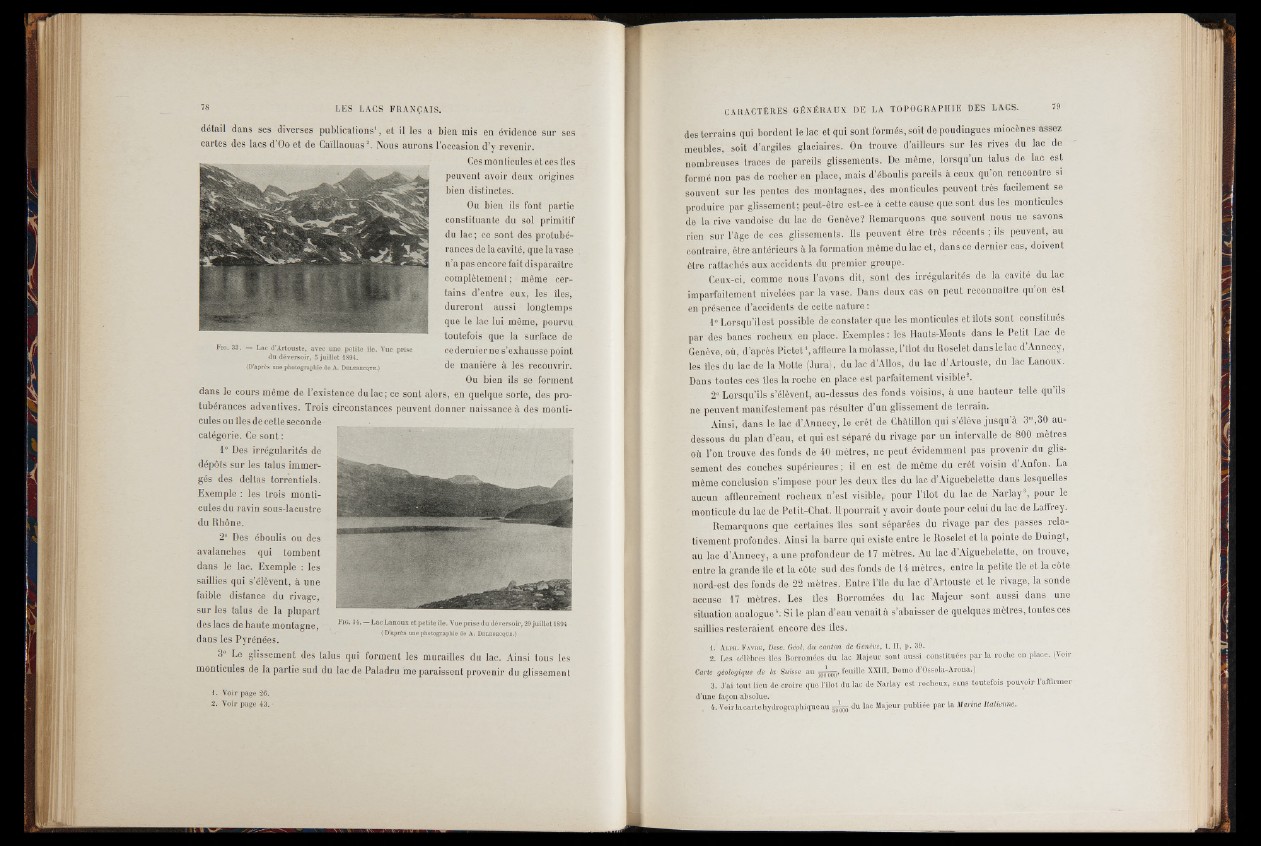
f i l
détail dans ses diverses publications1, et il les a bien mis en évidence sur ses
cartes des lacs d Oo et de Caïllaouas3. Nous aurons l'occasion d'y revenir.
F ie. 33. — Lac d’Artouste, avec une petite île. Vue prise
du déversoir, 5 juillet 1894.
(D’après une photographie de A. Delebecque.)
Ces monticules et ces îles
peuvent avoir deux origines
bien distinctes.
Ou bien ils font partie
constituante du sol primitif
du lac; ce sont des protubérances
de la cavité, que la vase
n’a pas encore fait disparaître
complètement ; même certains
d’entre eux, les îles,
dureront aussi longtemps
que le lac lui même, pourvu
toutefois que la surface de
ce dernier ne s’exhausse point
de manière à les recouvrir.
Ou bien ils se forment
dans le cours même de l’existence du lac ; ce sont alors, en quelque sorte, des protubérances
advenlives. Trois circonstances peuvent donner naissance à des monticules
ou îles de cette seconde _
catégorie. Ce sont :
1° Des irrégularités de
dépôts sur les talus immergés
des deltas torrentiels.
Exemple : les trois monticules
du ravin sous-lacustre
du Rhône.
2° Des éboulis ou des
avalanches qui tombent
dans le lac. Exemple : les
saillies qui s’élèvent, à une
faible distance du rivage,
sur les talus de la plupart
des lacs de haute montagne,
dans les Pyrénées.
Fig> 34. — Lac Lanoux et petite île. Vue prise du déversoir, 29 juillet 1894
( D’après une photographie do A. Delebecque.)-.
3° Le glissement des talus qui forment les murailles du lac. Ainsi tous les
monticules de la partie sud du lac de Paladru me paraissent provenir du glissement
1. Voir p age 26.
2. Voir p age 4 3 . •
des terrains qui bordent le lac et qui sont formés, soit de poudingues miocènes assez
meubles, soit d’argiles glaciaires. On trouve d’ailleurs sur les rives du lac de
nombreuses traces de pareils glissements. De même, lorsqu’un talus de lac est
formé non pas de rocher en place, mais d’éboulis pareils à ceux qu on rencontre si
souvent sur les pentes des montagnes, des monticules peuvent très facilement se
produire par glissement; peut-être est-ce à cette cause que sont dus les monticules
de la rive vaudoise du lac de Genève? Remarquons que souvent nous ne savons
rien sur l’âge de ces glissements. Ils peuvent être très récents ; ils peuvent, au
contraire, être antérieurs à la formation même du lac et, dans ce dernier cas, doivent
être rattachés aux accidents du premier groupe.
Ceux-ci, comme nous l’ayons dit, sont des irrégularités de la cavité du lac
imparfaitement nivelées par la vase. Dans deux cas on peut reconnaître qu’on est
en présence d’accidents de celte nature :
1° Lorsqu’il est possible de constater que les monticules et Ilots sont constitués
par des bancs rocheux en place. Exemples : les Hauts-Monts dans le Petit Lac de
Genève, où, d’après Pictet1, affleure la molasse, l’îlot du Roselet dans le lac d Annecy,
les lies du lac de la Motte (Jura), du lac d’AUos, du lac d’Artouste, du lac Lanoux.
Dans toutes ces îles la roche èn place est parfaitement visible’.
2° Lorsqu’ils s’élèvent, au-dessus des fonds voisins, à une hauteur telle qu ils
ne peuvent manifestement pas résulter d un glissement de terrain.
Ainsi, dans le lac d’Annecy, le crêt de Châtillon qui s’élève jusqu à 3“,30 au-
dessous du plan d’eau, et qui est séparé du rivage par un intervalle de 800 mètres
où l’on trouve des fonds de 40 mètres, ne peut évidemment pas provenir du glissement
des couches supérieures ; il en est de même du crêt voisin d Anfon. La
même conclusion s’impose pour les deux îles du lac d Aiguebelette dans lesquelles
aucun affleurement rocheux n’est visible,, pour l’îlot du lac de Narlay , pour le
monticule du lac de Petit-Chat. Il pourrait y avoir doute pour celui du lac de Laffrey.
Remarquons que certaines îles sont séparées du rivage par des passes relativement
profondes. Ainsi la barre qui existe entre le Roselet et la pointe de Duingt,
au lac d’Annecy, a une profondeur de 17 mètres. Au lac d’Aiguebelette, on trouve,
entre la grande île et la côte sud des fonds de 14 mètres, entre la petite île et la côte
nord-est des fonds de 22 mètres. Entre l’île du lac d’Artouste et le rivage, la sonde
accuse 17 mètres. Les îles Borromées du lac Majeur sont aussi dans une
situation analogue4: Si le plan d’eau venaità s’abaisser de quelques mètres, toutes ces
saillies resteraient encore des îles.
1. Aï.ph. Favre, Desc. Gèol. du canton de Genèse, t. II, p . 39.
2. Les c é lèb r e s îl e s B o r rom é e s d u la c Majeur so n t a u s si c o n s titu é e s p ar la r o c h e e n p la c e . (Voir
Carte géologique de la Suisse au fô^ôôô’ fe u ille X x i l l , Domo d’Ossola-Arou a.)
3. J’a i to u t lie u d e cr o ir e q u e l’îlo t d u la c de Na r la y e s t ro c h e u x , sa n s to u te fo is p ou v o ir 1 a ffirmer
d’u n e fa çon ab so lu e.
4. V oir la ca r te h ydr o g rap hiq ue au du la c Majeur p u b lié e p ar la Marine I ta lienn e.