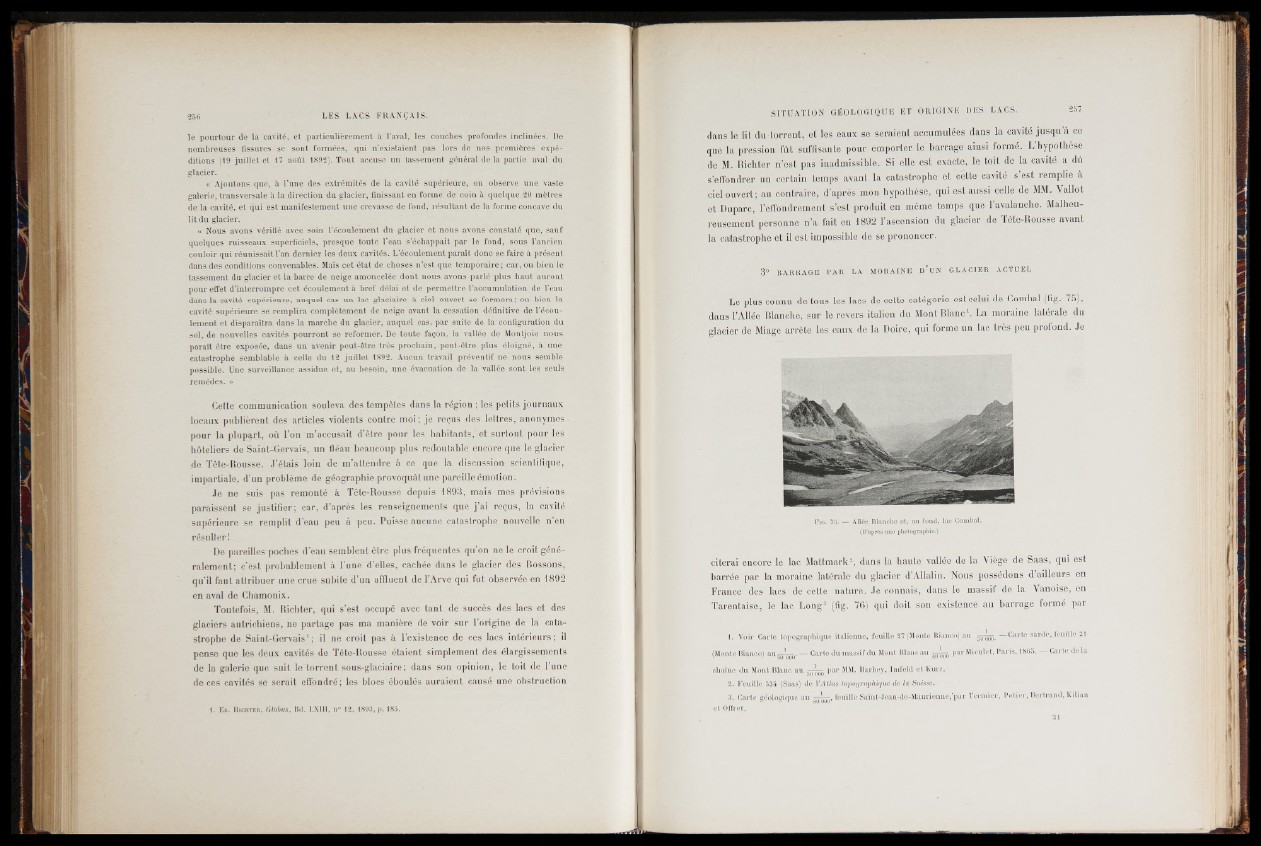
le p o u rto u r de la cavité, e t p a rticu liè rem en t à l’aval, le s couches p rofondes in c lin é e s. De
n om b re u se s fissu res se so n t formées, qui n ’existaient pas lo rs de n o s p rem iè re s ex p éditions
(19 ju ille t et 17 ao û t 4892). T o u t ac cuse un ta ssem en t g én é ra l de la partie aval du
gla cier.
« Ajoutons que, à l ’u n e des ex trém ité s de la cavité su p é rieu re , on observe u n e vaste
galerie, tra n sv e rs a le à la d ire c tio n du g la cier, fin issan t en forme de coin à q u elq u e 20 mè tres
de la cavité, e t q u i e s t man ife stem en t u n e creva sse de fond, ré s u lta n t de la forme concave du
lit d u glacier.
« Nous avons vérifié avec soin l ’éco u lem en t du gla cier e t n o u s av o n s consta té q u e , sau f
qu elq u es ru is se au x superficiels, p re sq u e to u te l’eau s ’éch ap p ait p a r le fond, so u s l ’ancien
co u lo ir q u i réu n is s a it l ’an d e rn ie r le s deux cavités. L’é co u lemen t p a ra ît donc se faire à p ré sen t
dan s des co nditions convenables. Mais c e t é ta t de ch o ses n ’e s t q u e tem p o ra ire ; ca r, ou b ie n le
ta ss em en t du g la cier e t la b a rre d e neige amoncelé e d o n t n o u s avons p a rlé p lu s h a u t a u ro n t
p o u r effet d’in te rrom p re c e t éco u lemen t à b re f délai e t de p e rm e ttre l ’a c cum u la tio n de l'eau
dan s la cavité su p é rie u re , au q u e l cas u n la c g la ciaire à ciel o u v e rt se fo rm e ra ; ou bien la
cavité su p é rie u re se rem p lira com p lè tem en t de n eige avant la ce ssation définitive de l ’écoulem
e n t e t d isp a ra îtra d ans la m a rch e du glacier, au q u e l ca s, p a r su ite de la configuration du
sol, de n o u v elles cavités p o u rro n t se re fo rm e r. De to u te façon, la vallée de Montjoie n o u s
p a ra ît ê tre exposée, dans u n av en ir p eu t-ê tre trè s p ro ch a in , p eu t-ê tre p lu s é loigné, à u n e
c a ta stro p h e sem b lab le à celle du 12 ju ille t 1892. Aucun travail p rév en tif n e n o u s semble
possible. Une su rveillance a ssid u e e t, au besoin, u n e évacuation de la vallée so n t le s seu ls
rem èd e s. »
Cette communication souleva des tempêtes dans la région ; les petits journaux
locaux publièrent des articles violents contre moi; je reçus des lettres, anonymes,
pour la plupart, où l’on m’accusait d’être pour les habitants, et surtout pour les
hôteliers de Saint-Gervais, un fléau beaucoup plus redoutable encore que le glacier
de Têle-Rousse. J’étais loin de m’attendre à ce que la discussion scientifique,
impartiale, d’un problème de géographie provoquât une pareille émotion.
Je ne suis pas remonté à Tête-Rousse depuis 1893, mais mes prévisions
paraissent se justifier; car, d’après les renseignements que j ’ai reçus, la cavité
supérieure se remplit d’eau peu à peu. Puisse aucune catastrophe nouvelle n’en
résulter!
De pareilles poches d’eau semblent être plus fréquentes qu’on ne le croit généralement;
c’est probablement à l’une d’elles, cachée dans le glacier des Bossons,
qu’il faut attribuer une crue subite d’un affluent de l’Arve qui fut observée en 1892
en aval de Chamonix.
Toutefois, M. Richter, qui s’est occupé avec tant de succès des lacs et des
glaciers autrichiens, ne partage pas ma manière de voir sur l’origine de la catastrophe
de Saint-Gervais1; il ne croit pas à l’existence de ces lacs intérieurs; il
pense que les deux cavités de Tête-Rousse étaient simplement des élargissements
de la galerie que suit le torrent sous-glaciaire; dans son opinion, le toit de l’une
de ces cavités se serait effondré; les blocs éboulés auraient causé une obstruction
1 . E d . R i c h t e r , Globus, Bd. LXIII, n ° 1 2 , 1 8 9 3 , p . 185,
dans le lit du torrent, et les eaux se seraient accumulées dans la cavité jusqu’à ce
que la pression fût suffisante pour emporter le barrage ainsi formé. L’hypothèse
de M. Richter n’est pas inadmissible. Si elle est exacte, le toit de la cavité a dû
s’effondrer un certain temps avant la catastrophe et cette cavité s’est remplie à
ciel ouvert; au contraire, d’après mon hypothèse, qui est aussi celle de MM. Vallot
et Duparc, l’effondrement s’est produit en même temps que 1 avalanche. Malheureusement
personne n’a fait en 1892 l’ascension du glacier de Tête-Rousse avant
la catastrophe et il est impossible de se prononcer.
3° B A R R A G E PA R L A M O R A IN E d ’ ü N G L A C IE R A C T U E L
Le plus connu de tous les lacs de cette catégorie est celui de Combal (fig. 75),
dans l’Allée Blanche, sur le revers italien du Mont Blanc*. La moraine latérale du
glacier de Miage arrête les eaux de la Doire, qui forme un lac très peu profond. Je
F ig . 75. — Allée Blanche et, au fond, lac Gonibal.
(D’aprè s une photographie.)
citerai encore le lac Mattmark2, dans la haute vallée de la Yiège de Saas, qui est
barrée par la moraine latérale du glacier d’Allalin. Nous possédons d’ailleurs en
France des lacs de cette nature. Je connais, dans le massif de la Yanoise, en
Tarentaise, le lac Long3 (fig. 76) qui doit son existence au barrage formé par
1. Voir Carte top ograp h iq u e ita lien n e , fe u ille 27 (Monte Bianco) a u 50005. Carte sa rd e , feu ille 21
(Monte Bianco) a u —Lj-0. — Carte du m a ssif du Mont Blanc a u par M ieulet, P a r is, 1865. Carte d e là
ch a în e du Mont Blanc au 50 q0ô p ar MM. Barbey, Imfeld e t Kurz.
2 . F eu ille 534 (Saas) de l ’A tla s topographique de la Suisse.
3. Carte g é o lo g iq u e au fe u ille Sain t-Jean -d e-M aur ienn e,'p ar T erm ie r , P o tie r , Bertrand, Kilian
e t Offret.