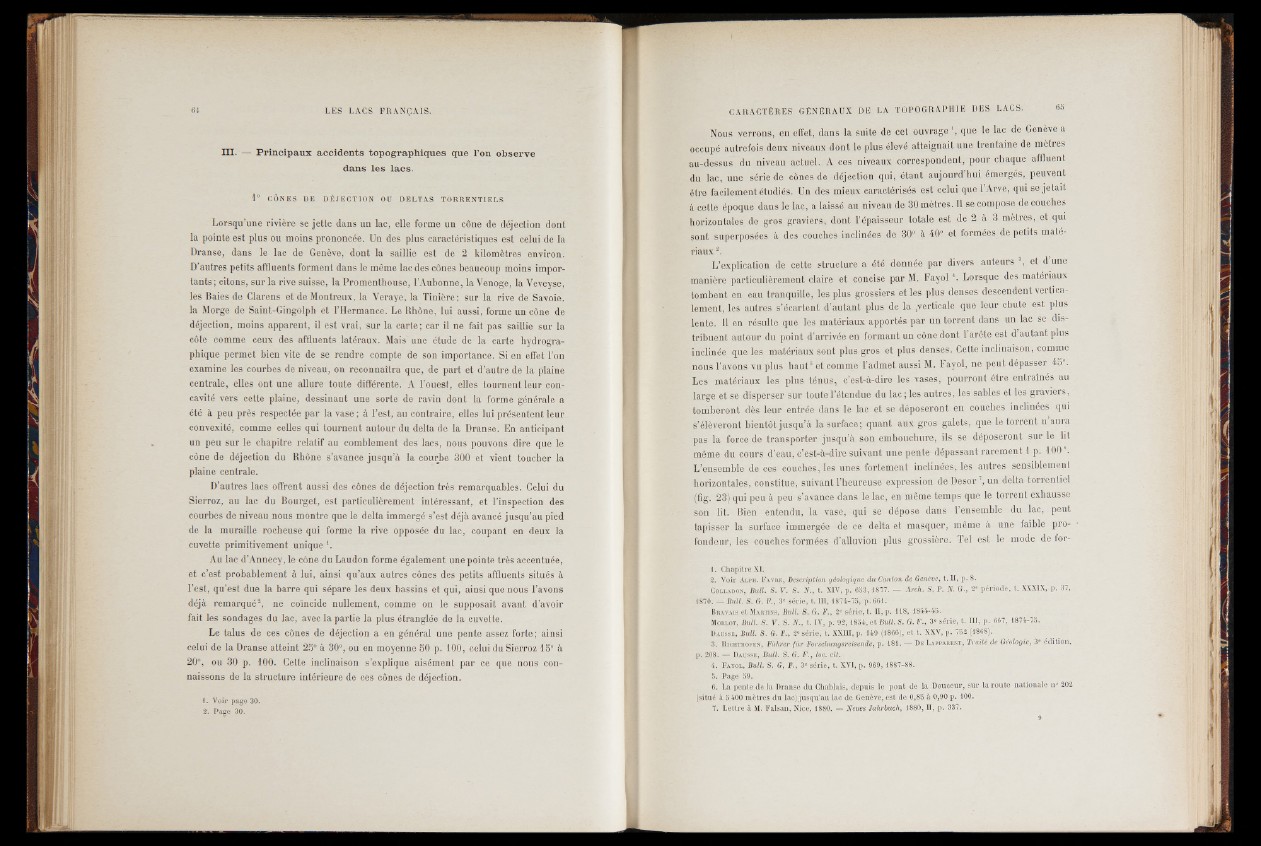
m . — Principaux accidents topographiques que l’on observe
dans le s lacs.
1" C Ô N E S D E D É JE C T IO N OD D E L T A S T O R R E N T IE L S
Lorsqu’une rivière se jette dans un lac, elle forme un cône de déjection dont
la pointe est plus ou moins prononcée. Un des plus caractéristiques est celui de la
Dranse, dans le lac de Genève, dont la saillie est de 2 kilomètres environ.
D’autres petits affluents forment dans le même lac des cônes beaucoup moins importants
; citons, sur la rive suisse, la Promenthouse, l’Aubonne, la Venoge, la Veveyse,
les Baies de Clarens et de Montreux, la Veraye, la Tinière; sur la rive de Savoie,
la Morge de Saint-Gingolph et l’Hermance. Le Rhône, lui aussi, forme un cône de
déjection, moins apparent, il est vrai, sur la carte; car il ne fait pas saillie sur la
côte comme ceux des affluents latéraux. Mais une étude de la carte hydrographique
permet bien vite de se rendre compte de son importance. Si en effet l’on
examine les courbes de niveau, on reconnaîtra que, de part et d’autre de la plaine
centrale, elles ont une allure toute différente. A l’ouest, elles tournent leur concavité
vers cette plaine, dessinant une sorte de ravin dont la forme générale a
été à peu près respectée par la vase ; à l’est, au contraire, elles lui présentent leur
convexité, comme celles qui tournent autour du delta de la Dranse. En anticipant
un peu sur le chapitre relatif au comblement des lacs, nous pouvons dire que le
cône de déjection du Rhône s’avance jusqu’à la courbe 300 et vient toucher la
plaine centrale.
D’autres lacs offrent aussi des cônes de déjection très remarquables. Celui du
Sierroz, au lac du Bourget, est particulièrement intéressant, et l’inspection des
courbes de niveau nous montre que le delta immergé s’est déjà avancé jusqu’au pied
de la muraille rocheuse qui forme la rive opposée du lac, coupant en deux la
cuvette primitivement unique '.
Au lac d’Annecy, le cône du Laudon forme également une pointe très accentuée,
et c’est probablement à lui, ainsi qu’aux autres cônes des petits affluents situés à
l’est, qu’est due la barre qui sépare les deux bassins et qui, ainsi que nous l’avons
déjà remarqué2, ne coïncide nullement, comme on le supposait avant d’avoir
fait les sondages du lac, avec la partie la plus étranglée de la cuvette.
Le talus de ces cônes de déjection a en général une pente assez forte; ainsi
celui de la Dranse atteint 25° à 30°, ou en moyenne 50 p. 100, celui du Sierroz 15° à
20°, ou 30 p. 100. Cette inclinaison s’explique aisément par ce que nous connaissons
de la structure intérieure de ces cônes de déjection.
1. Voir pa g e 30.
2. P a g e 30.
Nous verrons, en effet, dans la suite de cet ouvrage *, que le lac de Genève a
occupé autrefois deux niveaux dont le plus élevé atteignait une trentaine de mètres
au-dessus du niveau actuel. A ces niveaux correspondent, pour chaque affluent
du lac, une série de cônes de déjection qui, étant aujourd hui émergés, peuvent
être facilement étudiés. Un des mieux caractérisés est celui que l’Arve, qui se jetait
à cette époque dans le lac, a laissé au niveau de 30 mètres. Il se compose de couches
horizontales de gros graviers, dont l’épaisseur totale est de 2 à 3 mètres, et qui
sont superposées à des couches inclinées de 30° à 40° et formées de petits matériaux
2.
L’explication de cette structure a été donnée par divers auteurs 3, et d une
manière particulièrement claire et concise par M. Fayol4. Lorsque des matériaux
tombent en eau tranquille, les plus grossiers et les plus denses descendent verticalement,
les autres s’écartent d’autant plus de la ,verticale que leur chute est plus
lente. 11 en résulte que les matériaux apportés par un torrent dans un lac se dis-,
tribuent autour du point d’arrivée en formant un cône dont l’arête est d autant plus
inclinée que les matériaux sont plus gros et plus denses. Cette inclinaison, comme
nous l’avons vu plus haut5 et comme l’admet aussi M. Fayol, ne peut dépasser 45 .
Les matériaux les plus ténus, c’est-à-dire les vases, pourront être entraînés au
large et se disperser sur toute l’étendue du lac; les autres, les sables et les graviers,
tomberont dès leur entrée dans le lac et se déposeront en couches inclinées qui
s’élèveront bientôt jusqu’à la surface; quant aux gros galets, que le torrent n aura
pas la force de transporter jusqu’à son embouchure, ils se déposeront sur le lit
même du cours d’eau, c’est-à-dire suivant une pente dépassant rarement 1 p. 100 .
L’ensemble de ces couches, les unes fortement inclinées, les autres sensiblement
horizontales, constitue, suivant l’heureuse expression de Desor7, un delta torrentiel
(fig. 23) qui peu à peu s’avance dans le lac, en même temps que le torrent exhausse
son lit. Bien entendu, la vase, qui se dépose dans l’ensemble du lac, peut
tapisser la surface immergée de ce delta et masquer, même à une faible profondeur,
les couches formées d’alluvion plus grossière. Tel est le mode de for-
1. Chapitre XI.
2 . V o ir A lp h . F a vu e , Description géologique du Canton d e Genève, t . II, p . 8 .
Colladon, Bull. S. V . S . N ., t. XIV, p . 653, 1877. — Arch. S. P . IV. G., 2e p é r io d e , t . XXXIX, p . 37,
1870. — Bull. S. G. F., 3° s é r ie , t . III, 1 8 7 4-75, p . 661.
B ravais e t Ma rtins, Bull. S . G. F ., 2° s é r ie , t. II, p . 118, 1844-45.
Morlot, Bull. S . V . S . N ., t. IV, p. 9 2 ,1 8 5 4 , e t B ull. S. G. F ., 3« sé r ie , t. III, p . 667, 1874-75.
D a u s se, B ull. S . G. F., 2° sé r ie , t. XXIII, p . 149 (1866), e t t. XXV, p . 752 (1868).
3. R ichthofen, Führer fu r Forschungsreisende, p . 181. — D e Lapparent, T ra ité de Géologie, 3e éd itio n ,
p. 208. — D ausse, B ull. S. G. F ., loc. cit.
4 . F ayol, Bull. S . G, F., 3° s é r ie , t. XVI, p . 969, 1887-88.
5. Page 59.
6 . La p en te d e la Dranse du Chablais, d ep uis l e p o n t d e la Dou ceur , su r la ro u te n a tio n a le n d 202
(situé à 5 400 m è tr e s du lac) ju sq u ’au la c d e Genève, e s t d e 0,85 à 0 ,9 0 p . 100.
7. L ettre à M. F a isan, N ic e , 1880. — Neues Jahrbuch, 1880, II, p . 337.