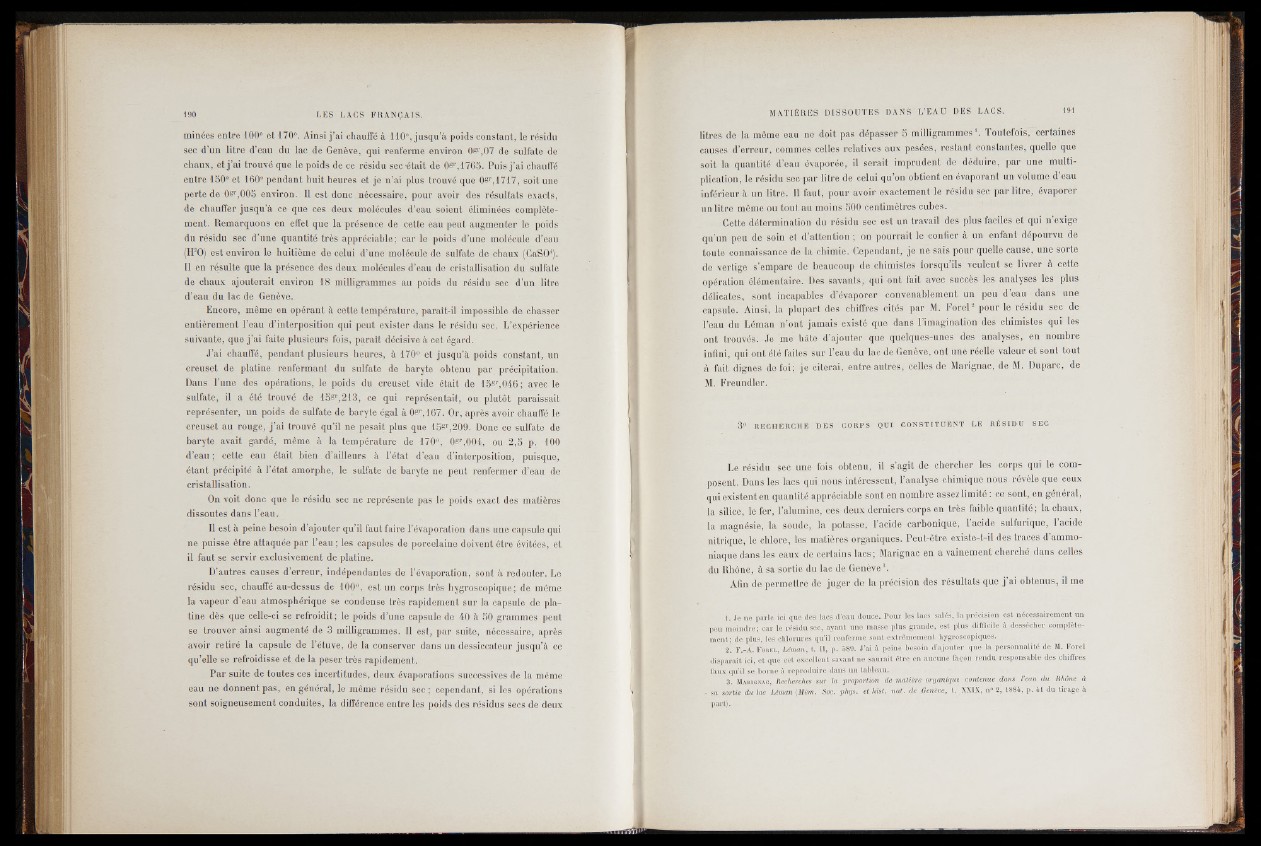
minées entre 1 0 0 ° et 1 7 0 ° . Ainsi j ’ai chauffé à 1 1 0 ° , jusqu’à poids constant, le résidu
sec d’un litre d’eau du lac de Genève, qui renferme environ 0 s> ',0 7 de sulfate de
chaux, et j’ai trouvé que le poids de ce résidu sec-était de Puis j’ai chauffé
entre 1 5 0 ° et 1 6 0 ° pendant huit heures et je n’ai plus trouvé que 0 s r , 1 7 1 7 , soit une
perte de Os^OOS environ. Il est donc nécessaire, pour avoir des résultats exacts,
de chauffer jusqu’à ce que ces deux molécules d’eau soient éliminées complètement.
Remarquons en effet que la présence de cette eau peut augmenter le poids
du résidu sec d’une quantité très appréciable; car le poids d’une molécule d’eau
(HsO) est environ le huitième de celui d’une molécule de sulfate de chaux (CaSO*).
Il en résulte que la présence des deux molécules d’eau de cristallisation du sulfate
de chaux ajouterait environ 1 8 milligrammes au poids du résidu sec d’un litre
d’eau du lac de Genève.
Encore, même en opérant à cette température, paraît-il impossible de chasser
entièrement l’eau d’interposition qui peut exister dans le résidu sec. L’expérience
suivante, que j ’ai faite plusieurs fois, paraît décisive à cet égard.
J’ai chauffé, pendant plusieurs heures, à 1 7 0 ° et jusqu’à poids constant, un
creuset de platine renfermant du sulfate de baryte obtenu par précipitation.
Dans l’une des opérations, le poids du creuset vide était de 1 5 s* ’, 0 4 6 ; avec le
sulfate, il a été trouvé de 1 5 s r, 2 1 3 , ce qui représentait, ou plutôt paraissait
représenter, un poids de sulfate de baryte égal à 0 « r , 1 6 7 . Or, après avoir chauffé le
creuset au rouge, j ’ai trouvé qu’il ne pesait plus que 15®r , 2 0 9 . Donc ce sulfate de
baryte avait gardé, même à la température de 1 7 0 ° , 0 e r , 0 0 4 , ou 2 , 5 p. 1 0 0
d’eau ; cette eau était bien d’ailleurs à l’état d’eau d’interposition, puisque,
étant précipité à l’état amorphe, le sulfate de baryte ne peut renfermer d’eau de
cristallisation.
On voit donc que le résidu sec ne représente pas le poids exact des matières
dissoutes dans l’eau.
Il est à peine besoin d’ajouter qu’il faut faire l’évaporation dans une capsule qui
ne puisse être attaquée par l’eau ; les capsules de porcelaine doivent être évitées, et
il faut se servir exclusivement de platine.
D’autres causes d’erreur, indépendantes de l’évaporation, sont à redouter. Le
résidu sèc, chauffé au-dessus de 100°, est un corps très hygroscopique ; de même
la vapeur d’eau atmosphérique se condense très rapidement sur la capsule de platine
dès que celle-ci se refroidit; le poids d’une capsule de 4 0 à 5 0 grammes peut
se trouver ainsi augmenté de 3 milligrammes. II est, par suite, nécessaire, après
avoir retiré la capsule de l’étuve, de la conserver dans un dessiccateur jusqu’à ce
qu’elle se refroidisse et. de la peser très rapidement.
Par suite de toutes ces incertitudes, deux évaporations successives de la même
eau ne donnent pas, en général, le même résidu sec; cependant, si les opérations
sont soigneusement conduites, la différence entre les poids des résidus secs de deux
litres de la même eau ne doit pas dépasser 5 milligrammes1. Toutefois, certaines
causes d’erreur, commes celles relatives aux pesées, restant constantes, quelle que
soit la quantité d’eau évaporée, il serait imprudent de déduire-, par une multiplication,
le résidu sec par litre de celui qu’on obtient en évaporant un volume d’eau
inférieur à un litre. Il faut, pour avoir exactement le résidu sec par litre, évaporer
un litre même ou tout au moins 5 0 0 centimètres cubes.
Cette détermination du résidu sec est un travail des plus faciles et qui n’exige
qu’un peu de soin et d’attention ; on pourrait le confier à un enfant dépourvu de
toute connaissance de la chimie. Cependant, je ne sais pour quelle cause, une sorte
de vertige s’empare de beaucoup de chimistes lorsqu’ils veulent se livrer à cette
opération élémentaire. Des savants, qui ont fait avec succès les analyses les plus
délicates, sont incapables d’évaporer convenablement un peu d’eau dans une
capsule. Ainsi, la plupart des chiffres cités par M. Forel1 pour le résidu sec de
l’eau du Léman n’ont jamais existé que dans l ’imagination des chimistes qui les
ont trouvés. Je me hâte d’ajouter que quelques-unes des analyses, en nombre
infini, qui ont été faites sur l’eau du lac de Genève, ont une réelle valeur et sont tout
à fait dignes de foi; je citerai, entre autres, Celles de Marignac, de M. Duparc, de
M. Freundler.
3 ° R E C H E R C H E D E S CO R P S QUI C O N S T IT U E N T LE R É S ID U SEC
Le résidu sec une fois obtenu, il s’agit de chercher les corps qui le composent.
Dans les lacs qui nous intéressent, l’analyse chimique nous révèle que ceux
qui existent en quantité appréciable sont en nombre assez limité : ce sont, en général,
la silice, le fer, l ’alumine, ces deux derniers corps en très faible quantité; la chaux,
la magnésie, la soude, la potasse, l’acide carbonique, l’acide sulfurique, l’acide
nitrique, le chlore, les matières organiques. Peut-être existe-t-il des traces d’ammoniaque
dans les eaux de certains lacs; Marignac en a vainement cherché dans celles
du Rhône, à sa sortie du lac de Genève3.
Afin de permettre de juger de la précision des résultats que j’ai obtenus, il me
1. J© n6 p a rle i c i q u e des la c s d’ea u d o u c e . P o u r le s la c s sa lé s , la p r é c isio n e s t n é c e s sa ir em e n t un
p eu m o in dr e ; car l e r é sid u s e c , a yan t u n e m a sse p lu s g ran d e, e s t p lu s d iffic ile à d e ssé ch e r c om p lè te m
e n t; de p lu s, le s ch lo ru r e s q u'il r e n f e rm e r o n t e x t r êm em e n t h y g ro sco p iq u e s.
2 F -A . F orel, Léman, t. II, p . 589. J’ai à p e in e b e so in d’a jou te r q u e la p e r so n n a lité d e M. F o r e l
disp a ra ît ic i, e t q u e c e t e x c e llen t savant n e sau ra it ê tr e en a u cu n e fa ç on r en d u re sp o n sa b le des chiffres,
fau x q u ’il se b orn e il rep r od u ir e dans u n tab leau .
3. Marigkac, Recherches sur la p ro p o rtion de m a tiè re organique contenue dans l’eau d u Rhône à
- sa so rtie du lac Léman (Mém. Soc. p h y s . e t h ist. n a t. de Genève, t. XXIX, n" î , 1884, p . 41 du tira g e à
part).