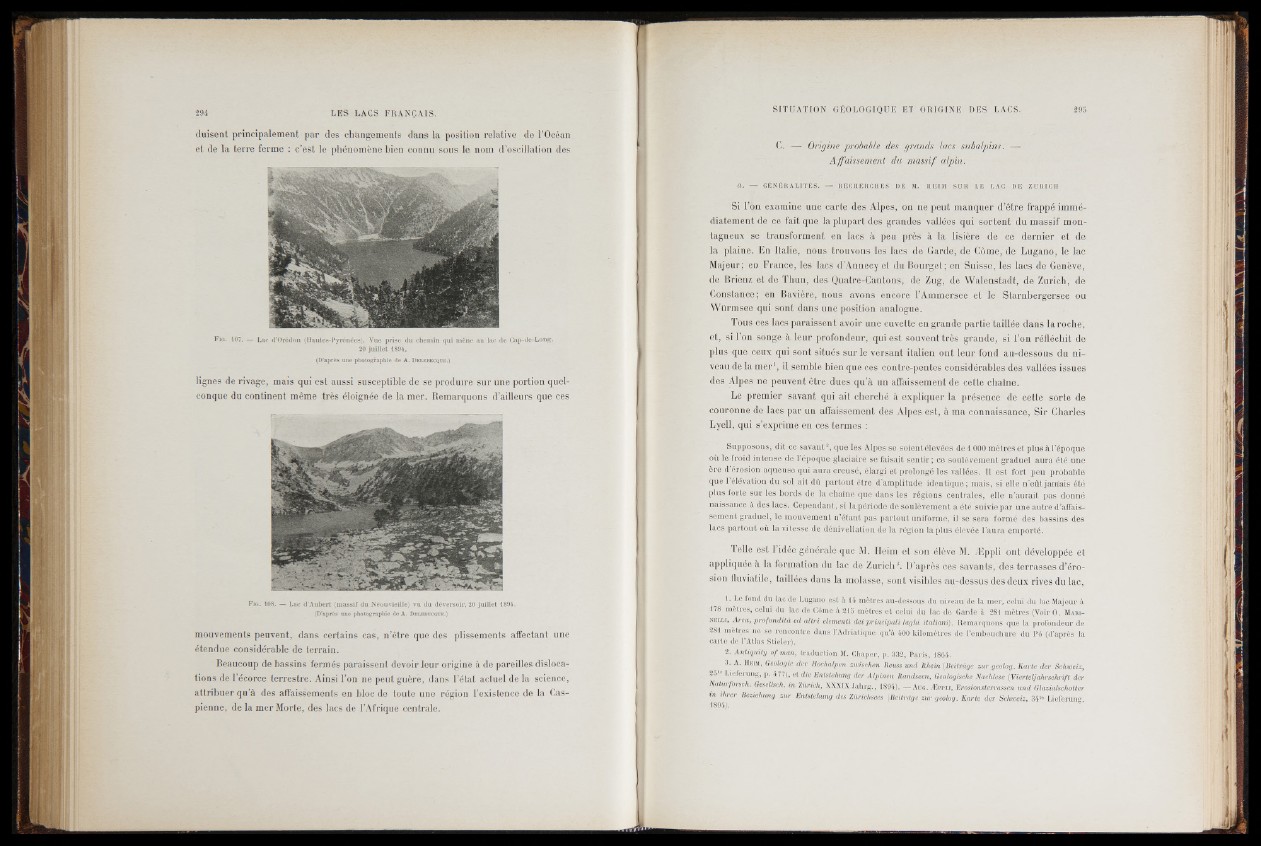
duisent principalement par des changements dans la position relative de l’Océan
et de la terre ferme : c’est le phénomène bien connu sous le nom d’oscillation des
Fig. 107. — Lac d’Orédon (Hautes-Pyrénées). Vue prise du chemin qui mène au lac. de Cap-de-Long,
20 juillet 1894.
(D’ap rè s une photographie de À. Delerecquk.)
lignes de rivage, mais qui est aussi susceptible de se produire sur une portion quelconque
du continent même très éloignée de la mer. Remarquons d’ailleurs que ces
Fig. 108. — Lac d’Aubert (massif du Néouvieille) vu du déversoir, 20 juillet 1894.
(D'après une photographie de A. D e le b e c q ü e .)
mouvements peuvent, dans certains cas, n’être que des plissements affectant une
étendue considérable de terrain.
Beaucoup de bassins fermés paraissent devoir leur origine à de pareilles dislocations
de l’écorce terrestre. Ainsi l’on ne peut guère, dans l’état actuel de la science,
attribuer qu’à des affaissements en bloc de toute une région l’existence de la Caspienne,
delà mer Morte, des lacs de l’Afrique centrale.
C. — Origine probable des grands lacs subalpins. —
Affaissement du massif alpin.
a . — GÉNÉRALITÉS. — RECHERCHES DE M. HEIM SUR LE LAC DE ZURICH
Si l’on examine une carte des Alpes, on ne peut manquer d’être frappé immédiatement
de ce fait que la plupart des grandes vallées qui sortent du massif montagneux
se transforment en lacs à peu près à la lisière de ce dernier et de
la plaine. En Italie, nous trouvons les lacs de Garde, de Còme, de Lugano, le lac
Majeur; en France, les lacs d’Annecy et du Bourget; en Suisse, les lacs de Genève,
de Brienz et de Thun, des Quatre-Cantons, de Zug, de Walenstadt, de Zurich, de
Constance; en Bavière, nous avons encore l’Ammersee et le Starnbergersee ou
Würmsee qui sont dans une position analogue.
Tous ces lacs paraissent avoir une cuvette en grande partie taillée dans la roche,
et, si l’on songe à leur profondeur, qui est souvent très grande, si l’on réfléchit de
plus que ceux qui sont situés sur le versant italien ont leur fond au-dessous du niveau
de la mer1, il semble bien que ces contre-pentes considérables des vallées issues
des Alpes ne peuvent être dues qu’à un affaissement de cette chaîne.
Le premier savant qui ait cherché à expliquer la présence de cette sorte de
couronne de lacs par un affaissement des Alpes est, à ma connaissance, Sir Charles
Lyell, qui s’exprime en ces termes :
S u p p o s o n s , d it c e s a v a n t 2, q u e l e s A lp e s s e s o i e n t é l e v é e s d e 1 0 0 0 m è t r e s e t p lu s à l ’é p o q u e
o ù l e f r o id in t e n s e d e l ’é p o q u e g la c ia i r e s e fa i s a i t s e n t i r ; c e s o u l è v em e n t g r a d u e l a u r a é t é u n e
è r e d é r o s io n a q u e u s e q u i a u r a c r e u s é , é la r g i e t p r o lo n g é l e s v a l l é e s . I l e s t fo r t p e u p r o b a b l e
q u e 1 é l é v a t io n d u s o l a i t d û p a r to u t ê t r e d ’am p l itu d e id e n t iq u e ; m a i s , s i e l l e n ’e û t j a m a is é t é
p lu s fo r te s u r l e s b o r d s d e la c h a în e q u e d a n s l e s r é g io n s c e n t r a l e s , e l l e n ’a u r a it p a s d o n n é
n a is s a n c e à d e s l a c s . C e p e n d a n t , s i la p é r io d e d e s o u l è v em e n t a é t é s u iv i e p a r u n e a u t r e d ’a ff a is s
em e n t g r a d u e l, l e m o u v em e n t n ’é t a n t p a s p a r to u t u n i f o rm e , il s e s e r a f o rm é d e s b a s s in s d e s
l a c s p a r to u t o ù la v i t e s s e d e d é n iv e l la t io n d e la r é g io n la p lu s é l e v é e l ’a u r a em p o r t é .
Telle est 1 idée générale que M. Heim et son élève M. Æppli ont développée et
appliquée à formation du lac de Zurich3. D’après ces savants, des terrasses d’érosion
fluviatile, taillées dans la molasse, sont visibles au-dessus des deux rives du lac,
1. Le fon d du la c d e Lùgano e s t à 14 m è tr e s a u -d e sso u s du n iv e au de la m e r , c e lu i du la c Majeur à
178 m è tr e s, ce lu i du la c d e Còme à 215 m è tr e s e t c e lu i d u la c d e Garde à 281 m è tr e s (Voir O. Marinelli,
A rea , p ro fo n d ità ed a ltr i elementi d e i p r in c ip a li la ghi ita lia n i). R ema rq u ons q u e la p r o fo n d eu r de
281 m è tr e s n e s e r en c o n tr e d ans l ’A d ria tiq ue qu ’à 400 k ilom è tr e s d e l ’em b o u ch u r e d u Pô (d’a p rès la
car te de l ’Atlas S tie le r ).
2. A n tiq u ity o f man, tr adu ction M. Ghaper, p . 332, P a r is, 1864.
3. A. Heim, Geologie d e r Hochalpen zw ischen Reuss u nd Rhein (Beiträge zu r geolog. K a r te d e r S chweiz,
25 t0 Lie fe rung, p. 477), e t die Entstehung d e r A lp in en Randseen, Geologische Nachlese (V ierteljahrschrift d e r
Naturforsch. Gesellsch. in Zürich, XXXIX J ah rg., 1894)M Aug. Æ ppli, Erosionsterrassen u n d Glazialschotter
in ihrer Beziehung zu r Entstehung des Zürichsees (Beiträge zu r geolog. K a rte d e r Schweiz, 3410 Lie fe ru ng,
1894).