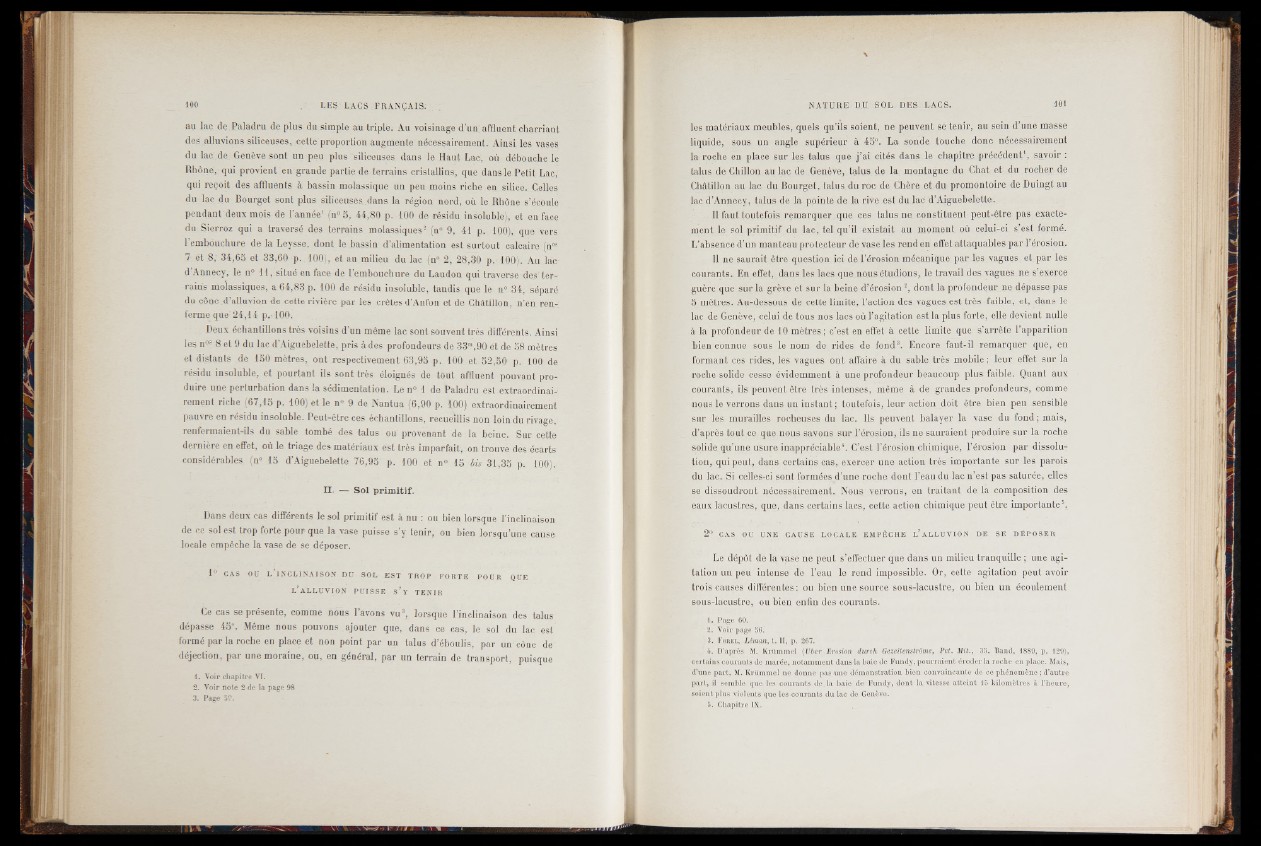
au lac de Paladru de plus du simple au triple. Au voisinage d’un affluent charriant
des alluvions siliceuses, cette proportion augmente nécessairement. Ainsi les vases
du lac de Genève sont un peu plus siliceuses dans le Haut Lac, où débouche le
Rhône, qui provient en grande partie de terrains cristallins, que dans le Petit Lac,’
qui reçoit des affluents à bassin molassique un peu moins riche en silice. Celles
du lac du Bourget sont plus siliceuses dans la région nord, où le Rhône s’écoule
pendant deux mois de l’année* (n°S, 44,80 p. 100 de résidu insoluble), et en face
du Sierroz qui a traversé des terrains molassiques* (n° 9, 41 p. 100), que vers
1 embouchure de la Leysse, dont le bassin d’alimentation est surtout calcaire (nos
7 ët 8, 34,65 et 33,60 p. 100), et au milieu du lac (n° 2, 28,30 p. 100). Au lac
d Annecy, le n° 11, situé en face de l'embouchure du Laudon qui traverse des'terrains
molassiques, a 64,83 p. 100 de résidu insoluble, tandis que le n° 34, séparé
du cône d’alluvion de cette rivière par les crêtes d’Anfon et de Châtillon, n’en renferme
que:24,14 p.-100.
Deux échantillons très voisins d’un même lac sont souvent très différents. Ainsi
les nos 8 et 9 du lac d’Aiguebelette, pris à des profondeurs de 33”,90 ët de 58 mètres
et distants de 150 mètres, ont respectivement 63,95 p. 100 et 52,50 p. 100 de
résidu insoluble, et pourtant ils sont très éloignés de tout affluent pouvant produire
une perturbation dans la sédimentation. Le n° 1 de Paladru est extraordinairement
riche (67,15 p. 100) et le n° 9 de Nautua (6,90 p. 100) extraordinairement
pauvre en résidu insoluble. Peut-être ces échantillons, recueillis non loin du rivage,’
renfermaient-ils du sable tombé des talus ou provenant de la beine. Sur cette
dernière en effet, où le triage des matériaux est très imparfait, on trouve des écarts
considérables (n° 15 d’Aiguebelette 76,95 p. 100 et n° 15 bis 31,35 p. 100).
H. — Sol primitif.
Ds.ds d e u x c as d ifféren ts le sol p rim itif e s t à n u : ou b ien lo rsq u e l ’in c lin a iso n
d e ce so l e s t tro p fo rte p o u r q u e la v ase p u is se s ’y te n ir , ou b ien lo r s q u ’u n e c au se
loc a le em p ê ch e la vase d e se d é p o se r.
1 ° CAS OU L IN C L IN A ISO N D U SOL E S T T R O P FO R T E P O U R QUE
l ’ a l l u v i o n p u i s s e s ’ y t e n i r
Ce cas se présente, comme nous l’avons vu3, lorsque l’inclinaison des talus
dépasse 45°. Même nous pouvons ajouter que, dans ce cas, le sol du lac est
formé par la roche en place et non point par un talus d’éboulis, par un cône de
déjection, par une moraine, ou, en général, par un terrain de transport, puisque
1. Voir chapitre VI.
2. Voir note 2 de la page 98
3. Page 59.
les matériaux meubles, quels qu’ils soient, ne peuvent se tenir, au sein d’une masse
liquide, sous un angle supérieur à 45°. La sonde touche donc nécessairement
la roche en place sur les talus que j ’ai cités dans le chapitre précédent1, savoir :
talus de Chillon au lac de Genève, talus de la; montagne du Chat et; du rocher de
Châtillon au lac du Bourget, talus du roc de Chère et du promontoire deDuingtau
lac d’Annecy, talus de la pointe de la rive est du lac d’Aiguebelette. .
Il faut toutefois remarquer que ces talus ne constituent peut-être pas exactement
le sol primitif du lac, tel qu’il existait au moment, où celui-ci s’est formé.
L’absence d’un manteau protecteur de vase les rend en effet attaquables par l’érosion.
11 ne saurait être question ici de l’érosion mécanique par les vagues, et par les
courants- En effet, dans les lacs que nous étudions, le travail des vagues ne s’exerce
guère que sur la grève et sur la beine d’érosion8, dont la profondeur ne dépasse pas
5 mètres. Au-dessous de cette limité, l’action des vagues est très faible, et, dans le
lac de Genève, celui de tous nos lacs où l’agitation est la plus forte, elle devient nulle
à la profondeur de 10 mètres ; c’est en effet à cette limite que s’arrête l’apparition
bien connue sous le nom de rides de fond3. Encore faut-il remarquer que, en
formant ces rides, les vagues ont affaire à du sable très mobile; leur effet sur la
roche solide cesse évidemment à une profondeur beaucoup plus faible. Quant aux
courants, ils peuvent être très intenses, même à de grandes profondeurs, comme
nous le verrons dans un instant ; toutefois, leur action doit être bien peu sensible
sur les murailles rocheuses du lac. Ils peuvent balayer la vase du fond ; mais,
d’après tout ce que nous savons sur l’érosion, ils ne sauraient produire sur la roche
solide qu’une usure inappréciable4. C’est l’érosion chimique, l ’érosion par dissolution,
qui peut, dans certains cas, exercer une action très importante sur les parois
du lac. Si celles-ci sont formées d’une roche dont l’eau du lac n’est pas saturée, elles
se dissoudront nécessairement. Nous verrons, en traitant de la composition des
eaux lacustres, que, dans certains lacs, cette action chimique peut être importante5,
2° CAS OU; U N E C A U SE LO C A L E EM P Ê C H E L’ A L L U V IO N D E S E D É P O S E R
Le dépôt de la vase ne peut s’effectuer que dans un milieu tranquille ; une agitation
un peu intense de l’eau le rend impossible. Or, cette agitation peut avoir
trois causes différentes : ou bien une source sous-lacustre, ou bien un écoulement
sous-lacustre, ou bien enfin des courants.
t . . P a g e 60.
2. Voir page 56.
. 3. F orel, Léman, t . II, p . 267.
4 . D’après M. Krümmc! (V b e r Erosion durch Gezcilcnstrômc, P e t. M it., 3b. Band, 1889, p . 129),
ce rta in s courants d e m a r é e , n o tam m en t d ans la b a ie d e Fu nd y , p o u r ra ien t é rode r la ro ch e en p la c e . Mais,
d’u n e p art, M. Krümme l n e d on n e pas u n e d ém o n str a tio n b ie n co n v a in c a n te de c e p h én om èn e ; d’au tr e
part, il sem b le q u e le s co u ra n ts d e . la b a ie de F u n d y , d o n t la v ite s s e a tt e in t 15 k ilom è tr e s à l ’h eu r e ,
so ien t p lu s v io len ts que le s co u ra n ts du la c de Genève.
5. Chapitre IX.