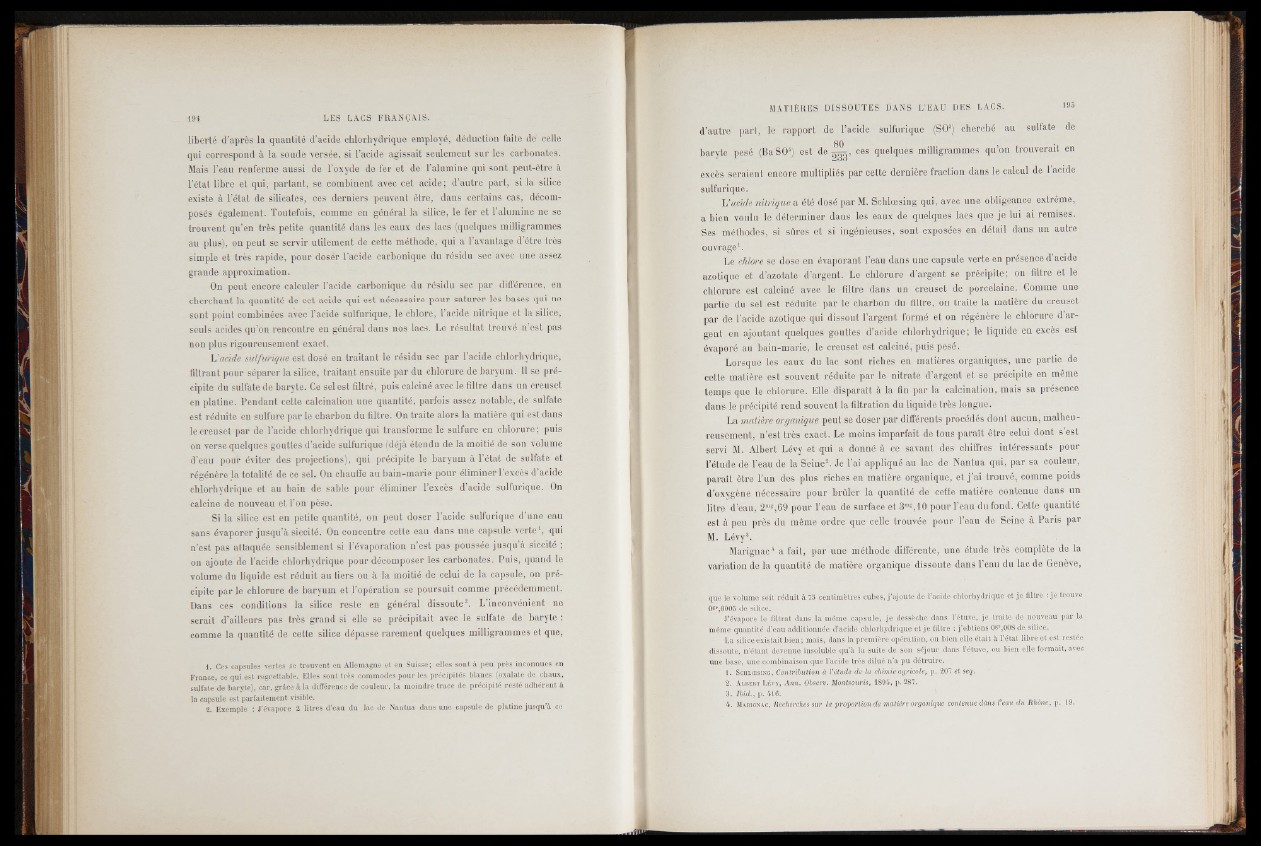
liberté d’après la quantité d’acide chlorhydrique employé, déduction faite de celle
qui correspond à la soude versée, si l’acide agissait seulement sur les carbonates.
Mais l’eau renferme aussi de l’oxyde de fer et de l’alumine qui sont peut-être à
l ’état libre et qui, partant, se combinent avec cet acide; d’autre part, si la silice
existe à l’état de silicates, ces derniers peuvent être, dans certains cas, décomposés
également. Toutefois, comme en général la silice, le fer et l’alumine ne se
trouvent qu’en très petite quantité dans les eaux des lacs (quelques milligrammes
au plus), on peut se servir utilement de cette méthode, qui a l’avantage d’être très
simple et très rapide, pour dosér l’acide carbonique du résidu sec avec une assez
grande approximation.
On peut encore calculer l’acide carbonique du résidu sec par différence, en
cherchant la quantité de cet acide qui est nécessaire pour saturer les bases qui ne
sont point combinées avec l’acide sulfurique, le chlore, l’acide nitrique et la silice,
seuls acides qu’on rencontre en général dans nos lacs. Le résultat trouvé n’est pas
non plus rigoureusement exact.
L’acide sulfurique est dosé en traitant le résidu sec par l’acide chlorhydrique,
filtrant pour séparer la silice, traitant ensuite par du chlorure de baryum. Il se précipite
du sulfate de baryte. Ce sel est filtré, puis calciné avec le filtre dans un creuset
en platine. Pendant cette calcination une quantité, parfois assez notable, de sulfate
est réduite en sulfure par le charbon du filtre. On traite alors la matière qui est dans
le creuset par de l’acide chlorhydrique qui transforme le sulfure en chlorure ; puis
on verse quelques gouttes d’acide sulfurique (déjà étendu de la moitié de son volume
d’eau pour éviter des projections), qui précipite le baryum à l ’état de sulfate et
régénère la totalité de ce sel. On chauffe au bain-marie pour éliminer l’excès d’acide
chlorhydrique et au bain de sable pour éliminer l’excès d’acide sulfurique. On
calcine de nouveau et l’on pèse.
Si la silice est en petite quantité, on peut doser l’acide sulfurique d’une eau
sans évaporer jusqu’à siccité. On concentre cette eau dans une capsule verte1, qui
n’est pas attaquée sensiblement si l’évaporation n’est pas poussée jusqu’à siccité ;
on ajoute de l’acide chlorhydrique pour décomposer les carbonates. Puis, quand le
volume du liquide est réduit au tiers ou à la moitié de celui de la capsule, on précipite
par le chlorure de baryum et l’opération se poursuit comme précédemment.
Dans ces conditions la silice reste en général dissoute8. L’inconvénient ne
serait d’ailleurs pas très grand si elle se précipitait avec le sulfate de baryte :
comme la quantité de cette silice dépasse rarement quelques milligrammes et que,
1. Ces capsules vertes se trouvent en Allemagne et en Suisse; elles sont à peu près inconnues en
France, ce qui est regrettable. Elles sont très commodes pour les précipités blancs (oxalate de chaux,
sulfate de baryte), car, grâce à la différence de couleur, la moindre trace de précipité resté adhérent à
la capsule est parfaitement visible.
2. Exemple : J’évapore 2 litres d’eau du lac de Nantua dans uile capsule de platine jusqu’à ce
d’autre part, le rapport de l’acide sulfurique (SO3) cherché au sulfate de
baryte pesé (Ba SO*) est de ^8g0g, ces quelques milligrammes qu’on trouverait en
excès seraient encore multipliés par cette dernière fraction dans le calcul de l’acide
sulfurique.
L'acide nitrique a été dosé par M. Schloesing qui, avec une obligeance extrême,
a bien voulu le déterminer dans les eaux de quelques lacs que je lui ai remises.
Ses méthodes, si sûres et si ingénieuses, sont exposées en détail dans un autre
ouvrage1.
Le chlore se dose en évaporant l’eau dans une capsule verte en présence d’acide
azotique et d’azotate d’argent. Le chlorure d’argent se précipite; on filtre et le
chlorure est calciné avec le filtre dans un creuset de porcelaine. Comme une
partie du sel est réduite par le charbon du filtre, on traite la matière du creuset
par de l’acide azotique qui dissout l’argent formé et on régénère le chlorure d’argent
en ajoutant quelques gouttes d’acide chlorhydrique; le liquide en excès est
évaporé au bain-marie, le creuset est calciné, puis pesé.
Lorsque les eaux du lac sont riches en matières organiques, une partie de
cette matière est souvent réduite par le nitrate d’argent et se précipite en même
temps que le chlorure. Elle disparaît à la fin par la calcination, mais sa présence
dans le précipité rend souvent la filtration du liquide très longue.
La matière organique peut se doser par différents procédés dont aucun, malheureusement,
n’est très exact. Le moins imparfait de tous parait être celui dont s’est
servi M. Albert Lévy et qui a donné à ce savant des chiffres intéressants pour
l’étude de l’eau de la Seine3. Je l’ai appliqué au lac de Nantua qui, par sa couleur,
paraît être l’un des plus riches en matière organique, et j ’ai trouvé, comme poids
d’oxygène nécessaire pour brûler la quantité de cette matière contenue dans un
litre d’eau, 2mg,69 pour l’eau de surface et 3"®, 10 pour l’eau du fond. Cette quantité
est à peu près du même ordre que celle trouvée pour l’eau de Seine à Paris par
M. Lévy3.
Marignac4 a fait, par une méthode différente, une étude très complète de la
variation de la quantité de matière organique dissoute dans l’eau du lac de Genève,
que le volume soit réduit à 75 centimètres cubes, j ’ajoute de l’acide chlorhydrique et je filtre : je trouve
0&r,0005 de silice.
J’évapore le filtrat dans la même capsule, je dessèche dans l’étuve, je traite de nouveau par la
même quantité d’eau additionnée d’acide chlorhydrique et je filtre : j ’obtiens 0^,008 de silice.
La silice existait bien; mais, dans la première opération, ou bien elle était à l’état libre et est restée
dissoute, n ’étant devenue insoluble qu’à la suite de son séjour dans l’étuve, ou bien elle formait, avec
une base, une combinaison que l’acide très dilué n’a pu détruire.
1 . S chloesing, Contribution à l’étude de la chimie agricole, p . 2 0 7 e t seq.
2 . A lb e r t Lisyy, Ann. Obsen). Montsouris, 1 8 9 4 , p . 2 8 7 .
. 3. Ib id ., p. 416.
4 . Marignac, Recherches sur la p ro p o rtio n de matiè re organique contenue dâns l’eau d u Rhône, p. 19.