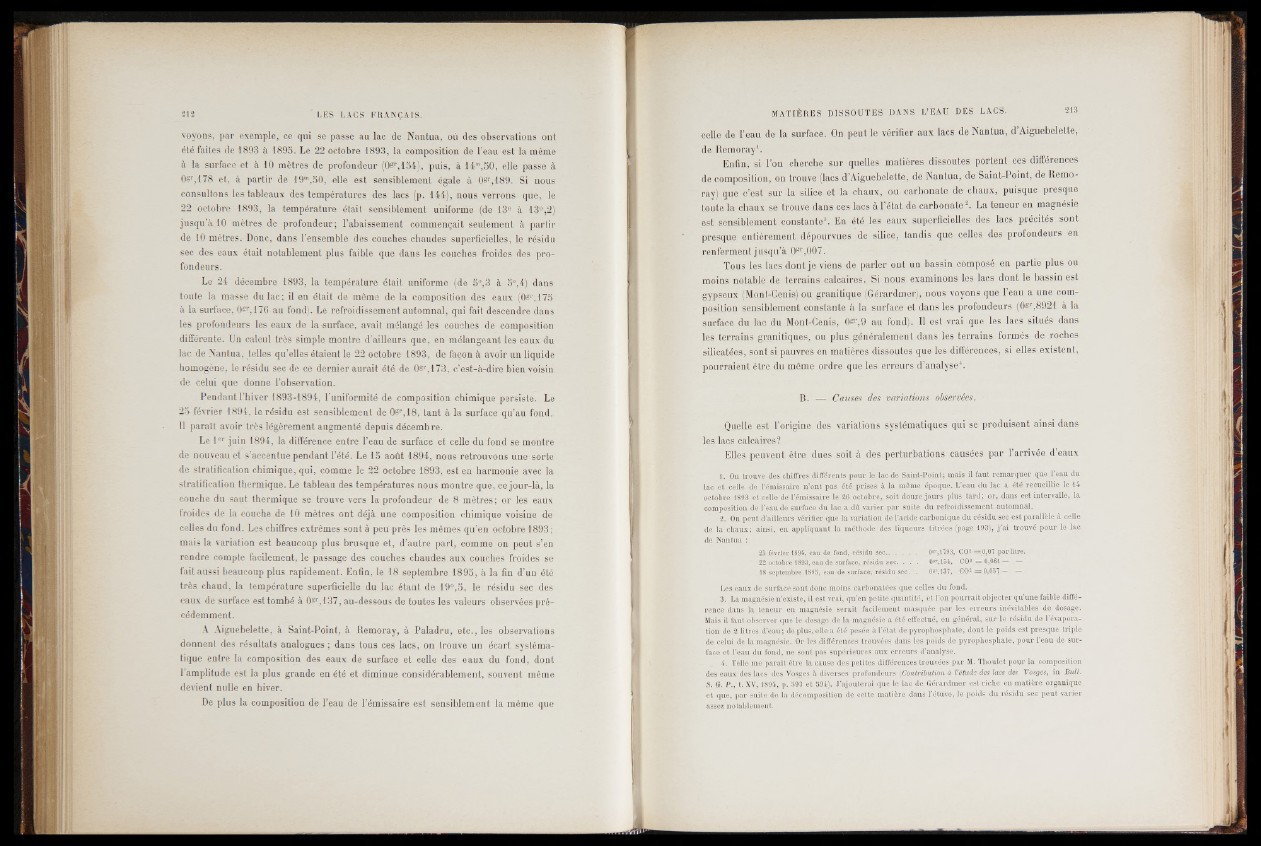
voyons, par exemple, ce qui se passe au lac de Nantua, où des observations ont
été faites de 1893 à 1895. Le 22 octobre 1893, la composition de l’eau est la même
à la surface et à 10 mètres de profondeur (0sr,154), puis, à 1-1"',50, elle passe à
0^,178 et, à partir de 19'",50, elle est sensiblement égale à Os1', 189. Si nous
consultons les tableaux des températures des lacs (p. 141), nous verrons que, le
22 octobre 1893, la température était sensiblement uniforme (de 13° à 13°,2)
jusqu’à 10 mètres de profondeur; l’abaissement commençait seulement à partir
de 10 mètres. Donc, dans l’ensemble des couches chaudes superficielles, le résidu
sec des eaux était notablement plus faible que dans les couches froides des profondeurs.
Le 24 décembre 1893, la température était uniforme (de 5°,3 à 5°,4) dans
toute la masse du lac; il en était de même de la composition des eaux (Os*', 175
à la surface, 0^,176 au fond). Le refroidissement automnal, qui fait descendre dans
les profondeurs les eaux de la .surface, avait mélangé les couches de composition
différente. Un calcul très simple montre d’ailleurs que, en mélangeant les eaux du
lac de Nantua, telles qu’elles étaient le 22 octobre 1893, de façon à avoir un liquide
homogène, le résidu sec de ce dernier aurait été de Os1',173, c’est-à-dire bien voisin
de celui que donne l’observation.
Pendant l’hiver 1893-1894, l’uniformité de composition chimique persiste. Le
25 février 1894, le résidu est sensiblement de Os*,18, tant à la surface qu’au fond.
Il parait avoir très légèrement augmenté depuis décembre.
Le 1er juin 1894, la différence entre l’eau de surface et. celle du fond se montre
de nouveau et s’accentue pendant l’été. Le 15 août 1894, nous retrouvons une sorte
de stratification chimique, qui, comme le 22 octobre 1893, est en harmonie avec la
stratification thermique. Le tableau des températures nous montre que, cejour-là, la
couche du saut thermique se trouve vers la profondeur de 8 mètres; or les eaux
froides de la couche de 10 mètres ont déjà une composition chimique voisine de
celles du fond. Les chiffres extrêmes sont à peu près les mêmes qu’en octobre 1893 ;
mais la variation est beaucoup plus brusque et, d’autre part, comme on peut s’en
rendre compte facilement, le passage des couches chaudes aux couches froides se
fait aussi beaucoup plus rapidement. Enfin, le 18 septembre 1895, à la fin d’un été
très chaud, la température superficielle du lac étant de 19°,5, le résidu sec des
eaux de surface est tombé à 0^,137, au-dessous de toutes les valeurs observées précédemment.
A Aiguebelette, à Saint-Point, à Remoray, à Paladru, etc., les observations
donnent des résultats analogues ; dans tous ces lacs, on trouve un écart systématique
entre la composition des eaux de surface et celle des eaux du fond, dont
l’amplitude est la plus grande en été et diminue considérablement, souvent même
devient nulle en hiver.
De plus la composition de l’eau de l’émissaire est sensiblement la même que
celle de l’eau de la surface. On peut le vérifier aux lacs de Nantua, d’Aiguebelette,
de Remoray1.
Enfin, si l’on cherche sur quelles matières dissoutes portent ces différences
de composition, on trouve (lacs d’Aiguebelette, de Nantua, de Saint-Point, de Remoray)
que c’est sur la silice et la chaux, ou carbonate de chaux, puisque presque
toute la chaux se trouve dans ces lacs à l’état de carbonates. La teneur en magnésie
est sensiblement constante3. En été les eaux superficielles des lacs précités sont
presque entièrement dépourvues de silice, tandis que celles des profondeurs en
renferment jusqu’à 08r,007.
Tous les lacs dont je viens de parler ont un bassin composé en partie plus ou
moins notable de terrains calcaires. Si nous examinons les lacs dont le bassin est
gypseux (Mont-Cenis) ou granitique (Gérardmer), nous voyons que l’eau a une composition
sensiblement constante à la surface et dans les profondeurs (0sr,8921 à la
surface du lac du Mont-Cenis, 0sr,9 au fond). 11 est vrai que les lacs situés dans
les terrains granitiques, ou plus généralement dans les terrains formés de roches
silicatées, sont si pauvres en matières dissoutes que les différences, si elles existent,
pourraient être du même ordre que les erreurs d’analyse4.
B .-— Causes des variations observées. ■
Quelle est l’origine des variations systématiques qui se produisent ainsi dans
les lacs calcaires?
Elles peuvent être dues soit à des perturbations causées par l’arrivée d’eaux
1. On tr ouv e des ch iffr es d iffér en ts p our le la c d e S a in t-P o in t; m a is il fau t r em a rq u e r q u e l'ea u du
la c et. c e lle de l’ém issa ir e n ’o n t pas é té p r ise s à la m êm e ép oq ue . L’e a u du la c a é t é r e c u e illie le 14
o ctobr e 1893 e t c e lle de* l ’ém issa ir e le 26 o c to b r e , s o it d ouz e jo u r s p lu s ta rd ; o r, d ans c e t in te r v a lle , la
com p o sitio n d e l ’ea u d e su rfa c e d u la c a dû v arie r p ar su it e d u r e fr o id is sem e n t a u tom n a l.
2. On .p eu t d’a ille u r s v é r ifie r q u e la v a ria tion de l ’a cid e ca rb o n iq u e d u r é s id u s e c e s t p a ra llè le à c e lle
de. la ch a u x ; a in si, e n a p pliqu an t la m é th o d e d e s liq u eu r s titr é e s (page 193), j ’a i tr ouv é p our le la c
de N an tu a :
26 février 1831, eau de fond, ré s id a sec................... 0s»,1193, CO= = 0,07 p a r litre.
22 octobre 1893, eau de surface, ré sid u s ec . . . . 0sr,154, CO2 = 0,061—tæ g j s i l
18 septembre 1895, eau de surface, ré sid u sec. . 0sr,137, CO= = 0,051 —
Les ea u x de su r fa c e so n t donc m o in s c a rb on a té e s que: c e lle s du fond.
3. La m a g n é sie n ’ex is te , il e st v ra i, qu ’en p e tite q u a n tité , e t l ’on p our ra it o b je c te r qu ’u n e fa ib le d iffé r
en c e dans la ten eu r en m a gn é sie s e r a it fa c ilem en t m a sq u é e p a r le s e r r eu r s in é v ita b le s d e dosage.
Mais il faut observe r q u e le d osage d e la m a g n é sie a é té e ffe c tu é , en g én é r a l, su r l e r é s id u d e l ’év ap o ra tio
n de 2 litr e s d’eau ; d é p lu s , e lle a été p e s é e à l ’é ta t de p y ro p h o sp h a te , d ont l e p o id s e s t p r e sq u e tr ip le
de c e lu i de la m a g n é sie . Or le s d iffé r en c e s tr o u v é e s dans l e s p o id s de p y ro p h o sp h a te , p o u r l ’ea u de su rfa
c e e t l ’ea u du fon d , n e so n t pas su p é r ieu r e s au x e r reur s d’an a ly se .
4. Telle m e p araît ê tr e la ca u se d es p e tite s d iffé r en c e s tr ouv é e s p ar M. T b o u le t pour la com p o sitio n
des eau x d es la c s d e s Vosges à d iv e r se s p ro fon d eu rs {Contribution à l’étude des lacs des Vosges, in B ull.
S. G. P ., t. XV, 1894, p . 593 e t 594). J’a jou te ra i q u e le la o d e Gérardmer e s t r ich e en m a tiè r e organ iqu e,
e t q u e , p ar su ite de. la d é com p o sitio n d e c e tte m a tiè r e dans l ’é tu v e , l e p o id s du r é sid u s e c p eu t v a r ie r
assez n o ta b lem en t.