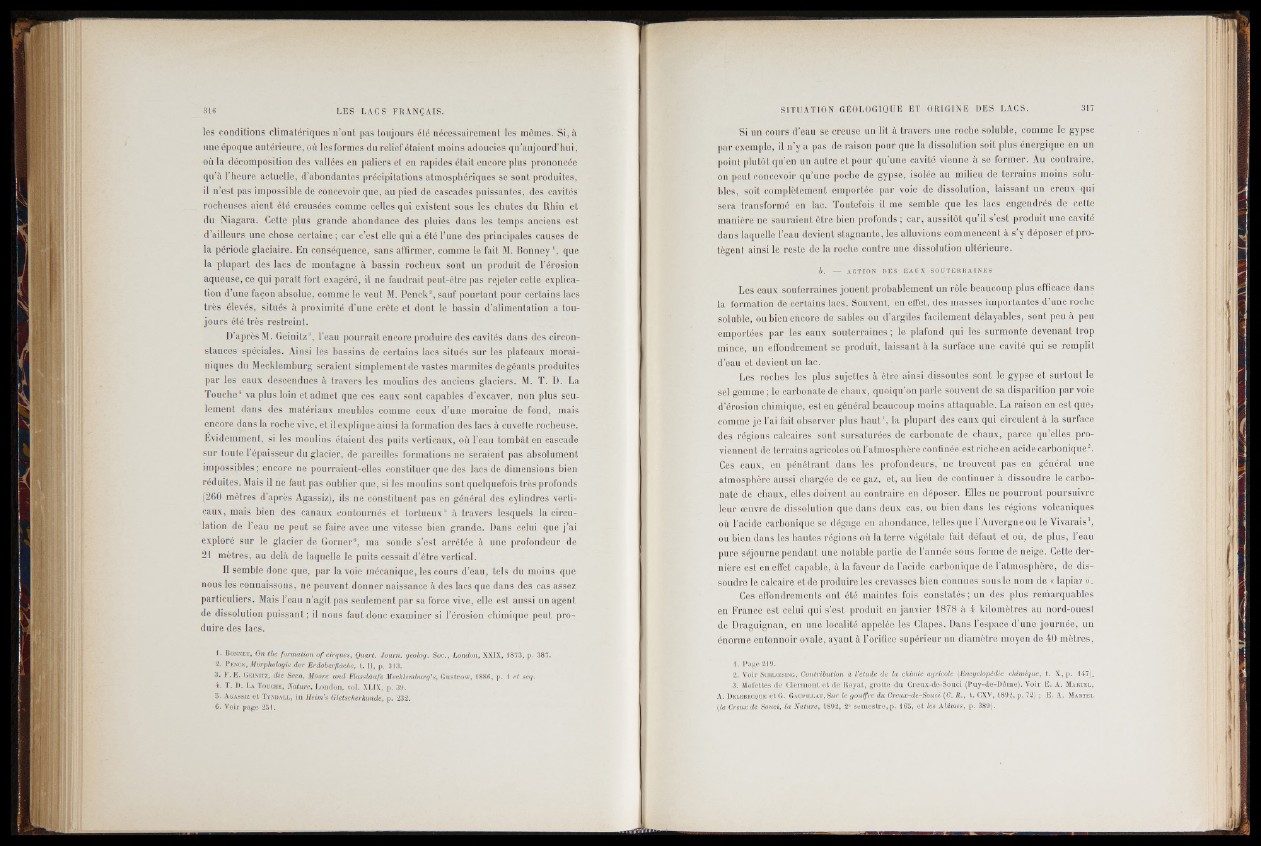
les conditions climatériques n’ont pas toujours été nécessairement les mêmes. Si, à
une époque antérieure, où lesformes du relief étaient moins adoucies qu’aujourd’hui,
où la décomposition des vallées en paliers et en rapides était encore plus prononcée
qu’à l’heure actuelle, d’abondantes précipitations atmosphériques se sont produites,
il n’est pas impossible de concevoir que, au pied de cascades puissantes, des cavités
rocheuses aient été creusées comme celles qui existent sous les chutes du Rhin et
du Niagara. Cette plus grande abondance des pluies dans les temps anciens est
d’ailleurs une chose certaine ; car c’est elle qui a été l’une des principales causes de
la période glaciaire. En conséquence, sans affirmer, comme le fait M. Bonney *, que
la plupart des lacs de montagne à bassin rocheux sont un produit de l’érosion
aqueuse, ce qui paraît fort exagéré, il ne faudrait peut-être pas rejeter cette explication
d’une façon absolue, comme le veut M. Penck1, sauf pourtant pour certains lacs
très élevés, situés à proximité d’une crête et dont le bassin d’alimentation a toujours
été très restreint.
D’après M. Geinitz3, l’eau pourrait encore produire des cavités dans des circonstances
spéciales. Ainsi les bassins de certains lacs situés sur les plateaux morai-
niques du Mecklemburg seraient simplement de vastes marmites degéants produites
par les eaux descendues à travers les moulins des anciens glaciers. M. T. D. La
Touche* va plus loin et admet que ces eaux sont capables d’excaver, non plus seulement
dans des matériaux meubles comme ceux d’une moraine de fond, mais
encore dans la roche vive, et il explique ainsi la formation des lacs à cuvette rocheuse.
Evidemment, si les moulins étaient des puits verticaux, où l’eau tombât en cascade
sur toute l’épaisseur du glacier, de pareilles formations ne seraient pas absolument
impossibles ; encore ne pourraient-elles constituer que des lacs de dimensions bien
réduites. Mais il ne faut pas oublier que, si les moulins sont quelquefois très profonds
(260 mètres d’après Agassiz), ils ne constituent pas en général des cylindres verticaux,
mais bien des canaux contournés et tortueux' à travers lesquels la circulation
de l’eau ne peut se faire avec une vitesse bien grande. Dans celui que j’ai
exploré sur le glacier de Gorner6, ma sonde s’est arrêtée à une profondeur de
21 mètres, au delà de laquelle le puits cessait d’être vertical.
Il semble donc que, par la voie mécanique, les cours d’eau, tels du moins que
nous les connaissons, ne peuvent donner naissance à des lacs que dans des cas assez
particuliers. Mais l’eau n’agit pas seulement par sa force vive, elle est aussi un agent
de dissolution puissant ; il nous faut donc examiner si l’érosion chimique peut produire
des lacs.
i | Bonney, On the formation o f cirques, Quart. J o um . geolog. S o c ., London, XXIX, 1873, p . 387.
2 . P enck, Morphologie d e r Érdoberfâche , t . II, p . 313.
3 . F . E. Geinitz, d ie Seen, Moore u nd Flusslàufe Meckiemburg's, Gustcow, 1886, p . 1 e t seq.
4 . T. D. La Touche, Nature, London, v o l. XLIX, p . 39.
5. A gassiz e t T yndall, in R e im ’s Gletscherkunde, p . 232.
6. Voir p a g e 251.
Si un cours d’eau se creuse un lit à travers une roche soluble, comme le gypse
par exemple, il n’y a pas de raison pour que la dissolution soit plus énergique en un
point plutôt qu’en un autre et pour qu’une cavité vienne à se former. Au contraire,
on peut concevoir qu’une poche de gypse, isolée au milieu de terrains moins solubles,
soit complètement emportée par voie de dissolution, laissant un creux qui
sera transformé en lac. Toutefois il me semble que les lacs engendrés de cette
manière ne sauraient être bien profonds ; car, aussitôt qu’il s’est produit une cavité
dans laquelle l’eau devient stagnante, les alluvions commencent à s’y déposer et protègent
ainsi le reste de la roche contre une dissolution ultérieure.
b. — ACTION DES EAUX SOUTERRAINES
Les eaux souterraines jouent probablement un rôle beaucoup plus efficace dans
la formation de certains lacs. Souvent, en effet, des masses importantes d’une roche
soluble, ou bien eùcore de sables ou d’argiles facilement délayables, sont peu à peu
emportées par les eaux souterraines ; le plafond qui les surmonte devenant trop
mince, un effondrement se produit, laissant à la surface une cavité qui se remplit
d’eau et devient un lac.
Les roches les plus sujettes à être ainsi dissoutes sont le gypse et surtout le
sel gemme ; le carbonate de chaux, quoiqu’on parle souvent de sa disparition par voie
d’érosion chimique, est en général beaucoup moins attaquable. La raison en est que,
comme je l’ai fait observer plus haut1, la plupart des eaux qui circulent à la surface
des régions calcaires sont sursaturées de carbonate de chaux, parce qu’elles proviennent
de terrains agricoles où l’atmosphère confinée est riche en acide carbonique2.
Ces eaux, en pénétrant dans les profondeurs, ne trouvent pas en général une
atmosphère aussi chargée de ce gaz, et, au lieu de continuer à dissoudre le carbonate
de chaux, elles doivent au contraire en déposer. Elles ne pourront poursuivre
leur oeuvre de dissolution que dans deux cas, ou bien dans les régions volcaniques
où l’acide carbonique se dégage en abondance, tellesque l’Auvergneou le Vivarais3,
ou bien dans les hautes régions où la terre végétale fait défaut et où, de plus, l’eau
pure séjourne pendant une notable partie de l’année sous forme de neige. Cette dernière
est en effet capable, à la faveur de l’acide carbonique de l’atmosphère, de dissoudre
le calcaire et de produire les crevasses bien connues sous le nom de « lapiaz ».
Ces effondrements ont été maintes fois constatés ; un des plus remarquables
en France est celui qui s’est produit en janvier 1878 à 4 kilomètres au nord-ouest
de Draguignan, en une localité appelée les Glapes. Dans l’espace d’une journée, un
énorme entonnoir ovale, ayant à l’orifice supérieur un diamètre moyen de 40 mètres,
1. P a g e 219.
2 . Voir S c h loe s in g , Contribution à l'étude de la chimie agricole (Encyclopédie chimique, t . X, p .. 1 4 7 ).
3. Mofettes de Clermont e t de R oyat, gro tte du Greux-de-Souci (P u y -d e -D ôm e ). V o ir E. A. Martel,
A. Delebecque e t G. G a u p i l l â t , Sur le gouffre du Creux-de-Souci (C. R ., t. CXV, 1892, p. 72) ; E. A. Martel
(le Creux de Souci, la N a tu re, 1892, 2° s em e s tr e , p . 165, e t les Abîmes, p . 389).