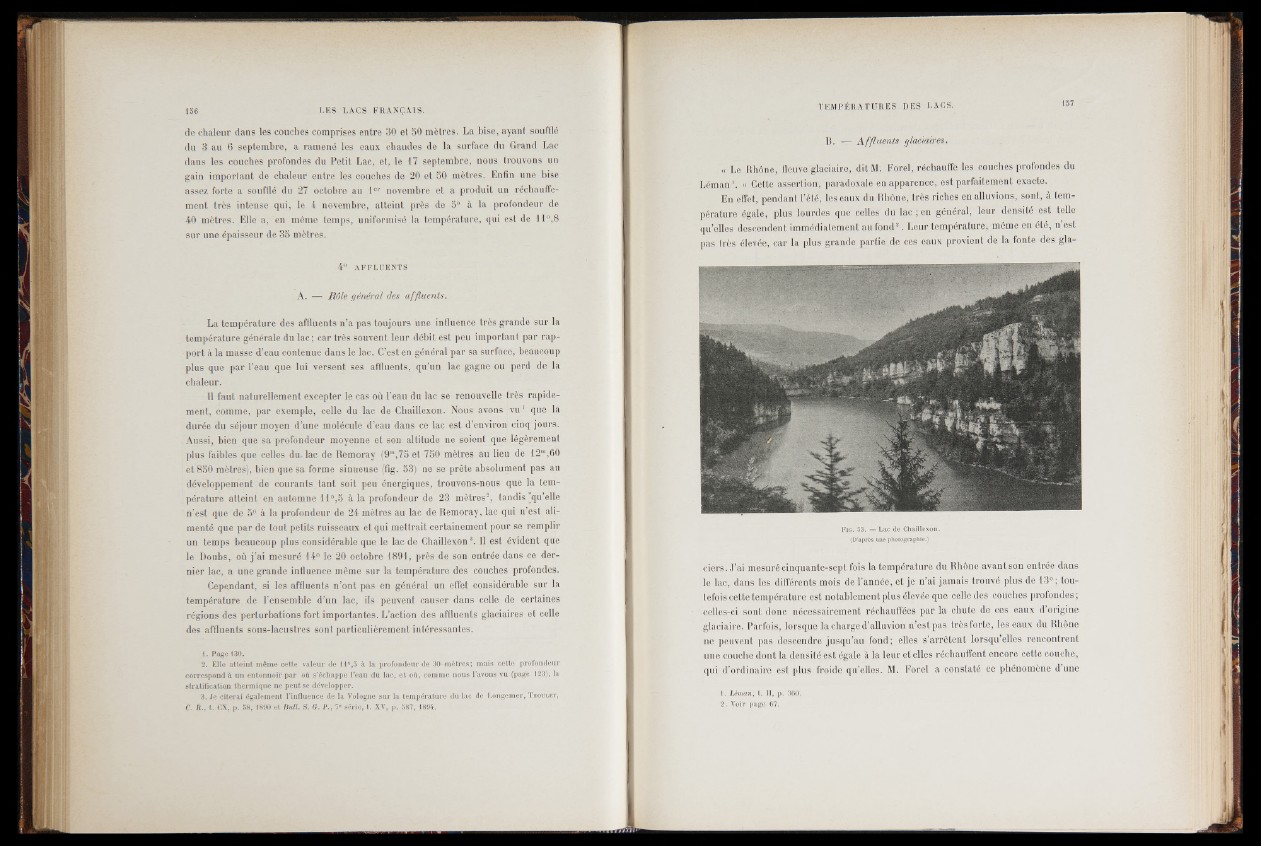
de chaleur dans les couches comprises entre 30 et 50 mètres. La bise, ayant soufflé
du 3 au 6 septembre, a ramené les eaux chaudes de la surface du Grand Lac
dans les couches profondes du Petit Lac, et, le 17 septembre, nous trouvons un
gain important de chaleur entre les couches de 20 et 50 mètres. Enfin une bise
assez forte a soufflé du 27 octobre au 1er novembre et a produit un réchauffement
très intense qui, le 4 novembre, atteint près de 5° à la profondeur de
40 mètres. Elle a, en même temps, uniformisé la température, qui est de 11°,8
sur une épaisseur de 35 mètres.
4° A F F L U E N T S
A. — Rôle général des af/luents.
La température des affluents n’a pas toujours une influence très grande sur la
température générale du lac; car très souvent leur débit est peu important par rapport
à la masse d’eau contenue dans le lac. C’est en général par sa surface, beaucoup
plus que par l’eau que lui versent ses affluents, qu’un lac gagne ou perd de la
chaleur.
Il faut naturellement excepter le cas où l’eau du lac se renouvelle très rapidement,
comme, par exemple, celle du lac de Chaillexon. Nous avons vu1 que la
durée du séjour moyen d’une molécule d’eau dans ce lac est d’environ cinq jours.
Aussi, bien que sa profondeur moyenne et son altitude ne soient que légèrement
plus faibles que celles du. lac de Remoray (9“,75 et 750 mètres au lieu de 12“,60
et 850 mètres), bien que sa forme sinueuse (fig. 53) ne se prête absolument pas au
développement de courants tant soit peu énergiques, trouvons-nous que la température
atteint en automne 11°,5 à la profondeur de 23 mètres*, tandis'qu’elle
n’est que de 5° à la profondeur de 24 mètres au lac de Remoray, lac qui n’est alimenté
que par de tout petits ruisseaux et qui mettrait certainement pour se remplir
un temps beaucoup plus considérable que le lac de Chaillexon3. Il est évident que
le Doubs,. où j ’ai mesuré 14° le 20 octobre 1891, près de son entrée dans ce dernier
lac, a une grande influence même sur la température des couches profondes.
Cependant, si les affluents n’ont pas en général un effet considérable sur la
température de l’ensemble d’un lac, ils peuvent causer dans celle de certaines
régions des perturbations fort importantes. L’action des affluents glaciaires et celle
des affluents sous-lacustres sont particulièrement iutéressantes.
Page 130.
2. Elle atteint même cette valeur de 11°,o à la profondeur de 30 mètres; mais cette profondeur
correspond il un entonnoir par où s’échappe l’eau du lac, et où, comme nous l’avons vu (page 123), la
stratification thermique ne peut se développer.
3 . Je citerai également l’influence de la Vologne sur la température du lac de Longemer, T h o u le t ,
B. — Affluents glaciaires.
« Le Rhône, fleuve glaciaire, dit M. Forel, réchauffe les couches profondes du
Léman Ê » Cette assertion, paradoxale en apparence, est parfaitement exacte.
En effet, pendant l’été, les eaux du Rhône, très riches en alluvions, sont, à température
égale, plus lourdes que celles du lac ;en général, leur densité est telle
qu’elles descendent immédiatement au fond2. Leur température, même en été, n est
pas très élevée, car la plus grande partie de ces eaux provient de la fonte des gla-
Fxo. 53. — Lac de Chaillexon.
(D’ap r è s u n e pho to g rap hie .)
ciers. J’ai mesuré cinquante-sept fois la température du Rhône avant son entrée dans
le lac, dans les différents mois de l’année, et je n’ai jamais trouvé plus de 13°; toutefois
cette température est notablement plus élevée que celle des couches profondes ;
celles-ci sont donc nécessairement réchauffées par la chute de ces eaux d’origine
glaciaire. Parfois, lorsque la charge d’alluvion n’est pas très forte, les eaux du Rhône
ne peuvent pas descendre jusqu’au fond; elles s’arrêtent lorsqu’elles rencontrent
une couche dont la densité est égale à la leur et elles réchauffent encore cette couche,
qui d’ordinaire est plus froide qu’elles. M. Forel a constaté ce phénomène d’une
1. Léman, t. II, p . 360.
2 . Voir page 67.