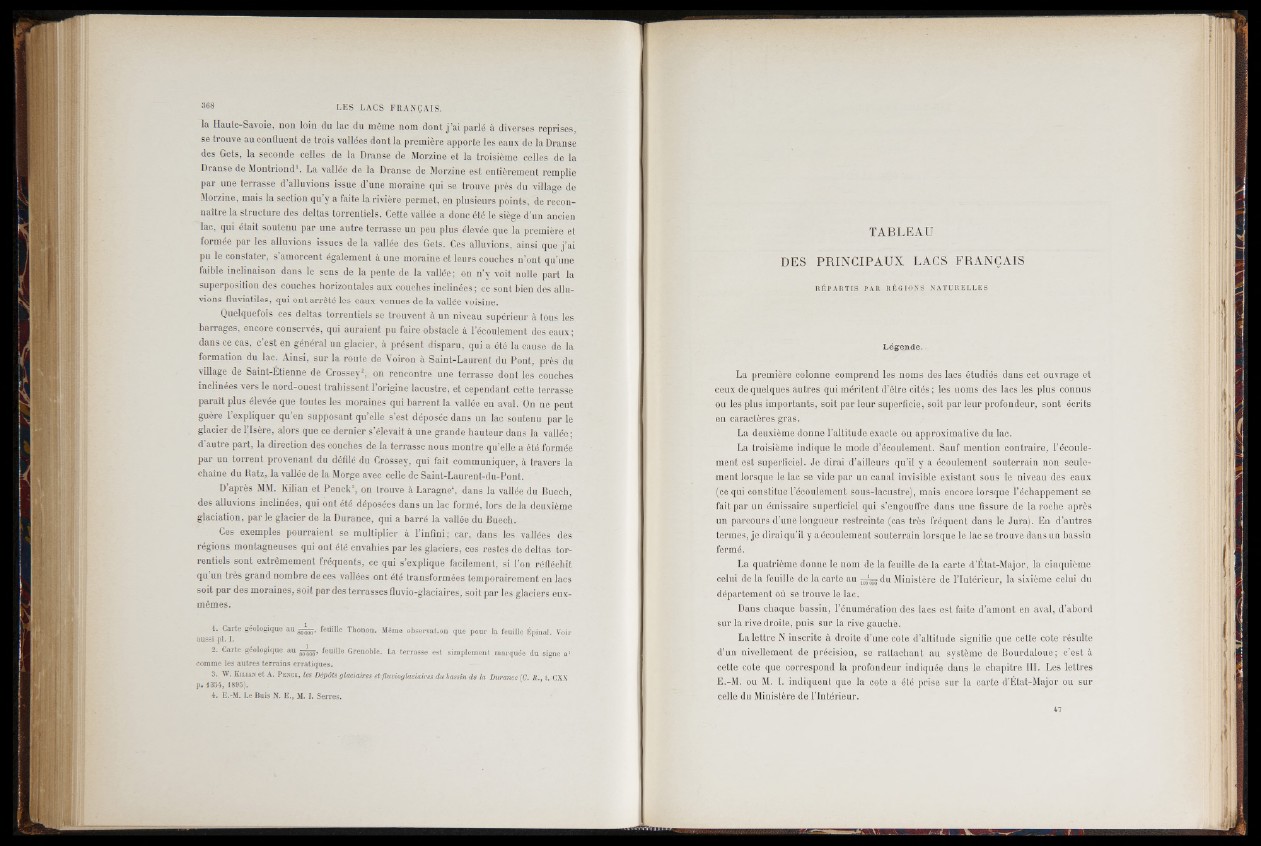
la Haute-Savoie, non loin du lac du même nom dont j ’ai parlé à diverses reprises,
se trouve au confluent de trois vallées dont la première apporte les eaux de la Dranse
des Gets, la seconde celles de la Dranse de Morzine et la troisième celles de la
Dranse de Montriond*. La vallée de la Dranse de Morzine est entièrement remplie
par une terrasse d’alluvions issue d’une moraine qui se trouve près du village de
Morzine, mais la section qu’y a faite la rivière permet, en plusieurs points, de reconnaître
la structure des deltas torrentiels. Cette vallée a donc été le siège d’un ancien
lac, qui était soutenu par une autre terrasse un peu plus élevée que la première et
formée par les alluvions issues de la vallée des Gets. Ces alluvions, ainsi que j’ai
pu le constater, s’amorcent également à une moraine et leurs couches n’ont qu’une
faible inclinaison dans le sens de la pente de la vallée; on n’y voit nulle part la
superposition des couches horizontales aux couches inclinées; ce sont bien des alluvions
fluviátiles, qui ont arrêté les eaux venues de la vallée voisine.
Quelquefois ces deltas torrentiels se trouvent à un niveau supérieur à tous les
barrages, encore conservés, qui auraient pu faire obstacle à l’écoulement des eaux;
dans ce cas, c’est en général un glacier, à présent disparu, qui a été la cause de la
formation du lac. Ainsi, sur la route de Voiron à Saint-Laurent du Pont, près du
village de Saint-Étienne de Crossey1, on rencontre une terrasse dont les couches
inclinées vers le nord-ouest trahissent l’origine lacustre, et cependant cette terrasse
parait plus élevée que toutes les moraines qui barrent la vallée en aval. On ne peut
guère l’expliquer qu’en supposant qu’elle s’est déposée dans un lac soutenu par le
glacier de l’Isère, alors que ce dernier s’élevait à une grande hauteur dans la vallée;
d’autre part, la direction des couches de la terrasse nous montre qu’elle a été formée
par un torrent provenant du défilé du Crossey, qui fait communiquer, à travers la
chaîne du Ratz, la vallée de la Morge avec celle de Saint-Laurent-du-Pont.
D’après MM. Kilian et Penck3, on trouve à Laragne1, dans la vallée du Buech,
des alluvions inclinées, qui ont été déposées dans un lac formé, lors de la deuxième
glaciation, par le glacier de la Durance, qui a barré la vallée du Buech.
Ces exemples pourraient se multiplier à l’infini; car, dans les vallées des
régions montagneuses qui ont été envahies par les glaciers, ces restes de deltas torrentiels
sont extrêmement fréquents, ce qui s’explique facilement, si l’on réfléchit
qu un très grand nombre de ces vallées ont été transformées temporairement en lacs
soit par des moraines, soit par des terrasses fluvio-glaciaires, soit par les glaciers eux-
mêmes.
1. Carte g éo lo g iq u e a u ¿qôôô> fe ü ille T hon on . Même o b s e r v a r o n q u e p our ia feu ille Épinal. Voir
au ssi p l. I.
2 . Carte g éo lo g iq u e a u gôôôô> fe u ille Grenoble. La te r ra sse e s t s im p lem en t m a rqu ée du sig n e a 1
com m e le s a u tr e s te rra in s e r r a tiq u e s.
3 . W. K il ia n e t A. P enck, les Dépôts glaciaires e t fluvioglaeiaires d u bassin d e la Durance (C. R ., t. CXX
p . 1354, 1895).
4 . E.-M. Le B uis N. E ., M. I. S err es.
TABLEAU
DES PRINCIPAUX LACS FRANÇAIS
R É P A R T IS PA R R É S IO N S N A T U R E L L E S
L é g e n d e .
La première colonne comprend les noms des lacs étudiés dans cet ouvrage et
ceux de quelques autres qui méritent d’être cités ; les noms des lacs les plus connus
ou les plus importants, soit par leur superficie, soit par leur profondeur, sont écrits
en caractères gras.
La deuxième donne l’altitude exacte ou approximative du lac.
La troisième indique le mode d’écoulement. Sauf mention contraire, l’écoulement
est superficiel. Je dirai d’ailleurs qu’il y a écoulement souterrain non seulement
lorsque le lac se vide par un canal invisible existant sous le niveau des eaux
(ce qui constitue l’écoulement sous-lacustre), mais encore lorsque l’échappement se
fait par un émissaire superficiel qui s’engouffre dans une fissure de la roche après
un parcours d’une longueur restreinte (cas très fréquent dans le Jura). En d’autres
termes, je dirai qu’il y a écoulement souterrain lorsque le lac se trouve dans un bassin
fermé.
La quatrième donne le nom de la feuille de la carte d’État-Major, la cinquième
celui de la feuille de la carte au jjA- du Ministère de l’Intérieur, la sixième celui du
département où se trouve le lac.
Dans chaque bassin, l’énumération des lacs est faite d’amont en aval, d’abord
sur la rive droite, puis sur la rive gauchè.
La lettre N inscrite à droite d’une cote d’altitude signifie que cette cote résulte
d’un nivellement de précision, se rattachant au système de Bourdaloue; c’est à
cette cote que correspond la profondeur indiquée dans le chapitre III. Les lettres
E.-M. ou M. I. indiquent que la cote a été prise sur la carte d’État-Major ou sur
celle du Ministère de l’Intérieur.