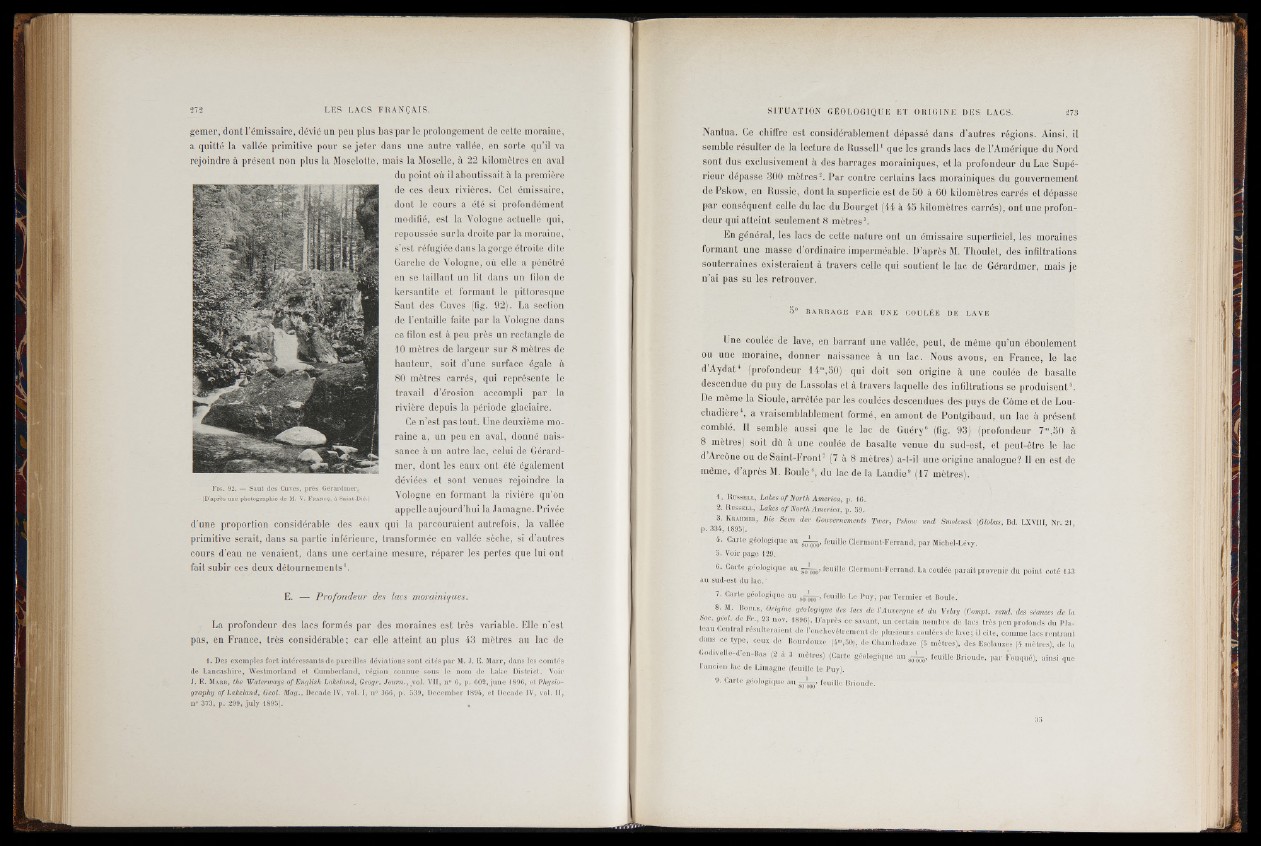
gemer, dontl émissaire, dévié un peu plus baspar le prolongement de cette moraine,
a quitté la vallée primitive pour se jeter dans une autre vallée, en sorte qu’il va
rejoindre à présent non plus la Moselotte, mais la Moselle, à 22 kilomètres en aval
F ig . 9 2 . — Saut des Cuves, près Gérardmei\
- (D'après une ph o to g rap hie d e M. V. F rancq, à Saint-Dié .)
d’une proportion considérable des eaux
primitive serait, dans sa partie inférieure,
cours d’eau ne venaient, dans une certain
fait subir ces deux détournements1.
du point où il aboutissait à la première
de ces deux rivières. Cet émissaire,
dont le cours a été si profondément
modifié, est la Yologne actuelle qui,
repoussée surla droite par la moraine,
s’est réfugiée dans la gorge étroite dite
Garche de Yologne, où elle a pénétré
en se taillant un lit dans un filon de
kersantite et formant le pittoresque
Saut des Cuves (fig. 92). La section
de l’entaille faite par la Vologne dans
ce filon est à peu près un rectangle de
10 mètres de largeur sur .8 mètres de
hauteur, soit d’une surface égale à
80 mètres carrés, qui représente le
travail d’érosion accompli par la
rivière depuis la période glaciaire.
Ce n’est pas tout. Une deuxième moraine
a, un peu en aval, donné naissance
à un autre lac, celui de Gérard-
mer, dont les eaux ont été également
déviées et sont venues rejoindre la
Yologne en formant la rivière qu’on
appelle aujourd’hui la Jamagne. Privée
qui la parcouraient autrefois, la vallée
transformée en vallée sèche, si d’autres
e mesure, réparer les pertes que lui ont
E. — Profondeur des lacs morainiques.
La profondeur des lacs formés par des moraines est très variable. Elle n’est
pas, en France, très considérable; car elle atteint au plus 43 mètres au lac de
4. Des ex em p le s fo r t in té r e ssa n ts d e p a r e ille s d év ia tions so n t c ité s p ar M. J. E. Marr, dans le s com té s
d e Lanca shire , Westmorlan d e t Cumberland, r é g io n .c o n n u e so u s le n om d e Lake D istr ic t. Voir
J. E. Mabb, the 'Waterways o f English Lakeland, Geogr. J o um ., Vol. VII, n ° 6, p . 602, j une 1896, e t Physiog
ra ph y o f Lakeland, Geol. Mag., Decade IV, vol. I, n° 366, p . 839, D e c em b e r 1894, e t Decade IV, v o l. II,
n° 373, p . 2 9 9 , ju ly 1895).
Nantua. Ce chiffre est considérablement dépassé dans d’autres régions. Ainsi, il
semble résulter de la lecture de Russell1 que les grands lacs de l’Amérique du Nord
sont dus exclusivement à des barrages morainiques, et la profondeur du Lac Supérieur
dépasse 300 mètres2. Par contre certains lacs morainiques du gouvernement
de Pskow, en Russie, dont la superficie est de 50 à 60 kilomètres carrés et dépasse
par conséquent celle du lac du Rourget (44 à 45 kilomètres carrés), ont une profondeur
qui atteint seulement 8 mètres3.
En général, les lacs de cette nature ont un émissaire superficiel, les moraines
formant une masse d’ordinaire imperméable. D’après M. Thoulet, des infiltrations
souterraines existeraient à travers celle qui soutient le lac de Gérardmer, mais je
n’ai pas su les retrouver.
5° B A R R A G E PA R U N E COULÉE DE LA V E
Une coulée de lave, en barrant une vallée, peut, de même qu’un éboulement
ou une moraine, donner naissance à un lac. Nous avons, en France, le lac
dAydat4 (profondeur 14m,50) qui doit son origine à une coulée de basalte
descendue du puy de Lassolas et à travers laquelle des infiltrations se produisent5.
De même la Sioule, arrêtée par les coulées descendues des puys de Còme et de Louchadière4,
a vraisemblablement formé, en amont de Ponlgibaud, un lac à présent
comblé. Il semble aussi que le lac de Guéry6 (fig. 93) (profondeur 7m,50 à
8 mètres) soit dû à une coulée de basalte venue du sud-est, et peut-être le lac
d Arcône ou de Saint-Front7 (7 à 8 mètres) a-t-il une origine analogue? Il en est de
même, d’après M. Roule8, du lac de la Landie9 (17 mètres).
4 . R u s s e l l , Lakes o f JSorth America, p . 46.
2. R u s s e l l , Lakes o f Norlh America, p . 59.
3. K baiimeb, Die Seen d e r Gouvernements Twer, Pskow u nd Smolensk (Globus, Bd. LXVI1I Nr. 21
p . 334, 4895).
4 . Carte g éo lo g iq u e au —L _ , fe u ille Clermont-Fe rrand, p a r Michel-Lévy.
5. Voir pa g e 129.
6 . Carte g é o lo g iq u e au fe u ille Clermont-Fe rrand. La c o u lé e p a ra ît p ro v en ir d u p o in t co té 133
au su d -e st du l a c . ‘
7 . Carte g éo lo g iq u e a u s^ ô', feu ille Le Pu y ; p a rT e rm ie r e t B o u le t
8. M. Boule, Origine géologique des lacs de l'Auve rgne e t du V ela y (Compì, ren d , des séances d e la
Soc. géol. d e F r., 23 n o v . 1896). D’a p rès c e sa v an t, u n c e r ta in n omb re d e la c s tr è s p eu pro fon d s du P la te
a li Central r é s u lt e ia ie n t d e 1 en ch e v ê tr em en t de p lu sieu r s c o u lé e s d e la v e ; il c ite , c om m e la c s rentran t
d ans c e ty p e , c eu x d e Bourdou ze (4m,50), de Chambedaze (5 m è tr e s), des E sc la u z e s (4 m è tr e s), d e la
Godive lle d e n -B a s (2 à 3 m è tr e s) (Carte g éo lo g iq u e au g g ^ i fe u ille B rioud e, par F ou qu é), a in s i que
l ’a n c ien la c d e Limagne (feu ille le Puy).
9. Carte g éo lo g iq u e au fe u ille Brioude.