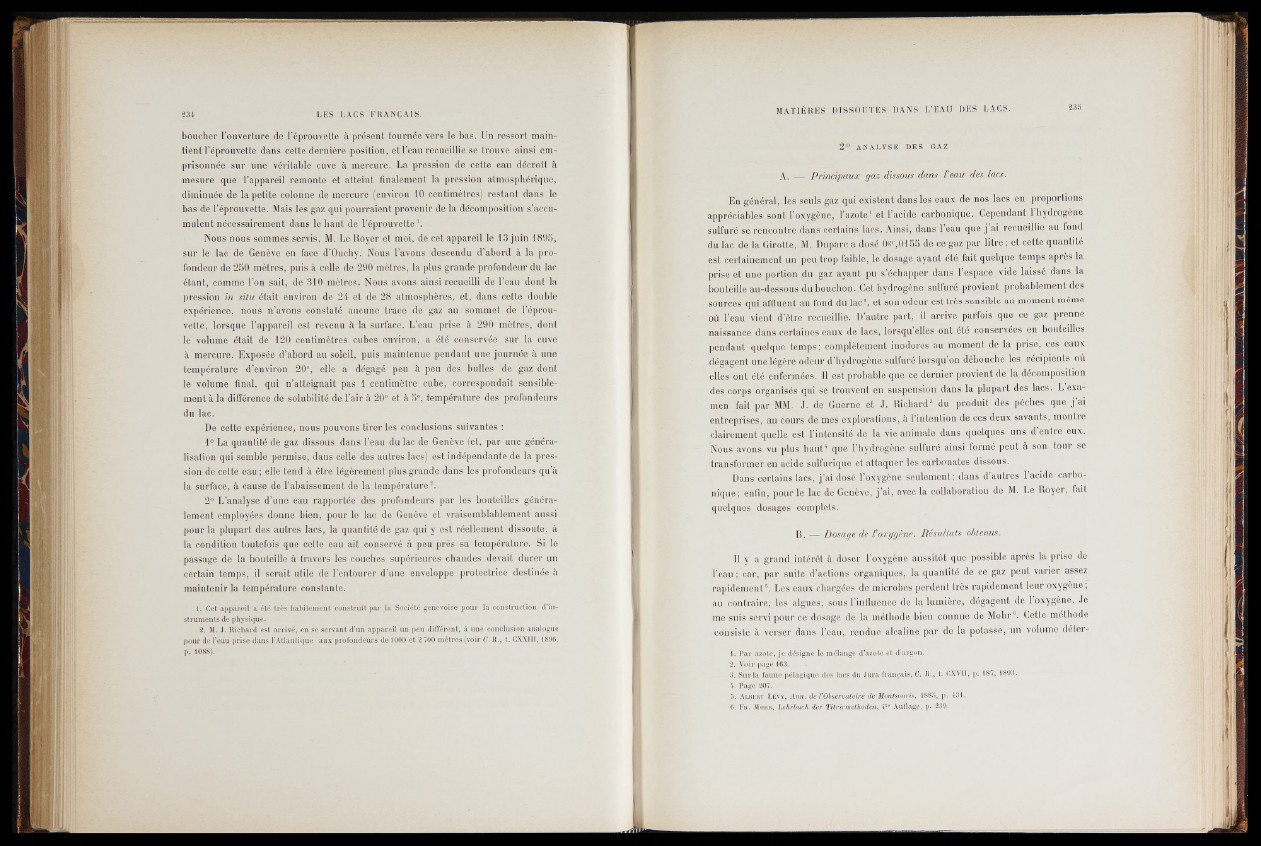
boucher l’ouverture de l’éprouvette à présent tournée vers le bas. Un ressort maintient
l’éprouvette dans cette dernière position, et l’eau recueillie se trouve ainsi emprisonnée
sur une véritable cuve à mercure. La pression de cette eau décroît à
mesure que l’appareil remonte et atteint finalement la pression atmosphérique,
diminuée de la petite colonne de mercure (environ 10 centimètres) restant dans le
bas de l’éprouvette. Mais les gaz qui pourraient provenir de la décomposition s’accumulent
nécessairement dans le haut de l’éprouvette*.
Nous nous sommes servis, M. Le Royer et moi, de cet appareil le 13 juin 1898,
sur le lac de Genève en face d’Ouchy. Nous l’avons descendu d’abord à la profondeur
de 250 mètres, puis à celle de 290 mètres, la plus grande profondeur du lac
étant, comme l’on sait, de 310 mètres. Nous avons ainsi recueilli de l’eau dont la
pression in situ était environ de 24 et de 28 atmosphères, et, dans cette double
expérience, nous n’avons constaté aucune trace de gaz au sommet de l’éprou-
vette, lorsque l’appareil est revenu à la surface. L’eau prise à 290 mètres, dont
le volume était de 120 centimètres cubes environ, a été conservée sur la cuve
à mercure. Exposée d’abord au soleil, puis maintenue pendant une journée à une
température d’environ 20°, elle a dégagé peu à peu des bulles de gaz dont
le volume final, qui n’atteignait pas 1 centimètre cube, correspondait sensiblement
à la différence de solubilité de l’air à 20° et à 5°, température des profondeurs
du lac.
De cette expérience, nous pouvons tirer les conclusions suivantes :
1° La quantité de gaz dissous dans l’eau du lac de Genève (et, par une généralisation
qui semble permise, dans celle des autres lacs) est indépendante de la pression
de cette eau ; elle tend à être légèrement plus grande dans les profondeurs qu’à
la surface, à cause de l’abaissement de la températurea.
2° L’analyse d’une eau rapportée des profondeurs par les bouteilles généralement
employées donne bien, pour le lac de Genève et vraisemblablement aussi
pour la plupart des autres lacs, la quantité de gaz qui y est réellement dissoute, à
la condition toutefois que cette eau ait conservé à peu près sa température. Si le
passage de la bouteille à travers les couches supérieures chaudes devait durer un
certain temps, il serait utile de l’entourer d’une enveloppe protectrice destinée à
maintenir la température constante.
1. Cet ap pa r eil a é té tr ès h a b ilem en t c o n stru it p ar la S o c ié té g en ev o ise p ou r la c on stru c tion d’in strum
en ts d e p h y siq u e .
2 . M. J. Rich ard e s t a r r iv é , en s e se r v ant d’u n ap par eil u n p eu d iffér en t, à u n e co n c lu sio n an alogu e
p o u r d e l’ea u p r ise d ans l ’A tlan tiq ue a u x profon d eu rs d e 1000 e t 2 7 0 0 m è tr e s (voir C. R ., t. CXX1II, 1896,
p . 1088).
2° A N A L Y S E D E S GAZ
A. — Principaux gaz dissous dans Veau des lacs<
En général, les seuls gaz qui existent dans les eaux de nos lacs en proportions
appréciables sont l’oxygène, l’azote1 et l’acide carbonique. Cependant 1 hydrogène
sulfuré se rencontre dans certains lacs. Ainsi, dans l’eau que j ’ai recueillie au fond
du lac de la Girotte, M. Duparc a dosé 0sr,0155 de ce gaz par litre ; et cette quantité
est certainement un peu trop faible, le dosage ayant été fait quelque temps après la
prise et une portion du gaz ayant pu s’échapper dans l’espace vide laissé dans la
bouteille au-dessous du bouchon. Cet hydrogène sulfuré provient probablement des
sources qui affluent au fond du lac5, et son odeur est très sensible au moment même
où l’eau vient d’être recueillie. D’autre part, il arrive parfois que ce gaz prenne
naissance dans-certaines eaux de lacs, lorsqu’elles ont été conservées en bouteilles
pendant quelque temps; complètement inodores au moment de la prise, ces eaux
dégagent une légère odeur d’hydrogène sulfuré lorsqu’on débouche les récipients où
elles ont été enfermées. Il est probable que ce dernier provient de la décomposition
des corps organisés qui se trouvent en suspension dans la plupart des lacs. L examen
fait par MM. J. de Guerne et J. Richard3 du produit des pêches que j ’ai
entreprises, au cours de mes explorations, à l’intention de ces deux savants, montre
clairement quelle est l’intensité de la vie animale dans quelques uns d entre eux.
Nous avons vu plus haut4 que l’hydrogène sulfuré ainsi formé peut à son tour se
transformer en acide sulfurique et attaquer les carbonates dissous.
Dans certains lacs, j ’ai dosé l’oxygène seulement ; dans d’autres 1 acide carbonique
; enfin, pour le lac de Genève, j ’ai, avec la collaboration de M. Le Royer, fait
quelques dosages complets.
B. — Dosage de Îoxygène. Résultats obtenus.
Il y a grand intérêt h doser l’oxygène aussitôt que possible après la prise de
l’eau ; car, par suite d’actions organiques, la quantité de ce gaz peut varier assez
rapidement5. Les eaux chargées de microbes perdent très rapidement leur oxygène,
au contraire, les algues, sous l’influence de la lumière, dégagent de 1 oxygène. Je
me suis servi pour ce dosage de la méthode bien connue de Mohr6. Cette méthode
consiste à verser dans l’eau, rendue alcaline par de la potasse, un volume déler-
■1. P a r azo te , j e d é sig n e le m é la n g e d’azo te e t d’argon.
2 . V o ir p age 163.
3. Sur la fau n e p é la g iq u e d e s la c s d u Jura fr a n ç a is, C. R ., t. CXVII, p . 187, 1893.
4. P a g e 207.
5. Alber t Lévy, A nn . d e l’Observatoire de Montsouris, 1885, p . 431.
6. F r . Mo h r, Lehrbuch d e r Titrirmethoden,- 4lc Auflage, p. 239.