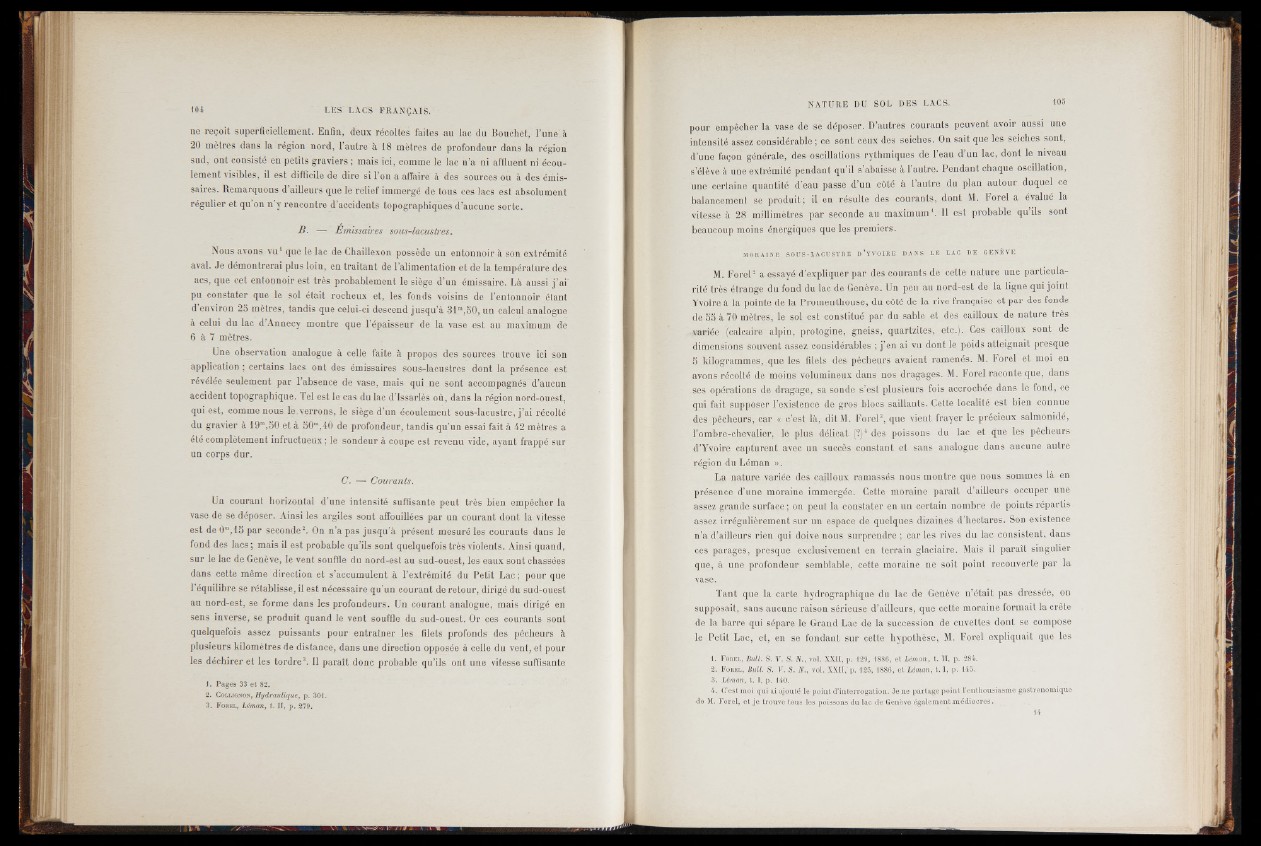
ne reçoit superficiellement. Enfin, deux récoltes faites au lac du Bouchet, l'une à
20 mètres dans la région nord, l’autre à 18 mètres de profondeur dans la région
sud, ont consisté en petits graviers ; mais ici, comme le lac n’a ni affluent ni écoulement
visibles, il est difficile de dire si l’on a affaire à des sources ou à des émissaires.
Remarquons d’ailleurs que le relief immergé de tous ces lacs est absolument
régulier et qu’on n’y rencontre d’accidents topographiques d’aucune sorte.
B. — Emissaires sous-lacustres.
Nous avons vu1 que le lac de Chaillexon possède un entonnoir à son extrémité
aval. Je démontrerai plus loin, en traitant de l’alimentation et de la température des
acs, que cet entonnoir est très probablement le siège d’un émissaire. Là aussi j ’ai
pu constater que le sol était rocheux et, les fonds voisins de l’entonnoir étant
d’environ 25 mètres, tandis que celui-ci descend jusqu’à 31m,50, un calcul analogue
à celui du lac d’Annecy montre que l’épaisseur de la vase est au maximum de
6 à 7 mètres.
Une observation analogue à celle faite à propos des sources trouve ici son
application; certains lacs ont des émissaires sous-lacustres dont la présence est
révélée seulement par l’absence de vase, mais qui ne sont accompagnés d’aucun
accident topographique. Tel est le cas du lac d’Issarlès où, dans la région nord-ouest,
qui est, comme nous le.verrons, le siège d’un écoulement sous-lacustre, j ’ai récolté
du gravier à 19m,50 et à 50m,40 de profondeur, tandis qu’un essai fait à 42 mètres a
été complètement infructueux ; le sondeur à coupe est revenu vide, ayant frappé sur
un corps dur.
C. —? Courants.
Un courant horizontal d’une intensité suffisante peut très bien empêcher la
vase de se déposer. Ainsi les argiles sont affouillées par un courant dont la vitesse
est de 0“, 15 par seconde2. On n’a pas jusqu’à présent mesuré les courants dans le
fond des lacs; mais il est probable qu’ils sont quelquefois très violents. Ainsi quand,
sur le lac de Genève, le vent souffle du nord-est au sud-ouest, les eaux sont chassées
dans cette même direction et s’accumulent à l’extrémité du Petit Lac ; pour que
l’équilibre se rétablisse, il est nécessaire qu’un courant de retour, dirigé du sud-ouest
au nord-est, se forme dans les profondeurs. Un courant analogue, mais dirigé en
sens inverse, se produit quand le vent souffle du sud-ouest. Or ces courants sont
quelquefois assez puissants pour entraîner les filets profonds des pêcheurs à
plusieurs kilomètres de distance, dans une direction opposée à celle du vent, et pour
les déchirer et les tordre3. Il paraît donc probable qu’ils ont une vitesse suffisante
1. P a g e s 33 e t 82.
2 . Collignon, H yd rau liqu e, p . 3 0 1 .
3 . F orel, Léman, t. II, p . 279.
pour empêcher la vase de se déposer. D’autres courants peuvent avoir aussi une
intensité assez considérable ; ce sont ceux des seiches. On sait que les seiches sont,
d’une façon générale, des oscillations rythmiques de l’eau d’un lac, dont le niveau
s’élève à une extrémité pendant qu’il s’abaisse à l’autre. Pendant chaque oscillation,
une certaine quantité d’eau passe d’un côté à l’autre du plan autour duquel ce
balancement se produit; il en résulte des courants, dont M. Forel a évalué la
vitesse à 28 millimètres par seconde au maximum1. Il est probable qu’ils sont
beaucoup moins énergiques que les premiers.
MORAINE SOUS-LACUSTRE D ’YVOIRE DANS LE LAC DE GENÈVE
M. Forel2 a essayé d’expliquer par des courants de cette nature une particularité
très étrange du fond du lac de Genève. Un peu au nord-est de la ligne qui joint
Yvoire à la pointe de la Promenthouse, du côté de la rive française et par des fonds
de 55 à 70 mètres, le sol est constitué par du sable et des cailloux de nature très
variée (calcaire alpin, protogine, gneiss, quartzites, etc.). Ces cailloux sont de
dimensions souvent assez considérables ; j’en ai vu dont le poids atteignait presque
5 kilogrammes, que les filets des pêcheurs avaient ramenés. M. Forel et moi en
avons récolté de moins volumineux dans nos dragages. M. Forel raconte que, dans
ses opérations de dragage, sa sonde s’est plusieurs fois accrochée dans le fond, ce
qui fait supposer l’existence de gros blocs saillants. Cette localité est bien connue
des pêcheurs, car « c’est là, ditM. Forel3, que vient frayer le précieux salmonidé,
l’ombre-chevalier, le plus délicat (?)4 des poissons du lac et que les pêcheurs
d’Yvoire capturent avec un succès constant et sans analogue dans aucune autre
région du Léman » .
La nature variée des cailloux ramassés nous montre que nous sommes là en
présence d’une moraine immergée. Cette moraine paraît d’ailleurs occuper une
assez grande surface ; on peut la constater en un certain nombre de points répartis
assez irrégulièrement sur un espace de quelques dizaines d’hectares. Son existence
n’a d’ailleurs rien qui doive nous surprendre ; car les rives du lac consistent, dans
ces parages, presque exclusivement en terrain glaciaire. Mais il paraît singulier
que, à une profondeur semblable, cette moraine né soit point recouverte par la
vase.
Tant que la carte hydrographique du lac de Genève n’était pas dressée, on
supposait, sans aucune raison sérieuse d’ailleurs, que cette moraine formait la crête
de la barre qui sépare le Grand Lac de la succession de cuvettes dont se compose
le Petit Lac, et, en se fondant sur cette hypothèse, M. Forel expliquait que les
1. F orel, Bull. S . V. S. IV., vol. XXII, p . 129, 1886, e t L ém an , t. II, p . 284.
2 . F orel, Bull. S . V. S . N ., v o l. XXII, p . 1 2 5 , 1 8 8 6 , e t Léman, t . ï , p . 1 4 5 .
3. Léman, t. I, p . 140.
4 . C’e s t m o i q u i ai ajou té le p o in t d’in te r r o g a tio n . Je n e p artage p o in t l ’en th o u sia sm e g a str on om iq u e
d e M. F o r e l, e t j e trouve tou s le s p o isso n s d u la c d e Genève é g a lem en t m é d i o c r e s ,.