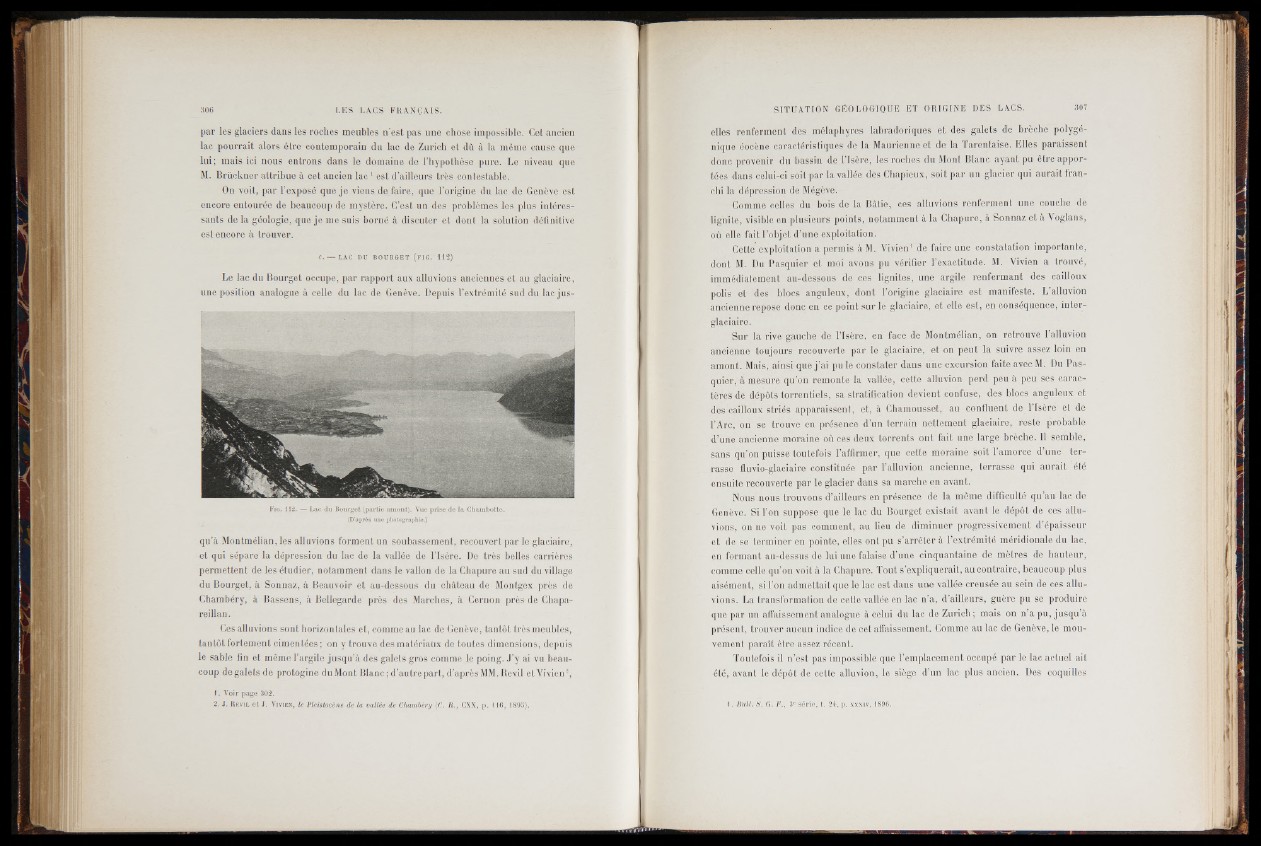
par les glaciers dans les roches meubles n’est pas une chose impossible. Cet ancien
lac pourrait alors être contemporain du lac de Zurich et dû à la même cause que
lui; mais ici nous entrons dans le domaine de l’hypothèse pure. Le niveau que
M. Brückner attribue à cet ancien la c1 est d’ailleurs très contestable.
On voit, par l’exposé que je viens de faire, que l’origine du lac de Genève est
encore entourée de beaucoup de mystère. C’est un des problèmes les plus intéressants
de la géologie, que je me suis borné à discuter et dont la solution définitive
est encore à trouver.
C. — LAC Dü BOÜRGET (F IG . 1 1 2 )
Le lac du Bourget occupe, par rapport aux alluvions anciennes et au glaciaire,
une position analogue à celle du lac de Genève. Depuis l’extrémité sud du lac jus-
Fig. 112. — Lac du Bourget (partie amont). Vue prise de la Chambotte.
(D'après une photographie.)
qu’à Montmélian, les alluvions forment un soubassement, recouvert par le glaciaire,
et qui sépare la dépression du lac de la vallée de l’Isère. De très belles carrières
permettent de les étudier, notamment dans le vallon de la Chapure au sud du village
du Bourget, à Sonnaz, à Beauvoir et au-dessous du château de Montgex près de
Chambéry, à Bassens, à Bellegarde près des Marches, à Cernon près de Chapa-
reillan.
Ces alluvions sont horizontales et, comme au lac de Genève, tantôt très meubles,
tantôt fortement cimentées; on y trouve des matériaux de toutes dimensions, depuis
le sable fin et même l’argile jusqu’à des galets gros comme le poing. J’y ai vu beaucoup
de galets de protogine du Mont Blanc; d’autre part, d’après MM. Revil et Vivien2,
| . Voir p age 302.
2 . J. Revil e t J. Vivien, le Pleistocène d e la vallée de Chambéry (C. R ., GXX, p . 116, 1893).
—
elles renferment des mélaphyres labradoriques et des galets de brèche polygé-
nique éocène caractéristiques de la Maurienne et de la Tarenlaise. Elles paraissent
donc provenir du bassin de l’Isère, les roches du Mont Blanc ayant pu être apportées
dans celui-ci soit par la vallée des Chapieux, soit par un glacier qui aurait franchi
la dépression de Mégève.
Comme celles du bois de la Bâtie, ces alluvions renferment une couche de
lignite, visible en plusieurs points, notamment à la Chapure, à Sonnaz et à Yoglans,
où elle fait l ’objet d’une exploitation.
Cette exploitation a permis àM. Vivien1 de faire une constatation importante,
dont M. Du Pasquier et moi avons pu vérifier l’exactitude. M. Vivien a trouvé,
immédiatement au-dessous de ces lignites, une argile renfermant des cailloux
polis et des blocs anguleux, dont l’origine glaciaire est manifeste. L’alluvion
ancienne repose donc en ce point sur le glaciaire, et elle est, en conséquence, interglaciaire.
Sur la rive gauche de l’Isère, en face de Montmélian, on retrouve l’alluvion
ancienne toujours recouverte par le glaciairè, et on peut la suivre assez loin en
amont. Mais, ainsi que j’ai pu le constater dans une excursion faite avecM. Du Pasquier,
à mesure qu’on remonte la vallée, cette alluvion perd peu à peu ses caractères
de dépôts torrentiels, sa stratification devient confuse, des blocs anguleux et
des cailloux striés apparaissent, et, à Chamousset, au confluent de l’Isère et de
l’Arc, on se trouve en présence d’un terrain nettement glaciaire, reste probable
d’une ancienne moraine où ces deux torrents ont fait une large brèche. Il semble,
sans qu’on puisse toutefois l’affirmer, que cette moraine soit l’amorce d’une terrasse
fluvio-glaciaire constituée par l’alluvion ancienne, terrasse qui aurait été
ensuite recouverte par le glacier dans sa marche en avant.
Nous nous trouvons d’ailleurs en présence de la même difficulté qu’au lac de
Genève. Si l’on suppose que le lac du Bourget existait avant le dépôt de ces alluvions,
on ne voit pas comment, au lieu de diminuer progressivement d’épaisseur
et de se terminer en pointe, elles ont pu s’arrêter à l’extrémité méridionale du lac,
en formant au-dessus de lui une falaise d’une cinquantaine de mètres de hauteur,
comme celle qu’on voit à la Chapure. Tout s’expliquerait, au contraire, beaucoup plus
aisément, si l’on admettait que le lac est dans une vallée creusée au sein de ces alluvions.
La transformation de cette vallée en lac n’a, d’ailleurs, guère pu se produire
que par un affaissement analogue à celui du lac de Zurich; mais on n’a pu, jusqu’à
présent, trouver aucun indice de cet affaissement. Comme au lac de Genève, le mouvement
paraît être assez récent.
Toutefois il n’est pas impossible que l’emplacement occupé par le lac actuel ait
été, avant le dépôt de cette alluvion, le siège d’un lac plus ancien. Des coquilles
■1. Bull. S . G. F ., 3° s é r ie , t. 24, p. x x x iv , 1896.