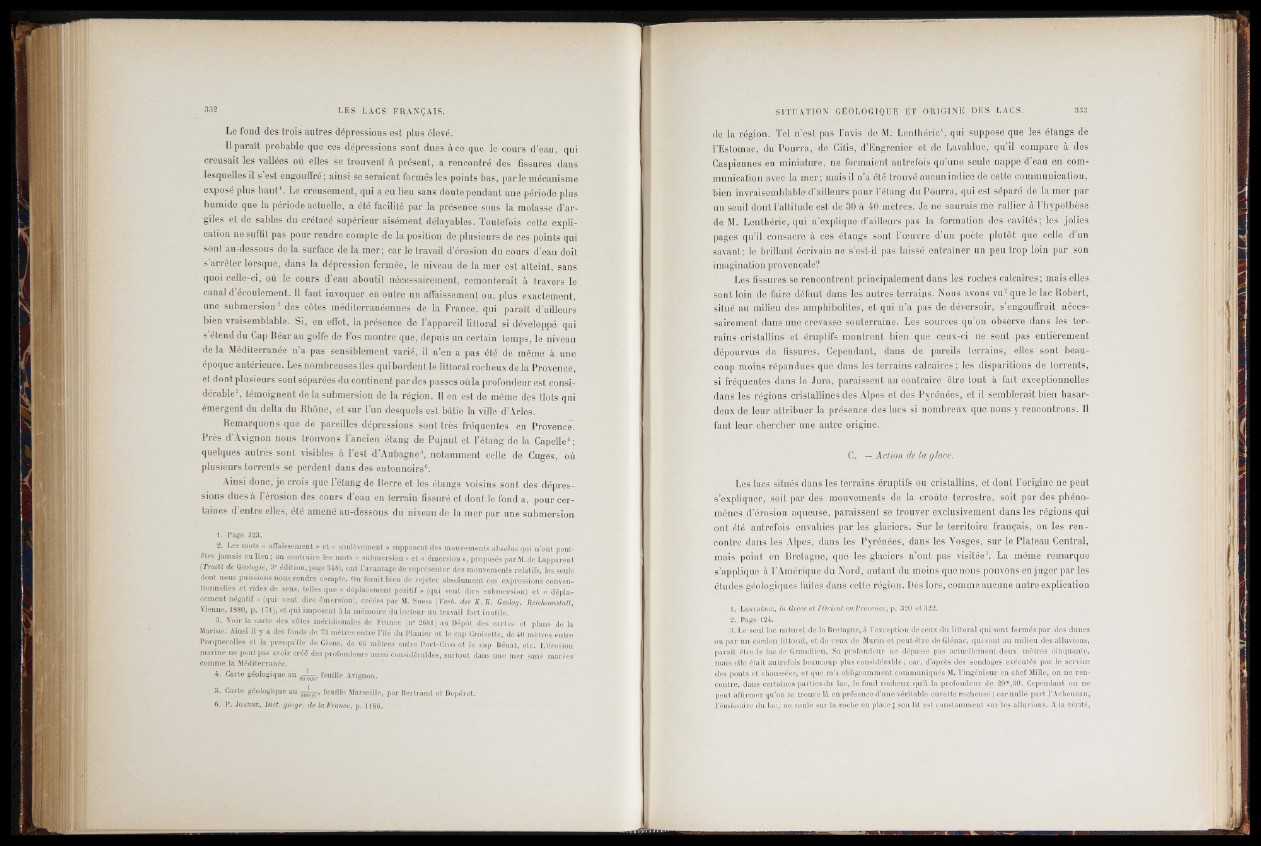
Le fond des trois autres dépressions est plus élevé.
Il parait probable que ces dépressions sont dues à ce que le cours d’eau, qui
creusait les vallées où elles se trouvent à présent, a rencontré des fissures dans
lesquelles il s est engouffré ; ainsi se seraient formés les points bas, parle mécanisme
exposé plus haut1. Le creusement, qui a eu lieu sans doute pendant une période plus
humide que la période actuelle, a été facilité par la présence sous la molasse d’argiles
et de sables du crétacé supérieur aisément délayables. Toutefois cette explication
ne suffit pas pour rendre compte de la position de plusieurs de ces points qui
sont au-dessous de la surface de la mer; car le travail d’érosion du cours d’eau doit
s'arrêter lorsque, dans la dépression fermée, le niveau de la mer est atteint, sans
quoi celle-ci, où le cours d’eau aboutit nécessairement, remonterait à travers le
canal d’écoulement. Il faut invoquer en outre un affaissement ou, plus exactement,
une submersion2 des côtes méditerranéennes de la France, qui paraît d’ailleurs
bien vraisemblable. Si, en effet, la présence de l’appareil littoral si développé qui
s’étend du Cap Béar au golfe de Fos montre que, depuis un certain temps, le niveau
de la Méditerranée n’a pas sensiblement varié, il n’en a pas été de même à une
époque antérieure. Les nombreuses îles qui bordent le littoral rocheux de la Provence,
et dont plusieurs sont séparées du continent par des passes oùla profondeur est considérable3,
témoignent de la submersion de la région. Il en est de même des îlots qui
émergent du delta du Rhône, et sur l’un desquels est bâtie la ville d’Arles.
Remarquons que de pareilles dépressions sont très fréquentes en Provenez
Près d’Avignon nous trouvons l’ancien étang de Pujaut et l’étang de la Capelle4 ;
quelques autres sont visibles à l’est d’Aubagne5, notamment celle de Cuges, où
plusieurs torrents se perdent dans des entonnoirs6.
Ainsi donc, je crois que l’étang de Berre et les étangs voisins.sont des dépressions
dues à l’érosion des cours d’eau en terrain fissuré et dont le fond a, pour certaines
d’entre elles, été amené au-dessous du niveau de la mer par une submersion
1. P a g e 323.
2 . Les m o ts « a ffa issem en t » e t « so u lè v em en t » su p p o sen t d e s m o u v em en ts ab so lu s qui n ’o n t peut-
ê tr e jam a is eu lie n ;’ a n con tr a ir e l e s m o ts « su bm e r s io n » e t « ém e r s io n » , p rop o sés p a rM .d e Lapparent
(Traité d e Géologie, 3e éd itio n , pa g e 548), o n t l ’avantage d e r ep r é sen te r d e s m o u v em en ts r e la tifs, le s seu ls
d ont n o u s p u is s io n s n o u s ren d r e com p te . On fe r a it b ie n de r e je te r a b so lum en t c e s e x p r e ssio n s con v en tio
n n e lle s e t v ide s de s en s , te lle s q u e « d ép la c em en t p o s it if » (qui v eu t d ir e su bm e r sion ) e t « d ép la c
em en t n é g a tif » (qui v eu t d ir e ém e r s io n ), c r é é e s p ar M. S u e ss (Terh. d e r K . K . Geolog. Rekhmnsla.il,
Vienne, 1880, p . 171), e t q u i im p o s en t à la m ém o ir e du le c teu r u n travail for t in u tile .
3 . Voir la car te d e s c ô le s m é r id io n a le s de F ran c e (n” 2681) au Dépôt des c a r te s e t p lan s de la
Marine. A in si il y a d e s fon d s d e 73 m è tr e s en tr e l’île du P la n ie r e t l e cap Croise tte , d e 40 m è tr e s entre
P o rq u e r o lle s e t la p r e sq u ’île d e Giens, d e 66 m è tr e s en tr e P o r t-C r o s e t l e cap Bénat, e tc . L’é r o sion
m a r in e n e p eu t p a s av o ir c r é é des p ro fon d eu rs au ssi con sid é rab le s, su r tou t dans u n e me r san s m a r ées
com m e la Méditerranée.
4 . Carte g éo lo g iq u e au ¿¡A—, fe u ille Avignon.
5 . Carte g é o lo g iq u e au 55^ , fe u ille Mar seille , p a r Bertrand e t D epé ret.
6. P . Joah.vb, D ic i. g éogr. d e la France, p . 1186.
de la région. Tel n’est pas l’avis de M. Lenthéric1, qui suppose que les étangs de
l’Estomac, du Pourra, de Citis, d’Engrenier et de Lavalduc, qu’il compare à des
Caspiennes en miniature, ne formaient autrefois qu’une seule nappe d’eau en communication
avec la mer; mais il n’a été trouvé aucun indice de cette communication,
bien invraisemblable d’ailleurs pour l’étang du Pourra, qui est séparé de la mer par
un seuil dont l’altitude est de 30 à 40 mètres. Je ne saurais me rallier à l ’hypothèse
de M. Lenthéric, qui n’explique d’ailleurs pas la formation des cavités; les jolies
pages qu’il consacre à ces étangs sont l’oeuvre d’un poète plutôt que celle d’un
savant; le brillant écrivain ne s’est-il pas laissé entraîner un peu trop loin par son
imagination provençale?
Les fissures se rencontrent principalement dans les roches calcaires ; mais elles
sont loin de faire défaut dans les autres terrains. Nous avons vu8 que le lac Robert,
situé au milieu des amphibolites, et qui n’a pas de déversoir, s’engouffrait nécessairement
dans une crevasse souterraine. Les sources qu’on observe dans les terrains
cristallins-et éruptifs montrent bien que ceux-ci ne sont pas entièrement
dépourvus de. fissures. Cependant, dans de pareils terrains, elles sont beaucoup
moins répandues que dans les terrains calcaires ; les disparitions de torrents,
si fréquentes dans le Jura, paraissent au contraire être tout à fait exceptionnelles
dans les régions cristallines des Alpes et des Pyrénées, et il semblerait bien hasardeux
de leur attribuer la présence des lacs si nombreux que nous y rencontrons. Il
faut leur chercher une autre origine.
C. — Action de la glace.
Les lacs situés dans les terrains éruptifs ou cristallins, et dont l’origine ne peut
s’expliquer, soit par des mouvements de la croûte terrestre, soit par des phénomènes
d’érosion aqueuse, paraissent se trouver exclusivement dans les régions qui
ont été autrefois envahies par les glaciers. Sur le territoire français, on les rencontre
dans les Alpes, dans les Pyrénées, dans les Vosges, sur le Plateau Central,
mais point en Bretagne, que les glaciers n’ont pas visitée3. La même remarque
s’applique à l’Amérique du Nord, autant du moins quenous pouvons en juger par les
études géologiques faites dans cette région. Dès lors, comme aucune autre explication
1. Lenthéric, la Grèce e t l'Orient en Provence, p . 320 e t 322.
2 . Page 124.
3. Le s eu l la c n a tu r e l d e la B reta gne , à l’e x c ep tio n d e c eu x d u litto r a l q u i so n t fo rm é s p ar d e s dun es
ou p ar u n co rdon litto r a l, e t de c e u x d e Murin e t p eu t-ê tr e de Glénac, q u i so n t a u m ilie u d e s a llu v io n s,
p araît ê tr e le la c de Grandlieu. Sa p ro fon d eu r n e d ép a sse p a s a c tu e llem en t d eu x m è tr e s cin q u a n te ,
m a is e lle é ta it a u tr e fo is beau cou p p lu s co n sid é ra b le ; car, d’ap rès d e s so n d a g e s e x é cu té s par le s e r v ic e
d e s ponts e t ch a u ssé e s, e t q u e m ’a o b lig e am m en t com m u n iq u é s M. l ’in g é n ie u r en c h e f Mille, o n n e r en co
n tr e , dans c e r ta in e s p a r tie s du la c , l e fon d r o c h e u x qu’à la p ro fon d eu r d e 20m,50. Cependant o n n e
p eu t affirmer q u ’on se trouve là en p r é sen c e d’u n e v é r ita b le cu v e tte ro ch eu se ; car n u lle p a r t l ’A cheneau,
l ’ém issa ir e dû la c , n e c o u le su r la ro ch e en p la c e j so n lit e s t c o n stam m en t su r le s a llu v io n s. A la v é r ité ,