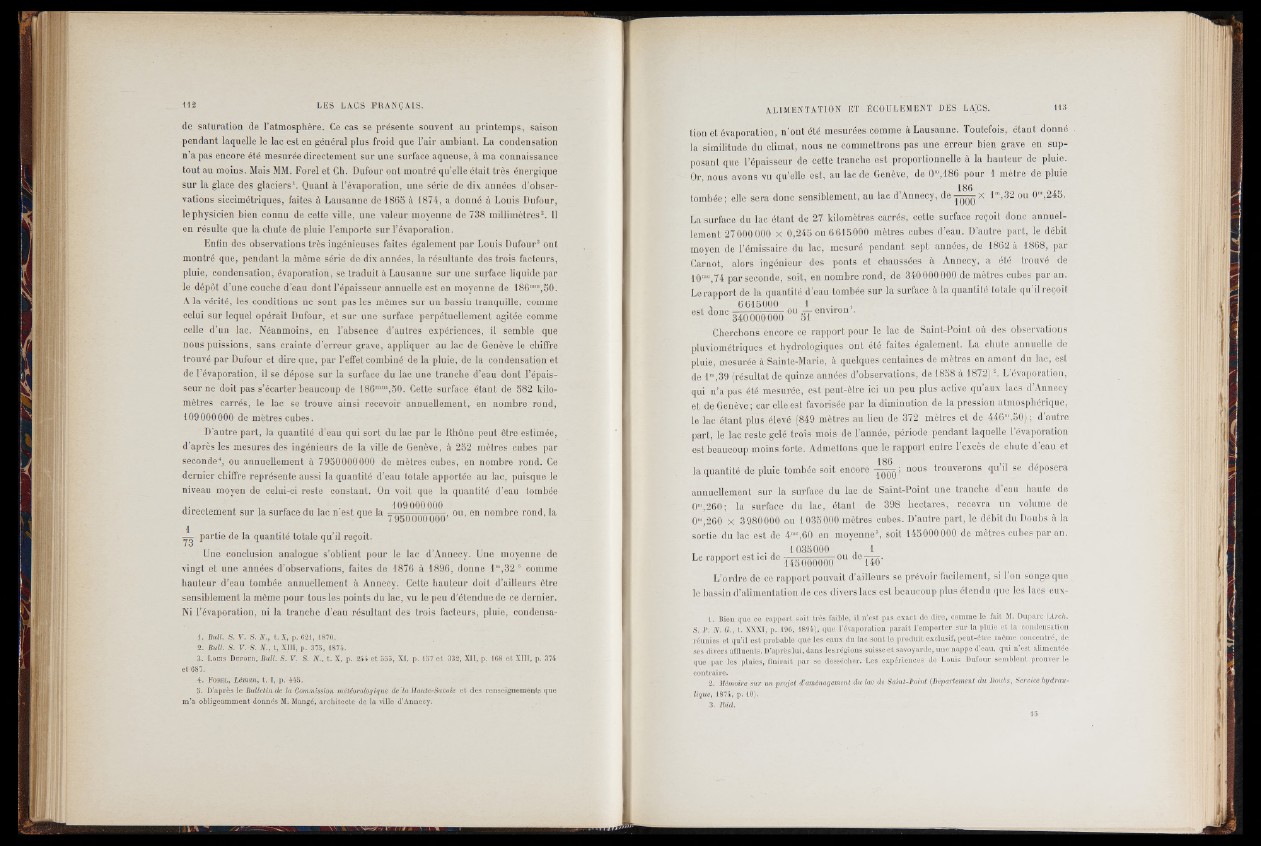
de saturation de l’atmosphère. Ce cas se présente souvent au printemps, saison
pendant laquelle le lac est en général plus froid que l’air ambiant. La condensation
n’a pas encore été mesurée directement sur une surface aqueuse, à ma connaissance
tout au moins. Mais MM. Forel et Ch. Dufour ont montré qu’elle était très énergique
sur la glace des glaciers1. Quant à l’évaporation, une série de dix années d’observations
siccimétriques, faites à Lausanne de 1865 à 1874, a donné à Louis Dufour,
le physicien bien connu de cette ville, une valeur moyenne de 738 millimètres*. Il
en résulte que la chute de pluie l’emporte sur l’évaporation.
Enfin des observations très ingénieuses faites également par Louis Dufour8 ont
montré que, pendant la même série de dix années, la résultante des trois facteurs,
pluie, condensation, évaporation, se traduit à Lausanne sur une surface liquide par
le dépôt d’une couche d’eau dont l’épaisseur annuelle est en moyenne de 186mm,50.
A la vérité, les conditions ne sont pas les mêmes sur un bassin tranquille, comme
celui sur lequel opérait Dufour, et sur une surface perpétuellement agitée comme
celle d’un lac. Néanmoins, en l’absence d’autres expériences, il semble que
nous puissions, sans crainte d’erreur grave, appliquer au lac de Genève le chiffre
trouvé par Dufour et dire que, par l’effet combiné de la pluie, de la condensation et
de l’évaporation, il se dépose sur la surface du lac une tranche d’eau dont d’épaisseur
ne doit pas s’écarter beaucoup de 186mm,50. Cette surface étant de 582 kilomètres
carrés, le lac se trouve ainsi recevoir annuellement,, en nombre rond,
109000000 de mètres cubes.
D’autre part, la quantité d’eau qui sort du lac par le Rhône peut être estimée,
d’après les mesures des ingénieurs de la ville de Genève, à 252 mètres cubes par
seconde4, ou annuellement à 7950000000 de mètres cubes, en nombre rond. Ce
dernier chiffre représente aussi la quantité d’eau totale apportée au lac, puisque le
niveau moyen de celui-ci reste constant. On voit que la quantité d’eau tombée
A■ M Ê È , - , A , i l , 109000000 d i r e c t e m e n t s u r l a s u r f a c e d u la c n e s t q u e l a y q q q q q q q » o u , e n n o m b r e r o n d , la
1—
partie de la quantité totale qu’il reçoit.
Une conclusion analogue s’obtient pour le lac d’Annecy. Une moyenne de
vingt et une années d’observations, faites de 1876 à 1896, donne 1“,32 • comme
hauteur d’eau tombée annuellement à Annecy. Cette hauteur doit d’ailleurs être
sensiblement la même pour tous les points du lac, vu le peu d’étendue de ce dernier.
Ni l’évaporation, ni la tranche d’eau résultant des trois facteurs, pluie, condensa-
1. Bull. S . V . S . N ., t. X, p . 621, 1870.
2 . B ull. S . T .'S . N-, t , XIII, p . 375, 1874.
3 . Louis D u fou r, B ull. S . V . S . N ., t . X, p . 244 e t 555, XI, p. 157 e t 332, XII, p . 168 e t XIII, p. 374
e t 687.
4 . F orel, L éman, t. I , p . 445.
5. D’a p rès le Bulletin de la Commission météorologique de là HauterSavoie e t d es r en se ig n em en ts que
m ’a ob lig e am m en t d on n é s M. Mangé, a r ch ite c te d e la v ille d’A n ne cy .
Lj(in évaporation, n’ont été mesurées-comme à Lausanne. Toutefois, étant donne
la similitude du climat, nous ne commettrons pas une erreur bien grave en supposant
que l’épaisseur de cette tranche est proportionnelle à la hauteur de pluie.
Or, nous avons vu qu’elle est, au lac de Genève, de 0m,186 pour 1 mètre de pluie
tombée ; elle sera donc sensiblement, au lac d Annecy, de Jqqq * ^ ou 0 ,245.
La surface du lac étant de 27 kilomètres carrés, cette surface reçoit donc annuellement
27000000 x 0,245 ou 6615000 mètres cubes d’eau. D’autre part, le débit
moyen de l’émissaire du lac, mesuré pendant sept années, de 1862 à 1868, par
Carnot, alors ingénieur des ponts et chaussées à Annecy, a été trouvé de
10”°,74 par seconde, soit, en nombre rond, de 340000000 de mètres cubes par an.
Le rapport de la quantité d’eau tombée sur la surface à la quantité totale qu’il reçoit
est dI onc--6--6--1--5--0-0--0-- --ou —1 envi. ron I. est cionc 3400 0 0 ooo 51
Cherchons encore ce rapport pour le lac de Saint-Point où des observations
pluviométriques et hydrologiques ont été faites également. La chute annuelle de
pluie, mesurée à Sainte-Marie, à quelques centaines de mètres en amont du lac, est
de lm,39 (résultat de quinze années d’observations, de 1858 à 1872)2. L’évaporation,
qui n’a pas été mesurée, est peut-être ici un peu plus active qu aux lacs d Annecy
et de Genève; car elle est favorisée par la diminution de la pression atmosphérique,
le lac étant plus élevé (849 mètres au lieu de 372 mètres et de 446”,50).; d’autre
part, le lac reste gelé trois mois de l’année, période pendant laquelle l’évaporation
est beaucoup moins forte. Admettons que le rapport entre 1 excès de chute d eau et
la quantité de pluie tombée soit encore ; nous trouverons qu’il se déposera
annuellement sur la surface du lac de Saint-Point une tranche d eau haute de
0",260; la surface du lac, étant de 398 hectares, recevra un volume de
0n,,260 x 3980000 ou 1035000 mètres cubes. D’autre part, le débit du Doubs à la
sortie du lac est de 4”°,60 en moyenne8, soit 145000000 de mètres cubes par an.
. . , 1035000 I 1
Le rapport est ic, de ^ 00^ ou d e ^ .
L’ordre de ce rapport pouvait d’ailleurs se prévoir facilement, si 1 on songe que
le bassin d’alimentation de ces divers lacs est beaucoup plus étendu que les lacs eux-
1. Bien que c e rapport s o it tr è s fa ib le , il n ’e st p a s e x a c t d e dir e, com m e l e fa it M. Duparc (A rch .
S . P. IŸ. Gf., t. XXXI, p . 196, 1894), q u e l’év ap oration p a ra ît l’em po r te r su r la p lu ie e t la co n d en sa tio n
r éu n ie s e t qu ’il e s t p rob able que le s ea u x d u la c so n t l e p rod u it e x c lu s if, p eu t-ê tr e m êm e c o n c en tr é , de
se s d ivers afflu en ts. D’après lu i , d ans le s r é g io n s su is s e e t sa voyard e, u n e n ap p e d’eau, q ui n ’e s t a lim en té e
q u e p ar le s p lu ie s, fin ir a it p ar se d e ssé ch e r . Les e x p é r ien c e s d e Louis Du fou r s em b len t p rou v er le
c o n t r a ir e ..
2 . Mémoire sur un p r o je t d’aménagement du lac de S a in t-P o in t (D épartement du Doubs, S ervice h y d ra u lique,
1874, p. 10).
3. Ib id .
f