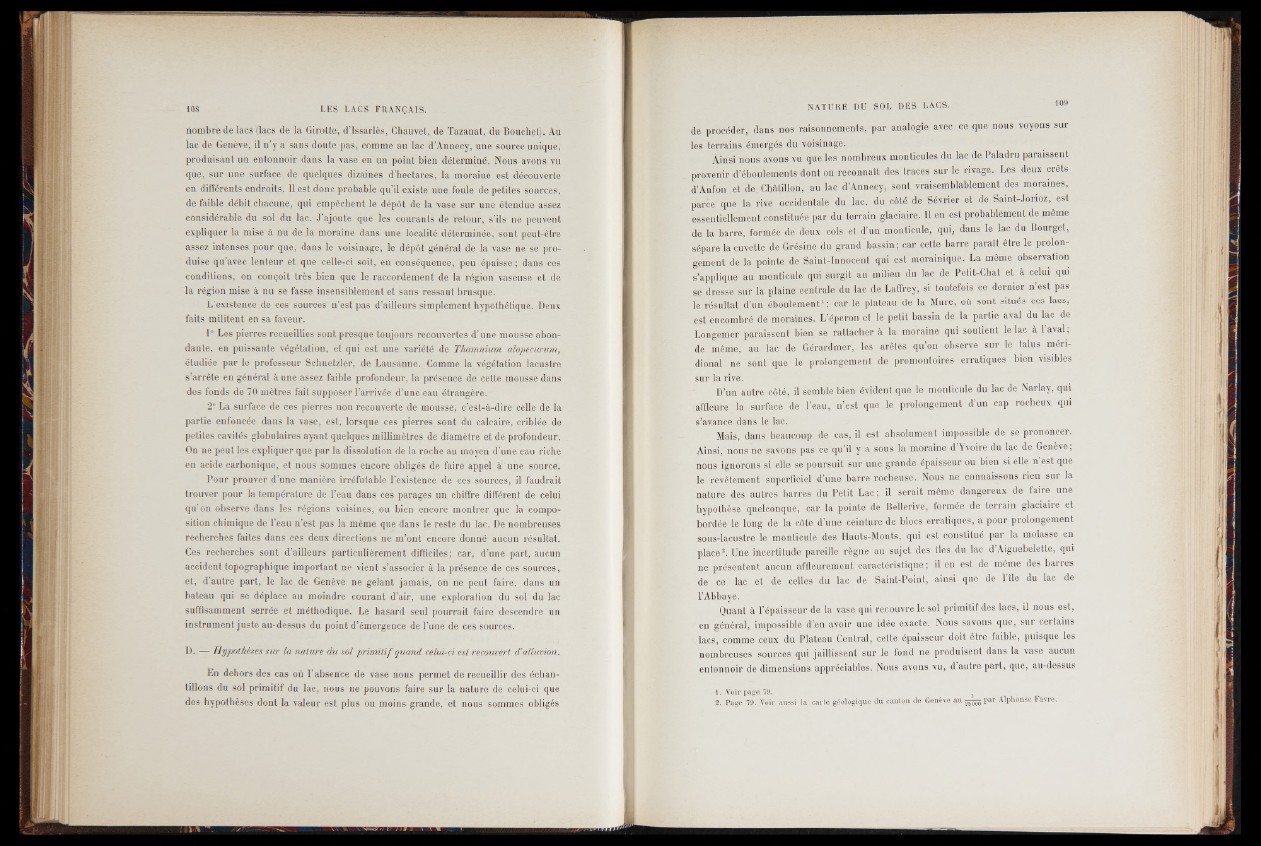
nombre de lacs (lacs de la Girolte, d’Issarlès, Chauvel, de Tazànat, du Bouchet). Au
lac de Genève, il n’y a sans doute pas, comme au lac d’Annecy, une source unique,
produisant un entonnoir dans la vase en un point bien déterminé. Nous avons vu
que, sur une surface de quelques dizaines d’hectares, la moraine est découverte
en différents endroits. Il est donc probable qu’il existe une foule de petites sources,
de faible débit chacune, qui empêchent le dépôt de la vase sur une étendue assez
considérable du sol du lac. J’ajoute que les courants de retour, s’ils ne peuvent
expliquer la mise à nu de la moraine dans une localité déterminée, sont peut-être
assez intenses pour que, dans le voisinage, le dépôt général de la vase ne se produise
qu’avec lenteur et que celle-ci soit, en conséquence, peu épaisse ; dans ces
conditions, on conçoit très bien que le raccordement de la région vaseuse et de
la région mise à nu se fasse insensiblement et sans ressaut brusque.
L’existence de ces sources n’est pas d’ailleurs simplement hypothétique. Deux
faits militent en sa faveur.
i° Les pierres recueillies sont presque toujours recouvertes d’une mousse abondante,
en puissante végétation, et qui est une variété de Thamnium alopecuritm,
étudiée par le professeur Schnetzler, de Lausanne. Comme la végétation lacustre
s’arrête en général à une assez faible profondeur, la présence de cette mousse dans
des fonds de 70 mètres fait supposer l ’arrivée d’une eau étrangère.
2° La surface de ces pierres non recouverte de mousse, c’est-à-dire celle de la
partie enfoncée dans la vase, est, lorsque ces pierres sont du calcaire, criblée de
petites cavités globulaires ayant quelques millimètres de diamètre et de profondeur.
On ne peut les expliquer que par la dissolution de la roche au moyen d’une eau riche
en acide carbonique, et nous sommes encore obligés de faire appel à une source.
Pour prouver d’une manière irréfutable l’existence de ces sources, il faudrait
trouver pour la température de l’eau dans ces parages un chiffre différent de celui
qu’on observe dans les régions voisines, ou bien encore montrer que la composition
chimique de l’eau n’est pas la même que dans le reste du lac. De nombreuses
recherches faites dans ces deux directions ne m’ont encore donné aucun résultat.
Ces recherches sont d’ailleurs particulièrement difficiles; car, d’une part, aucun
accident topographique important ne vient s’associer à la présence de ces sources,
et, d’autre part, le lac de Genève, ne gelant jamais, on ne peut faire, dans un
bateau qui se déplace au moindre courant d’air, une exploration du sol du lac
suffisamment serrée et méthodique. Le hasard seul pourrait faire descendre un
instrument juste au-dessus du point d’émergence de l ’une de ces sources.
D. — Hypothèses sur la nature du sol primitif quand celui-ci est recouvert d’alluvion.
En dehors des cas où l’absence de vase nous permet de recueillir des échantillons
du sol primitif du lac, nous ne pouvons faire sur la nature de celui-ci que
des hypothèses dont la valeur est plus ou moins grande, et nous sommes obligés
de procéder, dans nos raisonnements, par analogie avec ce que nous voyons sur
les terrains émergés du voisinage.
Ainsi nous avons vu que les nombreux monticules du lac de Paladru paraissent
provenir d’éboulements dont on reconnaît des traces sur le rivage. Les deux crêts
d’Anfon et de Châtillon, au lac d’Annecy, sont vraisemblablement des moraines,
parce que la rive occidentale du lac, du côté de Sévrier et de Saint-Jorioz, est
essentiellement constituée par du terrain glaciaire. Il en est probablement de même
de la barre, formée de deux cols et d’un monticule, qui, dans le lac du Bourget,
sépare la cuvette de Grésine du grand'bassin; car cette barre parait être le prolongement
de la pointe de Saint-Innocent qui est morainique. La même observation
s’applique au monticule qui surgit au milieu du lac de Petit-Chat et à celui qui
se dresse sur la plaine centrale du lac de Laffrey, si toutefois ce dernier n est pas
le résultat d’un éboulement1; car le plateau de la Mure, où sont situés ces lacs,
est encombré de moraines. L’éperon et le petit bassin de la partie aval du lac de
Longemer paraissent bien se rattacher à la moraine qui soutient le lac à l’aval;
de même, au lac de Gérardmer, les arêtes qu’on observe sur le talus méridional
ne sont que le prolongement de promontoires erratiques bien visibles
sur la rive.
D’un autre côté, il semble bien évident que le monticule du lac de Narlay, qui
affleure la surface de l’eau, n’est que le prolongement d’un cap rocheux qui
s’avance dans le lac.
Mais, dans beaucoup de cas, il est absolument impossible de se prononcer.
Ainsi, nous ne savons pas ce qu’il y a sous la moraine d Yvoire du lac de Genève,
nous ignorons si elle se poursuit sur une grande épaisseur ou bien si elle n’est que
le revêtement superficiel d’une barre rocheuse. Nous ne connaissons rien sur la
nature des autres barres du Petit Lac; il serait même dangereux de faire une
hypothèse quelconque, car la pointe de Bellerive, formée de terrain glaciaire et
bordée le long de la côte d’une ceinture de blocs erratiques, a pour prolongement
sous-lacustre le monticule des Hauts-Monts, qui est constitué par la molasse en
place2. Une incertitude pareille règne au sujet des îles du lac d Aiguebelette, qui
ne présentent aucun affleurement caractéristique ; il en est de même des barres
de ce lac et de celles du lac de Saint-Point, ainsi que de 1 île du lac de
l’Abbaye.
Quant à l’épaisseur de la vase qui recouvre le sol primitif des lacs, il nous est,
en général, impossible d’en avoir une idée exacte. Nous savons que, sur certains
lacs, comme ceux du Plateau Central, cette épaisseur doit être faible, puisque les
nombreuses sources qui jaillissent sur le fond ne produisent dans la vase aucun
entonnoir de dimensions appréciables. Nous avons vu, d autre part, que, au-dessus
1. Voir pa g e 79. |
2 . Page 79. Voir au ssi la car te g é o lo g iq u e d u ca n to n de Genève au ^ ô ô Pa r Â1Pll0 û s e F a v r e -