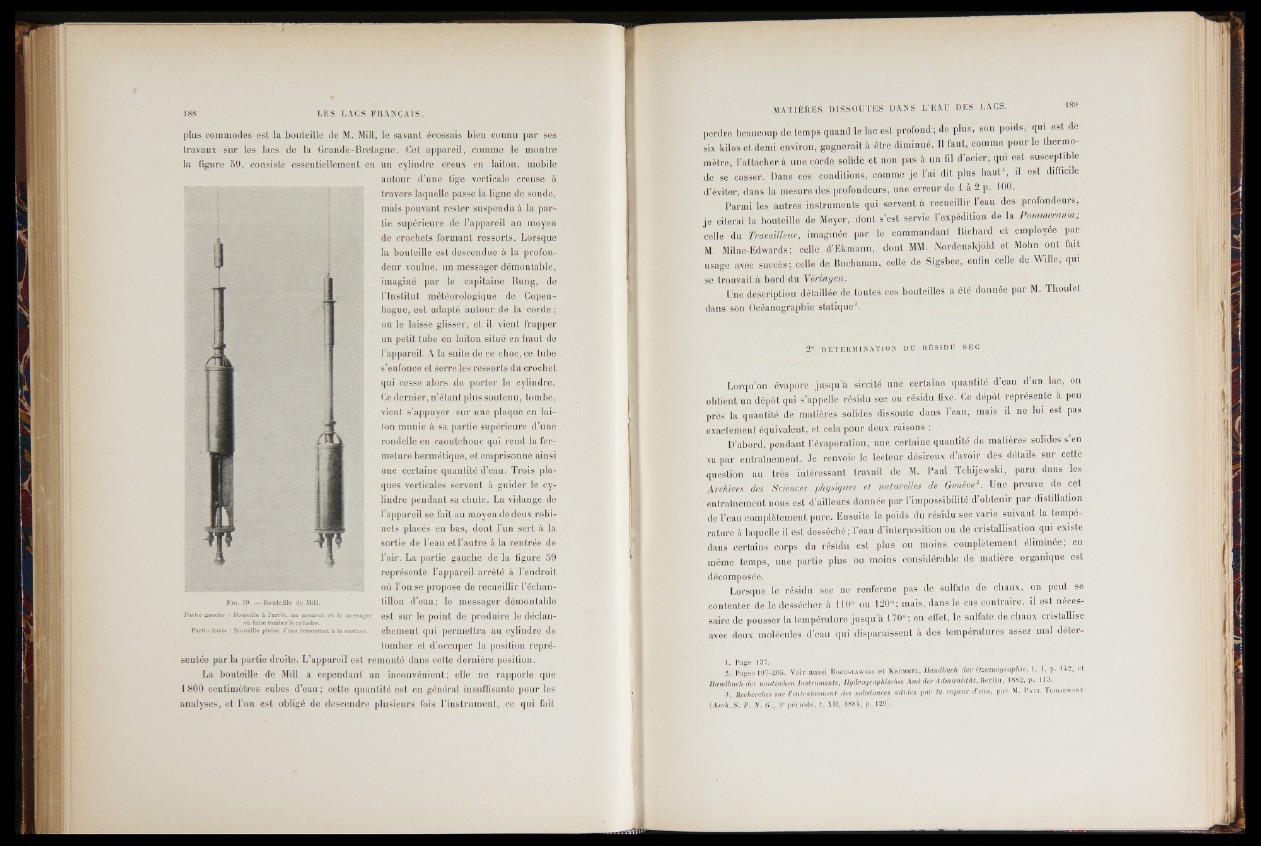
plus commodes est la bouteille de M. Mill, le savant écossais bien connu par ses
travaux sur les lacs de la Grande-Bretagne. Cet appareil, comme le montre
la figure 59, consiste essentiellement en un cylindre creux en laiton, mobile
autour d’une tige verticale creuse à
travers laquelle passe la ligne de sonde,
mais pouvant rester suspendu à la partie
supérieure de l’appareil au moyen
de crochets formant ressorts. Lorsque
la bouteille est descendue à la profondeur
voulue, un messager démontable,
imaginé par le capitaine Rung, de
l’Institut météorologique de Copenhague,
est adapté autour de la corde ;
on le laisse glisser, et il vient frapper
un petit tube en laiton situé en haut de
l’appareil. A la suite de ce choc, ce tube
s’enfonce et serre les ressorts du crochet
qui cesse alors de porter le cylindre.
Ce dernier, n’étant plus soutenu, tombe,
vient s’appuyer sur une plaque en laiton
munie à sa partie supérieure d’une
rondelle en caoutchouc qui rend la fermeture
hermétique, et emprisonne ainsi
une certaine quantité d’eau. Trois plaques
verticales servent à guider le cylindre
pendant sa chute. La vidange de
l’appareil se fait au moyen de deux robinets
placés en bas, dont l’un sert à la
sortie de l’eau et l’autre à la rentrée de
l’air. La partie gauche de la figure 59
représente l’appareil arrêté à l’endroit
où l’on se propose de recueillir l’échan-
f ig . 59. — Bouteille de Mili. tillon d’eau; le messager démontable
Partie gauche : Bouteille à l’arrêt, au moment où le messager e s t S U r l e p o i n t d e p r o d u i r e l e d é c l a i l -
va faire tomber le cylindre.
Partie droite : Bouteille pleine d'eau remontant à la surface. c h e m e n t q u i p e r m e t t r a aU C y l i n d r e d e
tomber et d’occuper la position représentée
par la partie droite. L’appareil est remonté dans cette dernière position.
La bouteille de Mill a cependant un inconvénient; elle ne rapporte que
1800 centimètres cubes d’eau; cette quantité est en général insuffisante pour les
analyses, et l’on est obligé de descendre plusieurs fois l’instrument, ce qui fait
perdre beaucoup de temps quand le lac est profond; de plus, son poids, qui est de
six kilos et demi environ, gagnerait à être diminué. Il faut, comme pour le thermomètre,
l’attacher à une corde solide et non pas à un fil d’acier, qui est susceptible
de se casser. Dans ces conditions, comme je l’ai dit plus haut1, il est difficile
d’éviter, dans la mesure des profondeurs, une erreur de 1 à 2 p. 100.
Parmi les autres instruments qui servent à recueillir l’eau des profondeurs,
je citerai la bouteille de Meyer, dont s’est servie l’expédition de la Pommeranm;
celle du Travailleur, imaginée par le commandant Richard et employée par
M. Milne-Edwards; celle d’Ekmann, dont MM. Nordenskjôld et Mohn ont fait
usage avec succès; celle de Buchanan, celle de Sigsbee, enfin celle de Wille, qui
se trouvait à bord du Voringen.
Une description détaillée de toutes ces bouteilles a été donnée par M. Thoulet
dans son Océanographie statique*.
2° D É T E R M IN A T IO N - D U R É S ID U S E C . '
Lorqu’on évapore jusqu’à siccité une certaine quantité d’eau d’un lac, on
obtient un dépôt qui s’appelle résidu sec ou résidu fixe. Ce dépôt représente à peu
près la quantité de matières solides dissoute dans l’eau, mais il ne lui est pas
exactement équivalent, et cela pour deux raisons :
D’abord, pendant l’évaporation, une certaine quantité de matières solides s’en
va par entraînement. Je renvoie le lecteur désireux d’avoir des détails sur cette
question au très intéressant travail de M. Paul Tchijewski, paru dans les
Archives des Sciences physiques et naturelles de Genève3. Une preuve de cet
entraînement nous est d’ailleurs donnée par l’impossibilité d’obtenir par distillation
de l’eau complètement pure. Ensuite le poids du résidu sec varie suivant Ja température
à laquelle il est desséché ; l’eau d’interposition ou de cristallisation qui existe
dans certains corps du résidu est plus ou moins complètement éliminée; en
même temps, une partie plus ou moins considérable de matière organique est
décomposée.
Lorsque le résidu sec ne renferme pas de sulfate de chaux, on peut se
contenter de le dessécher à 110° ou 120°; mais, dans le cas contraire, il est nécessaire
de pousser la température jusqu’à 170° ; en effet, le sulfate de chaux cristallise
avec deux molécules d’eau qui disparaissent à des températures assez mal déter-
1. P a g e 137.
2 . Pages 197-205. Voir a u ssi Boguslawski e t Krümmel, Handbuch d e r Ozeanographie, t . I, p . 142, e t
Handbuch d e r nautischen Instrumente, Hydrographisches Am t d e r A dm ir a litä t, B e r lin , 1882, p. 113.
3. Recherches sur l'entraînement des substances solides p a r la va p eur d'eau, p a r M. P a u l T c h ijew sk y
(.Arcfi. S. P. N. G., 3 e p é r io d e , t. XII, 1884, p . 120).