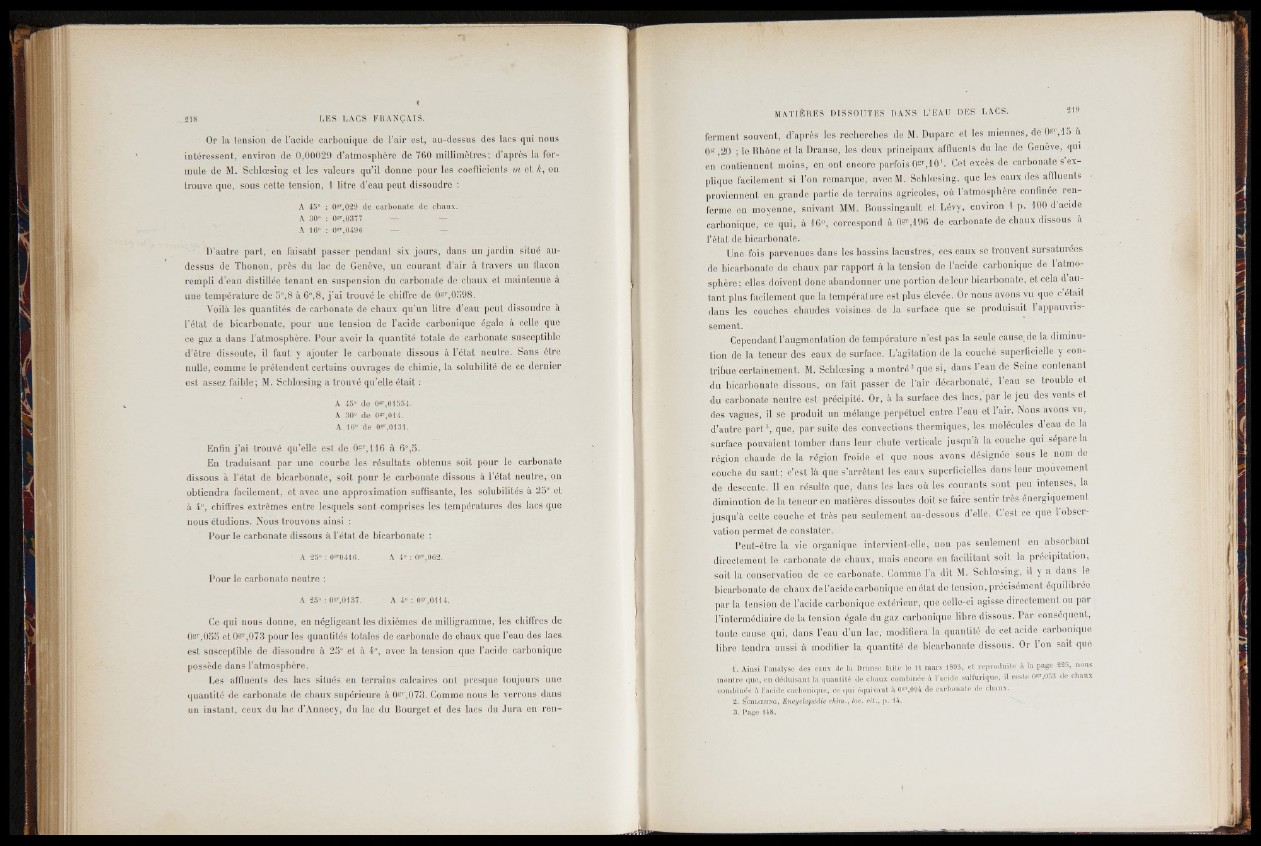
!
Or la tension de l’acide carbonique de l’air est, au-dessus des lacs qui nous
' intéressent, environ de 0,00029 d’atmosphère de 760 millimètres; d’après la formule
de M. Sehloesing et les valeurs qu’il donne pour les coefficients m et k, on
trouve que, sous cette tension, 1 litre d’eau peut dissoudre :
A 45“ : 0s®,029 de ca rb o n a te de chaux.
A 30” : 0s®,0377
A 16“ : 0s®,0496
D’autre part, en faisaht passer pendant six jours, dans un jardin situé au-
dessus de Thonon, près du lac de Genève, un courant d’air à travers un flacon
rempli d’eau distillée tenant en suspension du carbonate de chaux et maintenue à
une température de 5°,8 à 6°,8, j ’ai trouvé le chiffre de 0s®,0598.
Voilà les quantités de carbonate de chaux qu’un litre d’eau peut dissoudre à
l’état de bicarbonate, pour une tension de l’acide carbonique égale à celle que
ce gaz a dans l’atmospbère. Pour avoir la quantité totale de carbonate susceptible
d’être dissoute, il faut y ajouter le carbonate dissous à l’état neutre. Sans être
nulle, comme le prétendent certains ouvrages de chimie, la solubilité de ce dernier
est assez faible ; M. Sehloesing a trouvé qu’elle était :
* A 43® d e 0e®,01554.
A 30° d e O«®,014.
A 16“ de 08®,0131.
Enfin j ’ai trouvé qu’elle est de Os®,116 à 6°,5.
En traduisant par une courbe les résultats obtenus soit pour le carbonate
dissous à l’étal de bicarbonate, soit pour le carbonate dissous à l’état neutre, on
obtiendra facilement, et avec une approximation suffisante, les solubilités à 25° et
à 4”, chiffres extrêmes entre lesquels sont comprises les températures des lacs que
nous étudions. Nous trouvons ainsi ;
Pour le carbonate dissous à l’état de bicarbonate :
A 23" : 08®0416. A 4“ : 0s®,062.
Pour le carbonate neutre :
A 23“ : 08®,0137. A 4“ : 0e®,0114.
Ce qui nous donne, en négligeant les dixièmes de milligramme, les chiffres de
Oe®,055 et Os®,073 pour les quantités totales de carbonate de chaux que l’eau des lacs
est susceptible de dissoudre à 25° et à 4“, avec la tension que l’acide carbonique
possède dans l’atmosphère.
Les affluents des lacs situés en terrains calcaires ont presque toujours une
quantité de carbonate de chaux supérieure à 0s®,073. Comme nous le verrons dans
un instant, ceux du lac d’Annecy, du lac du Bourget et des lacs du Jura en renferment
souvent, d’après les recherches de M. Duparc et les miennes, de 0s®,lo à
0 e ,20 ; le Rhône et la Dranse, les deux principaux affluents du lac de Genève, qui
en contiennent moins, en ont encore parfois 08®,10*. Cet excès de carbonate s explique
facilement si l’on remarque, avec M. Schlcesing, que les eaux des affluents
proviennent en grande partie de terrains agricoles, où l’atmosphère confinée renferme
en moyenne, suivant MM. Boussingault et Lévy, environ 1 p. 100 d acide
carbonique, ce qui, à 16°, correspond à 0s®,196 de c a r b o n a t e de chaux dissous à
l’état de bicarbonate.
Une fois parvenues dans les bassins lacustres, ces eaux se trouvent sursaturées
de bicarbonate de chaux par rapport à la tension de l’acide carbonique de 1 atmosphère;
elles doivent donc abandonner une portion deleur bicarbonate, et cela d autant
plus facilement que la température est plus élevée. Or nous avons vu que c était
dans les couches chaudes voisines de la surface que se produisait 1 appauvrissement.
Cependant l’augmentation de température n’est pas la seule cause.de la diminution
de la teneur des eaux de surface. L’agitation de la couché superficielle y contribue
certainement. M. Schlcesing a montré2 que si, dans l’eau de Seine contenant
du bicarbonate dissous, on fait passer de l’air décarbonaté, 1 eau se trouble et
du carbonate neutre est précipité. Or, à la surface des lacs, par le jeu des vents et
des vagues, il se produit un mélange perpétuel entre l’eau et l’air. Nous avons vu,
d’autre part3, que, par suite des convections thermiques, les molécules deau de la
surface pouvaient tomber dans leur chute verticale jusqu’à la couche qui sépare ta
région chaude de la région froide et que nous avons désignée sous le nom de
couche du saut; c’est là que s’arrêtent les eaux superficielles dans leur mouvement
de descente. 11 en résulte que, dans les lacs où les courants sont peu intenses, la
diminution de la teneur en matières dissoutes doit se faire sentir très énergiquement
jusqu’à cette couche et très peu seulement au-dessous d’elle. C est ce que 1 observation
permet de constater.
Peut-être la vie organique intervient-elle, non pas seulement en absorbant
directement le-carbonate de chaux, mais encore en facilitant soit la précipitation,
soit la conservation de ce carbonate. Comme l’a dit M. Sehloesing, il y a dans le
bicarbonate de chaux de l’acide carbonique en état de tension, précisément équilibrée
par la tension de l’acide carbonique extérieur, que celle-ci agisse directement ou par
l’intermédiaire de la tension égale du gaz carbonique libre dissous. Par conséquent,
toute cause qui, dans l’eau d’un lac, modifiera la quantité de cet acide carbonique
libre tendra aussi à modifier la quantité de bicarbonate dissous. Or 1 on sait que
1. A in si l’an a ly se des eau x de la Dranse fa ite le 1 1 m a r s 1895, e t r ep r o d u ite à la pa g e 223, n o u s
m on tr e q u e , en d éd u isan t la q u an tité de ch au x c om b in é e à l ’a c id e su lfu r iq u e , il r e ste 0B ,053 de chaux
c om b in é e à l’a c id e ca rbon iqu e, ce q ui éq u iv au t à Os®,094 d e ca rbon a te de ch au x .
2. Schlcesing, Encyclopédie chir/l., loc. c it., p. 14.
3. P a g e 148.