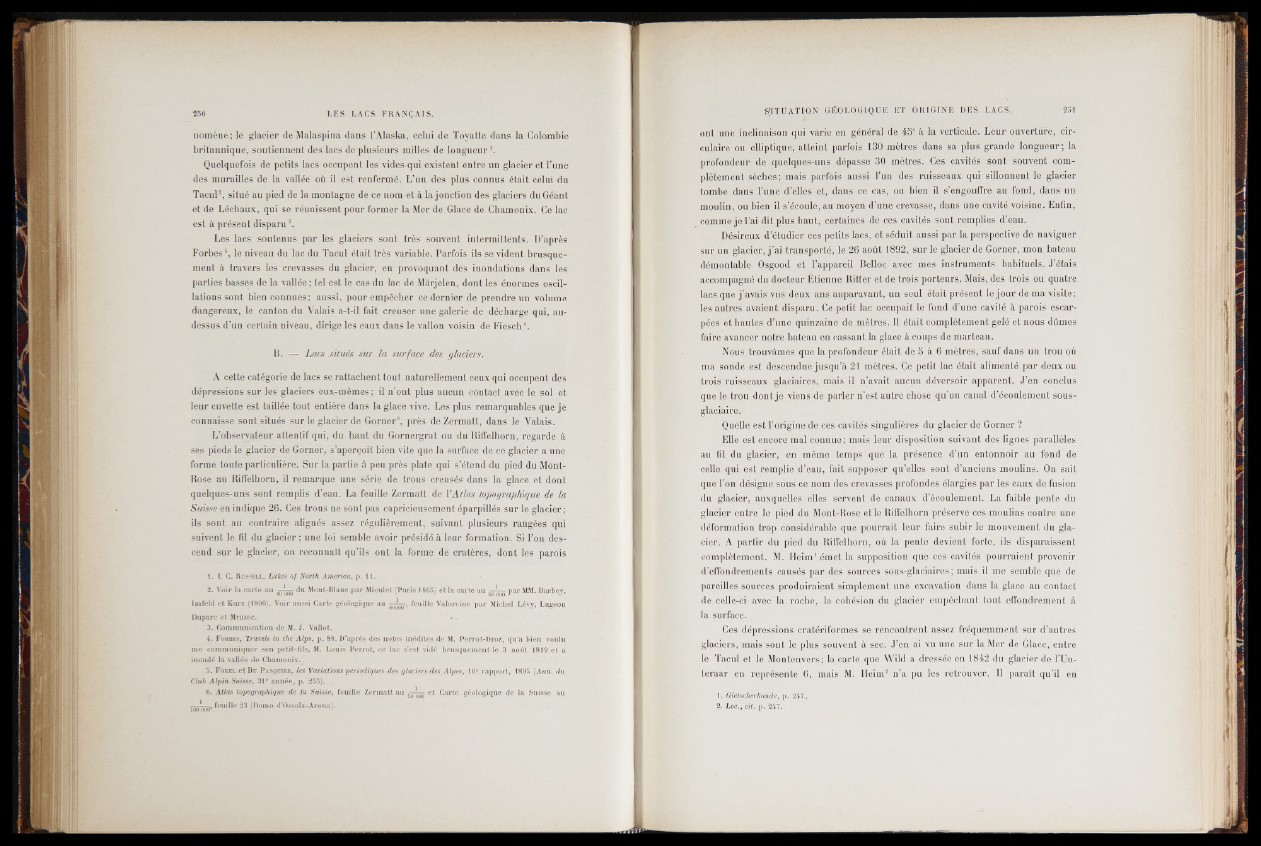
nomène; le glacier de Malaspina dans l’Alaska, celui de Toyatte dans la Colombie
britannique, soutiennent des lacs de plusieurs milles de longueur *.
Quelquefois de petits lacs occupent les vides qui existent entre un glacier et l’une
des murailles de la vallée où il est renfermé. L’un des plus connus était celui du
Tacul*, situé au pied de la montagne de ce nom et à la jonction des glaciers duGéant
et de Léchaux, qui se réunissent pour former la Mer de Glace de Chamonix. Ce lac
est à présent disparu3.
Les lacs soutenus par les glaciers sont très souvent intermittents. D’après
Forbes4, le niveau du lac du Tacul était très variable. Parfois ils se vident brusquement
à travers les crevasses du glacier, en provoquant des inondations dans les
parties basses de la vallée ; tel est le cas du lac de Mârjelen, dont les énormes oscillations
sont bien connues; aussi, pour empêcher ce dernier de prendre un volume
dangereux, le canton du Valais a-t-il fait creuser une galerie de décharge qui, au-
dessus d'un certain niveau, dirige les eaux dans le vallon voisin de Fieschs.
B. 3 Lacs situés sur la surface des glaciers.
A cette catégorie de lacs se rattachent tout naturellement ceux qui occupent des
dépressions sur les glaciers eux-mêmes ; il n’ont plus aucun contact avec le sol et
leur cuvette est taillée tout entière dans la glace vive. Les plus remarquables que je
connaisse sont situés sur le glacier de Gorner", près de Zermatt, dans le Valais.
L’observateur attentif qui, du haut du Gornergrat ou du Riffelhorn, regarde à
ses pieds le glacier de Gorner, s’aperçoit bien vite que la surface de ce glacier a une
forme toute particulière. Sur la partie à peu près plate qui s’étend du pied du Mont-
Rose au Riffelhorn, il remarque une série de trous creusés dans la glace et dont
quelques-uns sont remplis d’eau. La feuille Zermatt de ŸAtlas topographique de la
Suisse en indique 26. Ces trous ne sont pas capricieusement éparpillés sur le glacier ;
ils sont au contraire alignés assez régulièrement, suivant plusieurs rangées qui
suivent le fil du glacier ; une loi semble avoir présidé à leur formation. Si l’on descend
sur le glacier, on reconnaît qu’ils ont la forme de cratères, dont les parois
1. I. C. R u s s e ll, Lakes o f North Ame rica , p. 11.
2. Voir la carte au —^ 5 du Mont-Blanc par Mieulet (Paris 1865) et la carte au par MM. Barbey,
Imfeld et Kurz (1896). Voir aussi Carte géologique au 35555-, feuille Valorcine par Michel Lévy, Lugeon
Duparc et Mrazec.
3. Communication de M. .J. Vallot.
4 . F orb e s , Travels in the A lp s , p. 88. D’après des notes inédites de M. Perrot-Droz, qu’a bien voulu
me communiquer son petit-fils, M. Louis Perrot, ce lac s’est vidé brusquement le 3 août 1819 et a
inondé la vallée de Chamonix.
5. F o r e l et D u P a sq u ie r , les Variations périodique s des glaciers des A lp e s, 16® rapport, 1895 (An n. du
Club A lp in Suisse, 31e année, p. 255).
6. A tla s topographique d e la S uisse, feuille Zermatt au ¿5-555 et Carte géologique de la Suisse au
100000’ fewîfe 23 (Domo d’Ossola-Arona).
ont une inclinaison qui varie en général de 43° à la verticale. Leur ouverture, circulaire
ou elliptique, atteint parfois 130 mètres dans sa plus grande longueur; la
profondeur de quelques-uns dépasse 30 mètres. Ces cavités sont souvent complètement
sèches; mais parfois aussi l’un des ruisseaux qui sillonnent le glacier
tombe dans l’une d’elles et, dans ce cas, ou bien il s’engouffre au fond, dans un
moulin, ou bien il s’écoule, au moyen d’une crevasse, dans une cavité voisine. Enfin,
comme je l’ai dit plus haut, certaines de ces cavités sont remplies d’eau.
Désireux d’étudier ces petits lacs, et séduit aussi par la perspective de naviguer
sur un glacier, j ’ai transporté, le 26 août 1892, sur le glacier de Gorner, mon bateau
démontable Osgood et l’appareil Belloc avec mes instruments habituels. J’étais
accompagné du docteur Etienne Ritter et de trois porteurs. Mais, des trois ou quatre
lacs que j ’avais vus deux ans auparavant, un seul était présent le jour de ma visite;
les autres avaient disparu. Ce petit lac occupait le fond d’une cavité à parois escarpées
et hautes d’une quinzaine de mètres. Il était complètement gelé et nous dûmes
faire avancer notre bateau en cassant la glace à coups de marteau.
Nous trouvâmes que la profondeur était de 5 à 6 mètres, sauf dans un trou où
ma sonde est descendue jusqu’à 21 mètres. Ce petit lac était alimenté par deux ou
trois ruisseaux glaciaires, mais il n’avait aucun déversoir apparent. J’en conclus
que le trou dont je viens de parler n’est autre chose qu’un canal d’écoulement sous-
glaciaire.
Quelle est l’origine de ces cavités singulières du glacier de Gorner ?
Elle est encore mal connue; mais leur disposition suivant des lignes parallèles
au fil du glacier, en même temps que la présence d’un entonnoir au fond de
celle qui est remplie d’eau, fait supposer qu’elles sont d’anciens moulins. On sait
que l’on désigne sous ce nom des crevasses profondes élargies par les eaux de fusion
du glacier, auxquelles elles servent de canaux d’écoulement. La faible pente du
glacier entre le pied du Mont-Rose et le Riffelhorn préserve ces moulins contre une
déformation trop considérable que pourrait leur faire subir le mouvement du glacier.
A partir du pied du Riffelhorn, où la pente devient forte, ils disparaissent
complètement. M. Heim1 émet la supposition que ces cavités pourraient provenir
d’effondrements causés par des sources sous-glaciaires ; mais il me semble que de
pareilles sources produiraient simplement une excavation dans la glace au contact
de celle-ci avec la roche, la cohésion du glacier empêchant tout effondrement à
la surface.
Ces dépressions cratériformes se rencontrent assez fréquemment sur d’autres
glaciers, mais sont le plus souvent à sec. J’en ai vu une sur la Mer de Glace, entre
le Tacul et le Montenvers; la carte que Wild a dressée en 1842 du glacier de l’Un-
teraar en représente 6, mais M. Heim* n’a pu les retrouver. 11 paraît qu’il en
1. Gletscherkunde, p. 247.
2. Loc., cit. p . 247.