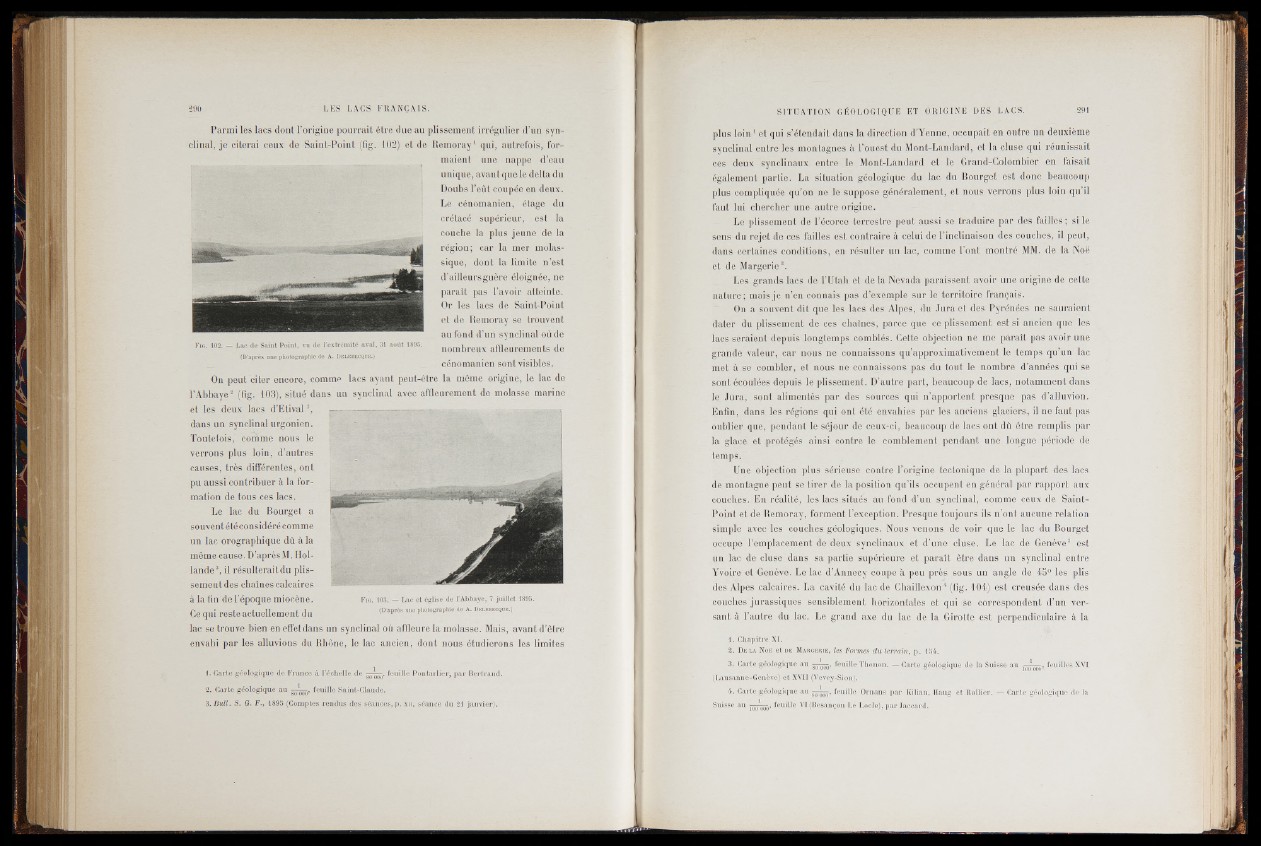
Parmi les lacs dont l'origine pourrait êtrè due au plissement irrégulier d’un synclinal,
je citerai ceux de Saint-Point (fig. 102) et de Remoray1 qui, autrefois, formaient
une nappe d’eau
unique, avant que-le delta du
Doilbs l’eût coupée en deux.
Le cénomanien, étage du
crétacé supérieur, est la
couche la plus jeune de la
région; car la mer molas-
sique, dont la limite n’est
d’ailleurs guère éloignée, ne
paraît pas l’avoir atteinte.
Or les lacs de Saint-Point
et de Remoray se trouvent
au fond d’un synclinal où de
nombreux affleurements de
cénomanien sont visibles.
On peut citer encore, commp lacs ayant peut-être la même origine, le lac de
l’Abbaye2 (fig. 103), situé dans un synclinal avec affleurement de molasse marine
et les deux lacs d’Etival2,
dans un synclinal urgonien.
Toutefois, comme nous le
verrons plus loin, d’autres
causes, très différentes, ont
pu aussi contribuer à la formation
de tous ces lacs.
Le lac du Bourget a
souvent été considéré comme
un lac orographique dû à la
même cause. D’après M. Hollande3,
il résulterait du plissement
des chaînes calcaires
à la fin de l’époque miocène.
Ce qui reste actuellement du
lac se trouve bien en effet dans un synclinal où affleure la molasse. Mais, avant d’être
envahi par les alluvions du Rhône, le lac ancien, dont nous étudierons les limites
j . Carte g éo lo g iq u e d e Fran ce à l’é c h e lle d e . fe u ille P o n ta r lie r , par Bertrand.
2 . Carte g é o lo g iq u e au 80 OQO, fe u ille Saint-Claude.
3. B u ll. S . G. F., 1895 (Comptes rend u s d e s séa n c e s, p. xu , s é a n c e du 21 ja n v ie r ).
plus loin1 et qui s’étendait dans la direction d’Yenne, occupait en outre un deuxième
synclinal entre les montagnes à l’ouest du Mont-Landard, et la cluse qui réunissait
ces deux synclinaux entre le Mont-Landard et le Grand-Colombier en faisait
également partie. La situation géologique du lac du Bourget est donc beaucoup
plus compliquée qu’on ne le suppose généralement, et nous verrons plus loin qu’il
faut lui chercher une autre origine.
Le plissement de l’écorce terrestre peut aussi se traduire par des failles; si le
sens du rejet de ces failles est contraire à celui de l’inclinaison des couches, il peut,
dans certaines conditions, en résulter un lac, comme l’ont montré MM. de la Noë
et de Margerie2.
Les grands lacs de l’Utah et de la Nevada paraissent avoir une origine de cette
nature; mais je n’en connais pas d’exemple sur le territoire français.
On a souvent dit que les lacs des Alpes, du Jura et des Pyrénées ne sauraient
dater du plissement de ces chaînes, parce que ce plissement est si ancien que les
lacs seraient depuis longtemps comblés. Cette objection ne me paraît pas avoir une
grande valeur, car nous ne connaissons qu’approximativement le temps qu’un lac
met à se combler, et nous ne connaissons pas du tout le nombre d’années qui se
sont écoulées depuis le plissement. D’autre part, beaucoup de lacs, notamment dans
le Jura, sont alimentés par des sources qui n’apportent presque pas d’alluvion.
Enfin, dans les régions qui ont été envahies par les anciens glaciers, il ne faut pas
oublier que, pendant le séjour de ceux-ci, beaucoup de lacs ont dû être remplis par
la glace et protégés ainsi contre le comblement pendant une longue période de
temps.
Une objection plus sérieuse contre l’origine tectonique de la plupart des lacs
de montagne peut se tirer de la position qu’ils occupent en général par rapport aux
couches. En réalité, les lacs situés au fond d’un synclinal, comme ceux de Saint-
Point et de Remoray, forment l’exception. Presque toujours ils n’ont aucune relation
simple avec les couches géologiques. Nous venons de voir que le lac du Bourget
occupe l’emplacement de deux synclinaux et d’une cluse. Le lac de Genève3 est
un lac de cluse dans sa partie supérieure et paraît être dans un synclinal entre
Yvoire et Genève. Le lac d’Annecy coupe à peu près sous un angle de 45° les plis
des Alpes calcaires. La cavité du lac de Chaillexon4 (fig. 104) est creusée dans des
couches jurassiques sensiblement horizontales et qui se correspondent d’un versant
à l’autre du lac. Le grand axe du lac de la Girotte est perpendiculaire à la
1. Chapitre XI.
2 . De l à Noë e t de Ma r g e r ie , les Formes d u te rra in , p . 154.
3. Carte g éo lo g iq u e au gQ-000> fe u ille Thonon. — Carte g éo lo g iq u e d e la S u isse a u ^ feu ille s XVI
(Lausanne-Genève) e t XVII (Vevey-Sion).
4. Carte g éo lo g iq u e au ^ 0Q, feu ille Ornans p a r Kilian, Haug e t R o llie r . — Carte g é o lo g iq u e de la
Suisse a u 10Q 00Q, feu ille VI (Besançon Le Locle), par Jaccard.